Une ouvrière qui sait comme s'y prendre
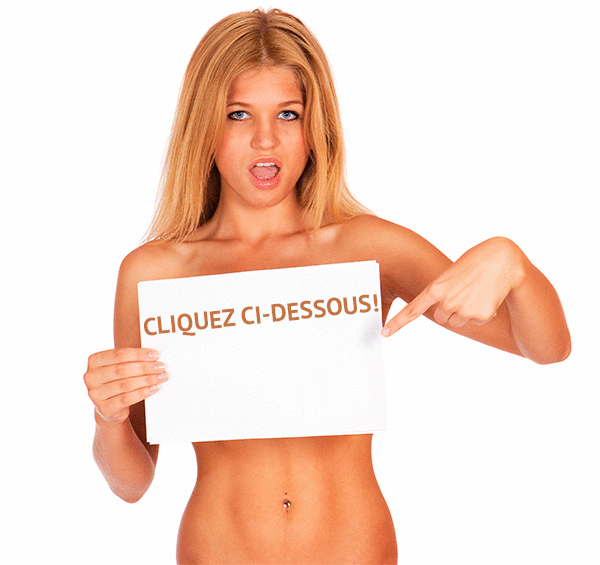
🛑 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Une ouvrière qui sait comme s'y prendre
Copyright © 2022 Le jeune diplômé . Tous droits réservés. Theme ColorMag par ThemeGrill. . Propulsé par WordPress .
Informations sur l'emploi pour les jeunes diplomés
Chronique. Au-delà des stigmates de la crise sanitaire, la « photographie du marché du travail en 2020 », publiée récemment par l’Insee, a été très commentée pour ce qui représente pour certains un cap historique. « Pour la première fois, la part des cadres [et professions libérales] dans l’emploi total dépasse celle des ouvriers : elle atteint 20,4 %, contre 19,2 % pour les ouvriers. Au début des années 1980, les ouvriers étaient près de quatre fois plus nombreux que les cadres. » Ce constat est toutefois trompeur.
D’une part, les cadres ne sont pas la catégorie dominante, ni chez les femmes, ni chez les hommes. La définition des catégories « ouvriers et employés » obéit, en partie, à une division sexuée des activités économiques, parfois cocasse. Ainsi, une conductrice de taxi salariée est classée comme ouvrière car c’est un métier masculin ; en revanche, un conducteur d’un taxi-ambulance est un employé car lié à la santé, une activité « par essence » féminine. Résultat : les femmes sont ultra-majoritaires parmi les employés et 80 % des ouvriers sont des hommes. Les employées pèsent près de la moitié de l’emploi féminin, alors qu’une femme sur six, soit un peu plus de 17 %, est cadre. Du côté masculin, les ouvriers sont toujours les plus nombreux, près de 30 %, contre 23 % pour les cadres.
On pourrait rétorquer que ce n’est qu’une question de temps puisque le différentiel entre ouvriers et cadres masculins était de trente points il y a quarante ans. La poursuite des tendances n’est cependant pas si évidente. Du côté de l’offre de travail, la stagnation du niveau d’éducation des entrants depuis plusieurs années risque de se muer en dégradation avec la crise éducative née il y a un an. Du côté de la demande, le développement de l’économie des plates-formes s’accompagne d’une forte croissance d’activités comme celle de livreur ou coursier à vélo.
Un livreur de repas à domicile, par exemple, s’il est salarié, est considéré comme ouvrier. Mais la plupart de ces nouveaux livreurs ont aujourd’hui le statut d’autoentrepreneur et sont donc classés comme artisans. Le basculement vers un modèle de salariat, volontaire ou forcé par l’évolution du droit reconnaissant le caractère fictif de l’indépendance, donnerait une photographie plus réaliste de ce pan croissant des ouvriers. Les plans d’infrastructure et de transition énergétique nationaux ou européens constituent une mécanique potentiellement plus massive : ils porteront des activités locales intensives en ouvriers (et ouvrières), notamment dans le bâtiment et les industries associées (fenêtres, etc.).
Il vous reste 38.94% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Gérer mes choix Tout refuser Tout accepter
France Culture
Radios
L'espace musique
Vue de la manifestation des mineurs à Decazeville, 1964. La mobilisation syndicale des ouvriers était encore forte, à cette époque, pour défendre leurs droits. ©Getty - KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho
Provenant du podcast
Entendez-vous l'éco ?
Contacter
Contacter l'émission
Suivre France Culture
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tiktok
France Bleu Alsace
France Bleu Armorique
France Bleu Auxerre
France Bleu Azur
France Bleu Béarn Bigorre
France Bleu Belfort-Montbéliard
France Bleu Berry
France Bleu Besançon
France Bleu Bourgogne
France Bleu Breizh Izel
France Bleu Champagne-Ardenne
France Bleu Cotentin
France Bleu Creuse
France Bleu Drôme Ardèche
France Bleu Elsass
France Bleu Gard Lozère
France Bleu Gascogne
France Bleu Gironde
France Bleu Hérault
France Bleu Isère
France Bleu La Rochelle
France Bleu Limousin
France Bleu Loire Océan
France Bleu Lorraine Nord
France Bleu Maine
France Bleu Mayenne
France Bleu Nord
France Bleu Normandie (Calvados - Orne)
France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)
France Bleu Occitanie
France Bleu Orléans
France Bleu Paris
France Bleu Pays Basque
France Bleu Pays d'Auvergne
France Bleu Pays de Savoie
France Bleu Périgord
France Bleu Picardie
France Bleu Poitou
France Bleu Provence
France Bleu RCFM
France Bleu Roussillon
France Bleu Saint-Étienne Loire
France Bleu Sud Lorraine
France Bleu Touraine
France Bleu Vaucluse
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et accéder à vos informations personnelles, comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement ou vous opposer aux traitements fondés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur " Gérer mes choix " ou dans notre politique de confidentialité présente sur ce site, et dans ce cas vous n'aurez plus accès à du contenu personnalisé basé sur votre navigation, aux contenus et fonctionnalités provenant des réseaux sociaux ou des plateformes de vidéos et nous ne tiendrons pas compte de votre usage pour améliorer notre site.
Avec nos partenaires, nous traitons vos données pour les finalités suivantes : le fonctionnement du site, la mesure d'audience et web analyse, la personnalisation, la publicité et le ciblage, les publicités et contenus personnalisés, la mesure de performance des publicités et du contenu, le développement de produit, l'activation des fonctionnalités des réseaux sociaux.
Vos préférences seront conservées pendant une durée de 6 mois.
En direct des RDV de l'Histoire à Blois, du vendredi 08 octobre 2021, nous allons essayer de comprendre l'histoire de la classe ouvrière, qui a joué un rôle structurant dans l'animation des structures productives françaises jusqu'aux grands mouvements de désindustrialisation des années 1980.
Anne-Sophie Bruno, Judith Rainhorn, Xavier Vigna (Maître de conférences à l’université de Bourgogne).
Jusqu'en 1961, la classe ouvrière représentait encore 40% des travailleurs en France, contre un peu plus de 20% soixante ans plus tard. Face à cette diminution majeure, "l'ouvrier" apparait comme le symbole des grandes évolutions, des grandes mutations qu'a connu le capitalisme qui, après avoir pleinement consacré les modèles de production industriels, semble aujourd'hui se tourner principalement vers des dynamiques financières et dématérialisées.
Cependant, les ouvriers et les salariés se caractérisent surtout par leur volonté de s'organiser pour s'opposer aux logiques "exploitatrices", voire "déshumanisantes" de ce système économique, dont ils en sont pourtant un des maillons essentiels.
Au début de l'histoire du salariat, au XIXème siècle, les premiers mouvements de contestation de la classe salariale se définissent autour de leur opposition à la mécanisation du travail, vue comme une menace pour le savoir faire des artisans et une concurrence déloyale. L'introduction de logiques d'efficacité dans l'univers des manufactures conduit à des premières formes de protestation frontales, à l'image du "luddisme", soit des actions qui visent à détériorer les machines.
Malgré le développement et la montée en puissance du salariat ouvrier tout au long du XIXème siècle, les syndicats n'apparaissent pas tout de suite. Les mobilisations restent souvent, comme le luddisme, spontanées et minoritaires. Ce paradigme est lié aux dispositions juridiques françaises qui ont longtemps entravé la possibilité de rééllement s'organiser collectivement et surtout de permettre à des structures institutionnelles établies de représenter et de porter les revendications des ouvriers. Dans le droit du travail, il faut attendre 1968 pour que les premiers représentants syndicaux apparaissent, malgré la créations de premières structures organisées dès 1895.
Ce mouvement montre qu'au sein même de la construction d'un mouvement ouvrier et d'une classe ouvrière visible se développe construction politique et syndicale très forte. A l'heure actuelle, on voit se défaire petit à petit ces formes de syndicalisme né de 1936. Certes, les syndicats sont autorisés en 1884 mais ils avaient, à cette époque, une étendue d'actions légales assez faibles et éloignées des capacités de négociation dans l'entreprise. C'est vraiment à partir de 1936 que se met en place un pouvoir de négociation à la fois dans l'entreprise, avec les délégués d'atelier. Il s'agit véritablement d'une rupture centrale étant donné que ce droit à une parole collective a permit aux ouvriers de changer un peu le rapport de force dans ce monde industriel. Anne-Sophie Bruno
Les syndicats comme la CGT et des partis politiques, comme le Parti communiste, ont pourtant joué des rôles majeurs, tout au long du XXème siècle, dans la construction d'une conscience de classe, d'un partage de valeurs communes et dans la représentation des revendications ouvrières auprès du patronat ou de l'Etat.
La loi de 1884 est un repère chronologique, évidemment très pratique et visible encore une fois. Cependant, il ne faut pas qu'elle oblitère complètement ce qui existait avant. L'autorisation de créer des syndicats n'arrive pas sur une table rase. Il y avait en effet quantité de formes extrêmement diverses d'associations ouvrières qui avaient pris le relais des corporations d'Ancien Régime, à l'image des chambres syndicales par métiers. Au moment où les premiers mouvements de grève apparaissent, l'ensemble de ces associations gagnent alors pleinement en visibilité et deviennent de véritables structures d'organisation. Judith Rainhorn
Cependant, l'idée de comprendre la "classe ouvrière" en tant que telle ne doit pas occulter le fait que celle-ci se caractérise par une grande diversité salariale et par une grande hétérogénéité des expériences et des luttes. Influencée par la vision marxiste du travail, très centrée sur les ouvriers industriels, la compréhension de ces mouvements ne peut être que partielle si on ne prend pas en compte les travailleurs agricoles, les artisans ou les indépendants. Cette diversité permet alors de prendre conscience de la difficulté d'harmoniser les luttes au sein de cette "classe", bien que des revendications portant sur les conditions de travail, la santé, la pénibilité ou la sécurité des ouvriers se retrouvent dans tous les corps de métiers.
On va avoir, au début du XIXème siècle, une transformation de l'artisanat et une croissance des petites structures . Cependant, à partir des années 1850, l'apparition de nouvelles formes d'organisation du travail et d'usines vont constituer autant d'évolutions qui favoriseront la naissance d'un véritable "groupe ouvrier" qui va alors progressivement prendre conscience de lui même et qu'on va peu à peu appeler la "classe ouvrière". Xavier Vigna
Les liens d'unité au sein de cette classe ouvrière sont dont difficiles à réellement appréhender face à cette multitude de réalités qui cohabitent ou s'entrechoquent, mais aussi par le fait que les frontières entre les catégories ouvrières et celles des employés sont souvent poreuses et instables. L'appartenance de classe et la fierté de faire partie d'un bloc monolithique de partage de conditions salariales communes doit donc être largement remis en cause.
C'est vrai que le terme de classe ouvrière introduit une certaine homogénéité. En effet, on peut dire qu'on reconnaît progressivement une communauté de conditions, une communauté de destin nourrie par un sentiment d'appartenance commun. On peut cependant se poser la question : Que partage le canut lyonnais en 1831, l'ouvrière parisienne dans les années 1860 et le métallo "cégétiste" d'Aubervilliers en 1930? Pas grand chose mais en même temps beaucoup, c'est à dire un travail manuel, des compétences professionnelles techniques, une dépendance au patronat, une rémunération salariale. Au delà de ces éléments, on va dire que la condition ouvrière reste de toute façon, pendant toute la période, à la fois très vaste et très disparate. Judith Rainhorn
Aujourd'hui, l'automatisation et l'optimalisation de la production ont renforcé la productivité des usines de plus de 20%, nécessitant moins d'ouvriers au sein des unités de travail. De plus, les processus inhérents à la mondialisation ont en partie conduit à des mouvements de délocalisation et donc à une désindustrialisation massive de l'architecture économique française, de plus en plus portée par la consommation et les services. L'invisibilisation des ouvriers a donc conduit à une désorganisation de ses instances représentatives et à une perte de sens de l'action commune dans le monde du travail.
Pour comprendre l'ensemble des enjeux qui entourent l'histoire de la mobilisation de la classe ouvrière, nous avons le plaisir de rencontrer au RDV d'histoire de Blois Anne-Sophie Bruno, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Xavier Vigna, Maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Bourgogn et Judith Rainhorn, Professeure des universités à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Codycross est un jeu mobile dont l'objectif est de trouver tous les mots d'une grille. Pour cela, vous ne disposez que des définitions de chaque mot. Certaines lettres peuvent parfois être présentes pour le mot à deviner. Sur Astuces-Jeux, nous vous proposons de découvrir la solution complète de Codycross .
Voici le mot à trouver pour la définition "Qui sait prendre une décision ferme et s'y tient" ( groupe 174 – grille n°2 ) :
Une fois ce nouveau mot deviné, vous pouvez retrouver la solution des autres mots se trouvant dans la même grille en cliquant ici . Sinon, vous pouvez vous rendre sur la page sommaire de Codycross pour retrouver la solution complète du jeu. 👍
Manuels de Lettres et Sciences humaines
La condition ouvrière de Simone Weil (« expérience de la vie d’usine »)
Le problème que se pose Simone Weil est de comprendre à quelles conditions le travail ouvrier peut cesser d’être servile. Faut-il diminuer le temps de travail et libérer l’ouvrier ou l’ouvrière de l’usine, ou bien transformer les conditions de travail à l’usine ?
Il ne s’agit pas, pour Simone Weil, d’émanciper absolument les hommes du travail, ou de refuser le travail manuel de l’usine. Il faut plutôt transformer radicalement l’organisation du travail, afin que les hommes retrouvent leur dignité et quittent leur condition d’esclave.
La condition ouvrière n’est pas un ouvrage publié du vivant de Simone Weil mais il constitue un recueil de textes variés qui ont tous pour objet la condition ouvrière et qui ont été écrits pendant ou après l’expérience à l’usine de Simone Weil. Nous trouvons ainsi plusieurs lettres à ses proches, comme son ancienne élève du Puy-en-Velay Simone Gibert, ou à ses camarades militants — Boris Souvarine et Nicolas Lazarévitch notamment — qui racontent son travail à l’usine et les difficultés qu’elle rencontre. Nous trouvons également le Journal d’usine qu’elle a tenu pendant cette année où elle recense les tâches effectuées et ses impressions au fil des jours. Sont présents enfin un certain nombre d’articles de Simone Weil, publiés dans différentes revues, notamment militantes, et parfois sous pseudonyme, qui proposent d’analyser la condition ouvrière ou la conjoncture politique de l’époque.
Le texte « expérience de la vie d’usine » constitue un de ces articles. Ce texte est d’abord l’ébauche d’une lettre de Simone Weil adressée à l’écrivain Jules Romains, écrite en 1935. Simone Weil a lu son livre Montée des périls , où l’auteur décrit dans un chapitre la vie ouvrière : elle est très affectée par ce chapitre et souhaite lui faire part de ses impressions. Ce n’est ensuite qu’en 1941 qu’elle reprend cette lettre pour la retoucher puis la publie dans la revue Économie et humanisme , utilisant le pseudonyme d’Émile Novis.
Ce texte s’inscrit dans le contexte de son expérience de la vie ouvrière qui l’a profondément marquée. Le 4 décembre 1934, elle entre en effet comme ouvrière sur presse chez Alsthom (devenu Alstom depuis) à Paris. Titulaire d’une agrégation de philosophie, elle souhaite vivre de l’intérieur la condition ouvrière. Elle y travaille jusqu’en avril, avec plusieurs périodes de mise à pied ou de convalescence. Elle travaille ensuite un mois aux usines de Boulogne-Billancourt comme emballeuse avant de travailler, à partir de juin, aux usines Renault en tant que fraiseuse. En août 1935, elle cesse de travailler à l’usine et enseigne à la rentrée au lycée de Bourges.
Simone Weil livre dans cet article un témoignage de la vie d’usine.
Dans une première partie du texte, elle analyse les causes de la servitude du travail ouvrier. En quoi s’agit-il d’un travail contraint et non émancipateur ?
Puis, dans un second temps, elle propose plusieurs voies pour repenser le travail à l’usine, notamment en modifiant profondément l’organisation du travail.
Le but de Simone Weil est d’abord de lutter contre un premier obstacle : l’ignorance. En effet, la plupart des ouvriers ou des ouvrières ne parviennent pas à réfléchir à leur propre condition. Ce n’est pas qu’ils n’ont pas les capacités pour décrire ce qu’ils vivent. Cette impuissance est en réalité un effet du malheur : lorsque nous sommes touchés par le malheur, nous cherchons à y échapper, à le fuir, et non à l’étudier. Or, pour réfléchir aux moyens de transformer le travail, la condition préalable est de comprendre cette condition ouvrière, de la connaître de l’intérieur : il faut partir du point de vue de l’homme qui travaille. C’est là l’ambition de Simone Weil lorsqu’elle décide de travailler comme manœuvre sur machine.
Mais à la méconnaissance de leur propre condition, Simone Weil ajoute une deuxième difficulté : le risque de l’oubli. Nous pourrions en effet penser que l’ouvrier ou l’ouvrière qui ne travaille plus pourrait affronter le malheur de son ancienne condition. Mais c’est alors l’oubli qui les touche : « rien n’est plus vite recouvert par l’oubli que le malheur passé ». Cette volonté de lutter contre l’oubli est ainsi un des moteurs de l’écriture de Simone Weil : consigner ses impressions pour qu’elles ne se perdent pas.
Dans l’absolu, l’usine pourrait être un lieu d’épanouissement : le travail en commun, le fait de participer à une œuvre collective pourraient créer dans l’âme de l’ouvrier ou de l’ouvrière un sentiment de satisfaction, qui naît à la suite d’un travail bien fait ou du devoir accompli. Ils pourraient dès lors se sentir indispensables. Or, ces sentiments ne surgissent pas à l’usine : l’usine ne forme pas des hommes libres, mais des esclaves, pris dans « l’étau de la subordination ». Les ouvriers et ouvrières sont en effet soumis à un ensemble de règles, règles brutales, arbitraires, qui leur sont imposées de l’extérieur. Toute activité à l’usine est soumise à ces règles : il n’y a ni hasard à l’usine ni d’espace où le travailleur pourrait déployer sa spontanéité. Ainsi, la nécessité de pointer en arrivant à l’usine interdit tout retard, fût-il d’une seconde. De la même façon, l’organisation du temps de travail est contrainte, et le changement de tâche imposé. Parfois, les règles sont même contradictoires et c’est à l’ouvrier de
Dormir et bien baiser
La bombe Madelyn Marie se faire percer le cul
Bite noire bite blanche