Maman chaude Amber Lynn se fait ramoner son trou
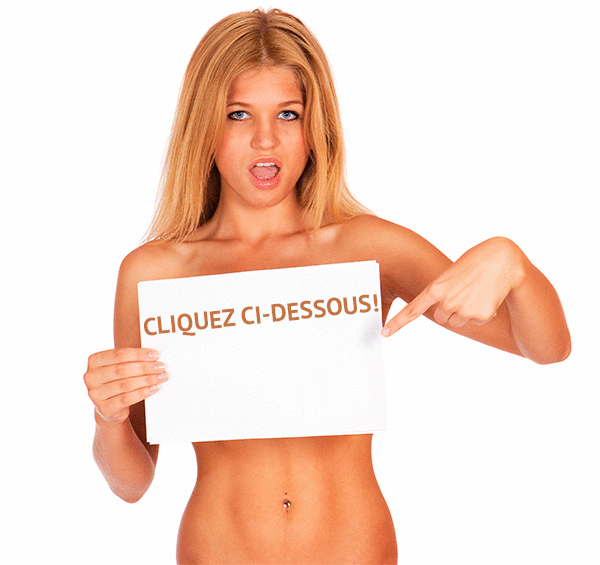
🔞 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Maman chaude Amber Lynn se fait ramoner son trou
Pour nous soutenir, acceptez les cookies
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal , Essentiels , Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d’audience et développement de produit , Statistiques , Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal
Publié le
04/12/2008 à 00:00
Pour suivre l’analyse et le décryptage où que vous soyez
Offre limitée. 2 mois pour 1€ sans engagement
Offrez gratuitement la lecture de cet article à un proche :
L’article sera disponible à la lecture pour votre bénéficiaire durant les 72h suivant l’envoi de ce formulaire, en cliquant sur le lien reçu par e-mail.
Assurez-vous que la personne à laquelle vous offrez l’article concerné accepte de communiquer son adresse e-mail à L’Express.
Les informations renseignées dans ce formulaire sont destinées au Groupe L’Express pour l’envoi de l’article sélectionné à votre proche, lequel sera informé de votre identité. Pour toute information complémentaire, consulter notre Politique de protection des données .
Vous venez d’offrir à mail@mail.com l’article suivant :
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer.
L’Express, une rédaction engagée aux côtés des Ukrainiens à travers un numéro exceptionnel
Profitez du 1er mois offert, sans engagement
Offre Découverte
1 er mois offert
sans engagement
Les dépenses de santé augmentent pour la bonne cause
(vieillissement de la population, progrès médical), mais aussi pour de
mauvaises raisons : fraudes, abus et gaspillages sont encouragés par un système
laxiste.
Dans la première catégorie se rangent les arrêts maladie
injustifiés, la facturation d'actes fictifs ou les filières organisées. Comme
cette escroquerie révélée en octobre 2006 : des ordonnances - falsifiées ou
achetées - permettaient de se procurer toutes sortes de médicaments, exportés
ensuite vers l'Asie du Sud-Est. Préjudice : 20 millions d'euros. Un cas
similaire (voir l'article page 44) est actuellement instruit par la justice.
Les inspecteurs de la Sécurité sociale se sont fixé pour objectif de récupérer
138,5 millions d'euros en 2008. Mais le gisement, difficile à estimer, est
probablement bien plus important.
Les abus, eux, sont le lot d'un système mal
organisé, que chacun utilise à sa convenance et non selon son réel état de
santé. Ainsi quand l'hôpital est considéré comme un hôtel : certaines familles
y laissent séjourner une personne âgée qui pourrait rentrer chez elle. Les
laboratoires d'analyse biologique sont montrés du doigt, souvent à juste titre
: ils bénéficient d'importants gains de productivité, grâce à la
quasi-automatisation des principaux examens remboursés. Mais ils ne les
répercutent pas sur leurs prix. Chaque année, la Sécurité sociale négocie avec
eux des baisses de tarifs (94 millions d'euros en 2007). « On est encore loin
du compte », fait valoir un bon connaisseur du dossier.
Les hôpitaux ont tendance à utiliser des aides, en principe
destinées à financer leur restructuration, et à différer celle-ci, regrette la
Cour des comptes dans son dernier rapport sur la Sécurité sociale. Exemple :
malgré 10 millions d'euros reçus entre 2004 et 2007, le CHU de Lille a «
aggravé » son déficit d'exploitation, notamment en raison d'une « difficulté
inquiétante à maîtriser les charges de personnel », affirment les rapporteurs.
Autre astuce : pour obtenir davantage de financements, certains établissements
« surdéclarent » des pathologies, comme les grossesses à risques.
Même ceux qui ont le civisme chevillé au corps sont incités à
dépenser plus qu'il ne le faudrait. Les Français ne vont pas aux urgences par
plaisir, mais parce qu'ils ne trouvent aucun autre lieu d'accueil : 80 % des
cas ne justifient pas d'hospitalisation. Ce même défaut de structures adaptées
(et moins coûteuses) explique que près de 30 % des courts séjours en hôpital ne
sont pas médicalement nécessaires. De même que l'occupation d'un bon quart des
lits en hôpital psychiatrique : mais où héberger ces malades ? Les soins de
ville et l'hôpital ne sont pas assez coordonnés : « Si je suis en vacances et
que mon patient est hospitalisé, on va lui prescrire des examens qu'il a déjà
passés avec moi », témoigne un généraliste de la région lyonnaise. Ce défaut de
suivi pèse aussi sur la qualité de la prévention. « Moins de 1 diabétique sur 5
se fait doser son taux d'hémoglobine glyquée », déplore Gérard Raymond,
président de l'Association française des diabétiques. Or cet examen épargne aux
patients le passage à une phase plus lourde de la maladie. Et permet de faire
des économies tout en soignant mieux.
Spécialistes ou généralistes, les médecins ne soignent pas
partout de la même façon ni au même prix. Prenons l'exemple des
masseurs-kinésithérapeutes. Un patient se voit prescrire en moyenne 22 séances
de rééducation après la pose d'une prothèse de la hanche. Mais pourquoi, dans
10 % des cas, dépasse-t-on les 40 séances ? Pour l'assurance-maladie,
l'explication est plus économique que médicale. Il y a davantage de séances
quand les kinés sont très nombreux (Nord, Paca...) et qu'ils se partagent une
clientèle plus restreinte. Certes, ce sont les médecins qui prescrivent les
premières, mais les kinés peuvent leur en demander de nouvelles.
Les généralistes n'échappent pas à ce type de comportements.
Selon la Cnam, 8 700 généralistes (sur un total de 54 000) engendrent à eux
seuls 30 % des remboursements de médicaments en France. Exemple : 1
professionnel sur 5 prescrit la moitié des antiulcéreux. La Cnam a calculé que,
si tous ces « gros » prescripteurs revenaient dans la moyenne, l'économie
totale serait supérieure à 2 milliards d'euros (en médicaments, mais aussi en
transports, analyses...).
Les excès peuvent être individuels : certains médecins présentent
un volume d'activité « aberrant » et vont être mis sous contrôle cette année.
Mais la surconsommation tient aussi et surtout à l'organisation du système :
difficultés à harmoniser les pratiques médicales, tarification à l'acte, qui
pousse plutôt à en multiplier le nombre, etc. L'assurance-maladie a beau
prendre des mesures d'économie, elle « ne parvient pas à réduire l'écart entre
les gros prescripteurs et la moyenne de la profession », explique Jean-Marc
Aubert, directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins à la Cnam.
« Les médecins choisissent souvent les traitements les plus récents, donc les
plus coûteux, au détriment de molécules plus anciennes et pour lesquelles on
dispose de génériques », s'alarme l'assurance-maladie. Les Français sont - en
valeur - les plus gros consommateurs d'IPP (traitement de l'ulcère) et de
statines (anticholestérol) en Europe. « Certains d'entre nous cèdent parfois à
un effet de mode, ou cherchent à faire plaisir aux patients », admet un
généraliste installé en région lyonnaise.
La pression commerciale des laboratoires peut, en partie,
expliquer ce comportement. L'industrie du médicament le reconnaît elle-même :
si la visite médicale est « sans incidence sur le nombre de prescriptions »,
elle en « affecte le contenu ». Même si la pratique s'est moralisée, certains
médecins ont décidé d'y renoncer et préfèrent s'informer par la lecture de
revues spécialisées qui excluent toute forme de publicité. Ces francs-tireurs
sont encore trop rares.
Opérer une cloison nasale pour gêne respiratoire ou
reconstruire un sein après un cancer sont des actes de chirurgie réparatrice,
pris en charge par la Sécurité sociale. A contrario, remodeler un nez ou
gonfler un 85 A en 90 C relèvent de la chirurgie esthétique : chacun paie de sa
poche. La frontière n'est pas toujours aussi indiscutable. Ainsi, se faire «
recoller » les oreilles. Certains peuvent y voir de la coquetterie : pourtant,
l'assurance-maladie a tranché en faveur du remboursement. Mais, le plus
souvent, ce sont les médecins qui peuvent faire basculer une opération de la
case chirurgie esthétique à celle de la réparation, selon le degré de gravité
qu'ils accordent au problème. Cette marge de manoeuvre peut être
exploitée par des petits malins. Exemple : des poignées d'amour un peu trop
voyantes se transforment, dans le dossier médical du patient, en pathologie
grave, nécessitant une liposuccion. Le spécialiste fait alors d'autant mieux
marcher son tiroir-caisse qu'il promet au patient une prise en charge de
l'intervention. Un chirurgien plasticien a ainsi indûment facturé 27
liposuccions et 12 mammoplasties en une année, soit la bagatelle de 55 460
euros à la charge de la Sécurité sociale !
Depuis 2006, la chirurgie esthétique est donc sur la sellette. Les
mécanismes de contrôle ont été renforcés et un référentiel a été créé. Il
s'agit d'un système alliant typologie et bonnes pratiques permettant
d'éclaircir les cas les plus litigieux. Suffisant ? Cette année, la lutte
contre la fraude a encore permis d'économiser près de 10 millions d'euros. Une
somme qui représente la moitié du budget « chirurgie de réparation » de la
Sécu, soit 20 millions d'euros par an.
Histoire vécue dans un grand hôpital parisien. Un interne
attend un patient. A deux reprises, il appelle le brancardier. En vain. Le
jeune médecin, agacé par ce retard, part à la recherche de l'employé, qu'il
trouve en train de boire son café, tranquillement. « Il savait parfaitement que
nous l'attendions », soupire le praticien. Ce type de comportement n'est ni
anodin ni rare. Un malade qui n'arrive pas à l'heure, en salle d'opération ou
pour un examen, et l'hôpital subit un coût direct (chirurgiens immobilisés,
report d'analyses demandant de garder le patient une nuit de plus...). D'autres
dégâts, plus insidieux, ne se retrouvent pas dans les comptes, comme la
sous-utilisation du matériel médical.
A en croire les médecins et les aides-soignants, la responsabilité
de ces ratés incomberait aux brancardiers, souvent jugés démotivés et
corporatistes. « Selon les jours, et selon la personne de service, on sait si
la journée va bien se dérouler ou pas. Il est clair que, pour certains,
l'intérêt professionnel n'est pas toujours au rendez-vous », déplore François
Aubart, chirurgien et président de la Coordination médicale hospitalière. « Les
brancardiers ne sont pas seuls en cause », explique Philippe Crépel, secrétaire
fédéral de la CGT-Santé. « Vous arrivez devant un patient et la toilette n'est
pas encore faite, ou bien son état de santé ne vous a pas été communiqué, et le
malade est trop fragile pour que l'on puisse le déplacer de manière simple.
»
Au-delà de la bonne volonté, la ponctualité à l'hôpital demande
une véritable organisation. « La médecine est devenue plus technique et plus
segmentée, ce qui exige beaucoup de coordination entre tous les services »,
explique Pierre-Etienne Haas, ingénieur, chargé de projet à la Mission
nationale d'expertise et d'audit hospitaliers (Meah). Autre problème pointé :
la difficulté des médecins à anticiper. Ils ont tendance à demander tous les
transports en urgence. Les systèmes informatiques, trop souvent perçus comme la
solution miracle, se révèlent bien décevants si les personnels ne suivent pas
sur le terrain.
Enfin, l'architecture du bâtiment entre en compte. Dans les
anciens hôpitaux pavillonnaires, certains couloirs sont si étroits que deux
brancards ne peuvent pas s'y croiser. Dans les immeubles de type «
administratif », construits dans les années 1970, ce sont les ascenseurs,
parfois trop exigus, ou en panne, qui ralentissent la cadence. « Les
déplacements sont beaucoup plus simples lorsque les plateaux techniques et les
parties communes sont installés au centre de l'immeuble », notent les experts
de la Meah. En attendant que tous les hôpitaux déménagent, des solutions
existent, comme celle pratiquée par le Nouvel Hôpital civil, à Strasbourg, où
les bons vieux bipeurs, qui obligeaient les brancardiers à se trouver à
proximité de leur local, ont été remplacés par des téléphones portables.
Entre 2006 et 2007, la Caisse primaire d'assurance-maladie
a été victime d'un trafic de Subutex (traitement de substitution pour
héroïnomanes) qui lui aura coûté entre 4 et 5 millions d'euros. Dans ce
dossier, instruit par la juge Marie-Odile Bertella-Geffroy, figurent quelques
petits malfrats, une douzaine de pharmaciens exerçant dans l'Est parisien et
six médecins. En octobre 2006, dans le XIe arrondissement de Paris, des
policiers de la Sécurité publique interpellent un jeune homme. Celui-ci sort du
cabinet d'un praticien et se trouve en possession de 32 ordonnances libellées
au nom de 17 patients différents ! Toutes prescrivent du Subutex, un produit
analgésique contenant de la buprénorphine...
Grâce à des écoutes téléphoniques et à des témoins qui se mettent
à table, la juge découvre qu'un médecin a prescrit 21 000 boîtes de ce
médicament à 600 patients pour le seul premier trimestre de 2006 ! Et qu'un
autre a dépassé les 30 000 en dix-huit mois. Le mécanisme de la fraude ? Dans
un premier temps, des trafiquants, munis de simples photocopies d'attestations
de CMU ou d'AME (aide médicale d'Etat), démarchent des médecins peu scrupuleux,
qui leur délivrent des ordonnances... contre versement d'une dîme de 20
euros. Puis, grâce à ce sésame, lesdits trafiquants se rendent dans des
pharmacies complaisantes pour obtenir la marchandise. Laquelle est soit écoulée
à Paris, soit expédiée vers la Géorgie, la Pologne et la Finlande, pays où un
cachet de Subutex est revendu 60 euros...
Bien-être ou soins ? Chaque année, près de 500 000
curistes, munis d'une prescription de leur médecin, migrent vers les stations
thermales. Pourtant, la communauté scientifique se divise sur la réelle valeur
médicale de ces séjours. Des doutes plus ou moins fondés selon les spécialités.
En rhumatologie, des études prouvent l'efficacité du traitement pour certaines
pathologies. Mais il n'en est rien, encore, pour la dermatologie ou les
troubles de l'anxiété, par exemple. Autre bizarrerie, la durée du traitement.
Peu importent la maladie ou le profil du patient, l'assurance-maladie ne
rembourse que les séjours de trois semaines et plus... Seule certitude : « Les
patients rentrent en meilleure forme, ce qui est logique après vingt et un
jours de vie saine, constate un médecin de campagne. Pour beaucoup, ce sont des
vacances. » Et de citer le cas de ce couple de retraités qui préfère partir à
Dax en septembre pour éviter l'affluence du plein été.
Pour économiser une soixantaine de millions d'euros, Yves Bur,
député (UMP) du Bas-Rhin, a proposé de réduire le remboursement des cures de 65
% à 35 %. Le gouvernement s'est immédiatement opposé à la mesure.
Officiellement, parce qu'il redoutait que la Sécu ne dépense en médicaments ce
qu'elle aurait économisé en cures. Mais aussi parce qu'il ne voulait pas
affronter la bronca des villes thermales, que les eaux font vivre.
C'était une affaire qui tournait bien. Trop bien. Cette
compagnie de taxis toulousaine affichait l'un des plus gros chiffres d'affaires
de la région. Son secret ? Le transport de malades revu et corrigé par la
patronne. Employés non déclarés, fausses factures, kilomètres fictifs rajoutés,
paiement de quatre transports alors qu'un seul véhicule a été utilisé pour un
trajet collectif... « Un véritable système de fraudes généralisé, dont le
préjudice pour la Sécurité sociale est évalué à plus de 700 000 euros »,
s'exclame la responsable de la gestion des risques de la caisse primaire
d'assurance-maladie (CPAM) de Haute-Garonne, Dominique Chanet, surprise par
l'étendue de l'escroquerie.
Entre 1997 et 2006, les remboursements affectés aux transports
sanitaires - ambulances, véhicules sanitaires légers (VSL) et taxis - ont
augmenté chaque année de 8 à 10 %, pour atteindre un budget de 2,2 milliards
d'euros. Si la fraude organisée reste marginale, le détournement du système
n'est pas rare. « Nous pouvons être amenés à signer des bons de transport non
pour des raisons médicales, mais pour des motifs économiques : le patient n'a
pas de voiture ou pas les moyens de se payer un plein d'essence, par exemple »,
explique ainsi un généraliste du Nord-Pas-de-Calais. Un autre, qui exerce en
ville, reconnaît prescrire parfois une ambulance plutôt qu'un VSL pour des
patients qui peuvent voyager « assis », mais qui ont besoin d'être aidés par
deux ambulanciers (il n'y en a qu'un dans un VSL). Et de citer l'exemple d'une
personne âgée à mobilité réduite, qui habite un troisième étage sans ascenseur.
Le Dr Marcel Garrigou Grandchamps, responsable de la cellule juridique du
syndicat Espace généraliste, va plus loin : « Souvent, les médecins sont mis
devant le fait accompli et signent le bon qui donne droit au remboursement a
posteriori, sans avoir eu le choix du mode de transport, explique-t-il. Or il
existe une forme de pression des transporteurs sanitaires, qui poussent à
l'utilisation des ambulances plutôt que des VSL. » Un transport couché coûte
trois à quatre fois plus cher qu'un transport assis. L'addition grimpe d'autant
plus vite.
Le laxisme se rencontre aussi à l'hôpital. « Certains malades en
sortent sur les deux pieds et s'engouffrent dans une ambulance, les valises
posées sur la civière, parce qu'il n'y a ni taxi ni VSL à disposition »,
raconte un ancien interne des hôpitaux de Paris. Pour l'un de ses confrères, le
problème tient aussi à la pression des patients eux-mêmes : « La plupart des
malades considèrent l'ambulance comme un dû, raconte-t-il. Même valides, ils ne
s'imaginent pas sortir de l'hôpital autrement. Comme nous avons souvent mieux à
faire que de nous battre avec eux, nous signons. »
Parfois, l'abus de complaisance devient un abus tout court. En
janvier 2008, une polémique a éclaté dans le Gard : la soeur d'un cadre
du CHU de Nîmes avait été transportée en hélicoptère du Samu sans réelle
motivation médicale. Coût estimé de la balade : 10 000 euros !
Depuis un an, la Cnam a donc décidé de serrer la vis en
multipliant les contrôles et les nouvelles réglementations. Résultat : 400
transporteurs - 200 sanitaires, 200 taxis - ont été contrôlés pour suspicion de
fraude et 150 médecins ont été « mis sous accord préalable », autrement dit
sous surveillance. En 2007, le montant remboursé par l'assurance-maladie n'a
progressé que de 5,7 %, contre 9 % l'année précédente. Une économie de 24
millions d'euros, mais il reste encore de la marge.
Oups, ce service est momentanément indisponible.
Dans le jargon informatique, cela s’appelle un code erreur 500. Mais essayez de recharger, nous allons tout réparer !
Bondage Soumise
Baisée Devant Tout Le Monde
Pornovore