Une scène de rêve
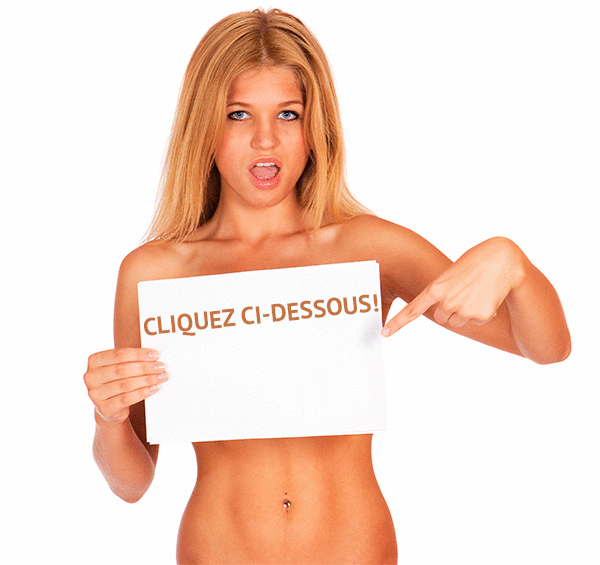
🛑 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Une scène de rêve
Afficher / masquer la barre latérale
Sur cette version linguistique de Wikipédia, les liens interlangues sont placés en haut à droite du titre de l’article. Aller en haut .
1 Généralités et considérations théoriques
2.3.2 Dürer et le rêve d'Apocalypse
2.3.3 Raphaël et l'invention de la bulle
2.3.4 Les artistes flamands : une plongée avant l'heure dans l'inconscient
2.4 Füssli et les prémisses d'une nouvelle époque
2.5 Le romantisme : une annonce du traitement symboliste
2.6 Le symbolisme : des hommes au rêve habitués
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
↑ Revenir plus haut en : a b c et d Áron Kibédi Varga , « Peindre le rêve », Littérature , vol. 139, n o 3, 2005 , p. 115–125 ( DOI 10.3406/litt.2005.1906 , lire en ligne [ archive ] , consulté le 30 janvier 2018 )
↑ Katalin Kovacs , Images du rêve des Lumières: Watteau et Fragonard , vol. 12, 1 er janvier 2016 ( lire en ligne [ archive ] )
↑ Maryse Siksou , « Contenus des rêves : approche expérimentale et expérience subjective », Le Journal des psychologues , vol. 325, n o 2, 2015 , p. 22 ( ISSN 0752-501X et 2118-3015 , DOI 10.3917/jdp.325.0022 , lire en ligne [ archive ] , consulté le 2 octobre 2019 )
↑ Jean Cassou, Encyclopédie du Symbolisme , Paris, Somogy, 1988 ( ISBN 978-2-85056-129-0 )
↑ Revenir plus haut en : a et b Robert L. Delevoy , Journal du symbolisme , Skira, 1986 ( ISBN 9782605000548 , OCLC 489981200 , lire en ligne [ archive ] )
La dernière modification de cette page a été faite le 21 juin 2022 à 21:57.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques . En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence .
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc. , organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.
Politique de confidentialité
À propos de Wikipédia
Avertissements
Contact
Version mobile
Développeurs
Statistiques
Déclaration sur les témoins (cookies)
Modifier les paramètres d’aperçu
Pages pour les contributeurs déconnectés en savoir plus
Sommaire
déplacer vers la barre latérale
masquer
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références »
Cet article est une ébauche concernant la peinture .
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant ( comment ? ) selon les recommandations des projets correspondants .
Le rêve est une des thématiques les abondantes de la peinture .
Souvent spontanément associé au courant surréaliste par le grand public, c'est pourtant un sujet de représentation très fécond qui traverse les époques, les courants, les cultures, les artistes et les techniques. Thème protéiforme par excellence, il est potentiellement porteur de traitements plastiques et de choix esthétiques fantastiques mais, pourtant, il est resté très bridé par des règles de composition traditionnelles figées jusqu'à très tard dans la période moderne. Profondément lié à son époque, à l'évolution des recherches scientifiques et à la personnalité de l'artiste, la thématique du rêve en peinture connaîtra juste avant l'avènement du romantisme des déclinaisons de plus en plus décomplexées dans leur expression formelle (voir Johan Heinrich Füssli pour l'expression explicite de l'univers onirique ou Antoine Watteau pour l'expression implicite), jusqu'à l'explosion des représentations de l'inconscient dans le symbolisme puis le surréalisme .
Le rêve, comme l’homme, a mis du temps à s’individualiser. Le traitement plastique qu’on lui accorde est révélateur du traitement que l’homme s’accorde à lui-même. Ainsi, la représentation du rêve évolue en parallèle à l'évolution de l'homme.
Àron Kibedi Varga [ 1 ] met en lumière l'une des particularités les plus saillantes du traitement du rêve par la peinture : en dépeignant une réalité intérieure expérimentable uniquement par une écoute du récit des autres (ou du récit créé à partir de nos propres souvenir dans le cas d'un rêve personnel) le rêve touche à tout ce qui n'est pas atteignable par les sens. L'auteur distingue trois réalités atteignables par le peintre :
Contrairement à la réalité extérieure, vécue et observée, ou à la réalité imaginable, qui est une projection basée sur des « éléments qui n'entrent pas dans l'expérience quotidienne » [ 1 ] , le rêve développe dans l'esprit « une série d'images mentales qui ne correspondent pas véritablement à l'expérience visuelle » [ 1 ] du peintre et du spectateur. Il doit donc inventer, comme lorsqu'il traite de la réalité imaginable (épisode mythique, religieux, récit inventé), mais cette invention se base sur une série d'images mentales réellement expérimentées par quelqu'un (le rêveur) là où la réalité imaginable se construit sur un récit qui sort du cadre de l'expérimentation d'un individu. On notera ainsi que les premières représentations de rêves ne sont pas des représentations d'une réalité intérieure mais d'une réalité imaginable (rêves issus des traditions mythologiques ou religieuses notamment).
Àron Kibedi Varga a relevé trois types différents de représentations oniriques dans l'histoire de la peinture [ 1 ] :
Le rêve médiéval n'est digne d'être connu que s'il comporte un message à délivrer à la communauté des croyants. Le rêveur médiéval est donc un être exceptionnel et la peinture traduit ce fait en ne représentant exclusivement que des rêveurs prestigieux guidés par le divin (Charlemagne, Constantin, Jacob, St Martin, Innocent III) issus de récits pour la plupart d'origine biblique. Ainsi, l'âme se met en vacance de la matière pour aller à la rencontre des principes supérieurs et, comme dans les récits des mythologies antiques, elle accède à l'au-delà. Comme le rappelle Katalin Kovacs, le rêve « était considéré avant tout comme la visualisation d’une communication avec l’au-delà et le surnaturel » [ 2 ] . On ne s'étonnera donc pas de trouver parmi les principaux sujets de représentation onirique les thématiques suivantes :
Le rêve moderne est le direct héritier du rêve médiéval mais, petit à petit, il se transforme à la fois en esprit libéré de la matière (notion de vacance de l'âme) et devient le témoignage d'une imagination individuelle et débridée résultant des sensations au cours des XVII e et XVIII e siècles. Le rêve s'individualise en même temps que l'homme.
L'articulation du visible et de l'invisible a donné lieu à des artifices techniques témoignant d'une volonté de marquer visiblement la frontière entre ce qui est rêvé de ce qui est vécu. Ainsi, « les artistes de la Renaissance mettent en rapport le monde réel et le monde onirique en procédant par juxtaposition, en jouant sur les symétries et la perspective, en opposant des dimensions de l’espace (proche-lointain, droite-gauche, haut-bas) ou la couleur (clair-obscur). Une autre tentative consiste à interposer un personnage entre les deux mondes (souvent un ange) » [ 3 ] .
Raphaël a ouvert cette tendance à la distinction effective des deux environnements : l’onirique et le réel, qui se retrouvent chacun dans des compartiments distincts dans les fresques des chambres du Vatican. On retrouve notamment le procédé dans la représentation de l’histoire de Joseph dans la loge VII du Vatican, avec Joseph interprétant les songes de Pharaon . Les rêves sont intégrés au-dessus de la scène dans des médaillons dorés flottant au-dessus des personnages. D’autre artistes vont par la suite réutiliser le procédé, de Pontormo à Ligozzi , jusqu’au début de l’époque contemporaine.
Dans son tableau Le Cauchemar , Füssli montre en un même moment l'action de rêver et l'image du rêve, en offrant une représentation symbolique du sommeil et de sa vision.
L'apparition et l'avènement de l'esthétique symboliste est concomitante aux premières investigations et découvertes sur l'inconscient ( Charcot , Janet , Freud , ...) et à l'inauguration par Henri Bergson d'un nouveau mode de connaissance : l' intuition . Comme l'écrit Jean Cassou [ 4 ] , le rêve symboliste est inventeur. C'est « la faculté novatrice et imaginante des symbolistes » que chacun cultive, déploie et emploie « à des fins créatrices à partir de sa singularité » . Au-delà du sujet de représentation à traiter, le rêve des artistes symbolistes n'est ni un vagabondage imaginatif assimilable à la rêverie, ni un élément du sommeil mystérieux et bizarre sur lequel on s'arrête avec curiosité. Il désigne « une intimité personnelle et inaliénable » entretenue avec « l'imagination créatrice » , intimité qui est affirmée de manière consciente pour la première fois dans un mouvement esthétique.
Gustave Moreau , Puvis de Chavannes , Odilon Redon , Fernand Khnopff , Edvard Munch , Max Klinger , Gustav Klimt ou tous les artistes rattachés au courant symboliste « s'échappent des apparences du réel » [ 5 ] en mimant le rêve [ 5 ] . En effet, au-delà d'être un sujet de représentation, le rêve devient avec la période symboliste une démarche créatrice.
Pour les surréalistes, le rêve est un extraordinaire réservoir d'images dans lequel on vient puiser une imagerie visuelle.
Afficher / masquer la barre latérale
Sur cette version linguistique de Wikipédia, les liens interlangues sont placés en haut à droite du titre de l’article. Aller en haut .
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
↑ Montgomery, « Dreaming Up Dream Sequences », Videomaker , décembre 2010 , p. 57–59 ( lire en ligne [ archive ] )
↑ Deidre Barrett , The Committee of Sleep: How Artists, Scientists, and Athletes Use Dreams for Creative Problem-Solving—and How You Can Too , Oneiroi Press, 2010 ( 1 re éd. 2001) ( ISBN 0982869509 ) , « Chapter 2: Dreams that Money Can Buy »
↑ Revenir plus haut en : a b et c James Walters , Alternative Worlds in Hollywood Cinema , Chicago, Intellect Books , 2008 ( ISBN 1841502022 ) , « Chapter 2 »
↑ Christian Metz , « Identification, Mirror (from The Imaginary Signifier ) » , dans Leo Braudy ; Marshall Cohen, Film Theory and Criticism: Introductory Readings , New York, Oxford University Press , 1999 , 800–808 p. ( ISBN 0195105982 )
↑ Olga Taxidou , Tragedy, Modernity and Mourning , Edinburgh , Edinburgh University Press , 2004 ( ISBN 0748619879 ) , p. 99
↑ Rabin, « Dream, Vision or Fantasy? », Script , vol. 17, n o 4, july–august 2011, p. 66–68 ( ISSN 1092-2016 )
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dream sequence » ( voir la liste des auteurs ) .
La dernière modification de cette page a été faite le 30 juillet 2022 à 01:11.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques . En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence .
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc. , organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.
Politique de confidentialité
À propos de Wikipédia
Avertissements
Contact
Version mobile
Développeurs
Statistiques
Déclaration sur les témoins (cookies)
Modifier les paramètres d’aperçu
Pages pour les contributeurs déconnectés en savoir plus
Sommaire
déplacer vers la barre latérale
masquer
La séquence de rêve est une technique utilisée dans le storytelling , en particulier à la télévision et au cinéma, pour séparer un bref intermède de l'histoire principale. L'intermède peut consister en un flashback , un flashforward , un fantasme , une vision , un rêve ou un autre élément.
Communément, les séquences de rêve apparaissent dans de nombreux films pour éclairer le processus psychique du personnage rêveur ou donner au public un regard sur le passé du personnage [ 1 ] . Par exemple, dans Pee-Wee Big Adventure , le but des rêves de Pee-wee est d'informer le spectateur de ses angoisses et craintes après avoir perdu son vélo. D'autres fois, l'action majeure se déroule en rêve, permettant au cinéaste d'explorer des possibilités infinies, comme le montre Michel Gondry dans La Science des rêves . Le psychologue de Harvard Deirdre Barrett note dans son livre The Committee of Sleep que, tandis que le contenu principal des séquences de rêve est déterminé par l'intrigue générale du film, les détails visuels reflètent souvent l'expérience individuelle du rêve du scénariste ou du réalisateur. Pour le film La Maison du docteur Edwardes ( Spellbound ) de Hitchcock , Salvador Dalí a conçu des ensembles fortement inclinés inspirés de son propre espace de rêve. Ingmar Bergman a allumé des séquences de rêve dans plusieurs films avec une forte lueur qui reflète ses propres cauchemars, et Orson Welles a conçu une scène de Le Procès ( The Trial ) pour refléter la façon dont l'architecture a constamment changé dans ses rêves [ 2 ] .
Les films présentent généralement des rêves comme un espace visuellement accessible ou objectivement observé, un environnement discret dans lequel les personnages existent et interagissent comme ils le font dans le monde plutôt que de se limiter au point de vue subjectif, un rêve est normalement vécu dans la vie réelle [ 3 ] . De cette façon, les films réussissent à présenter un monde rêvé cohérent avec la réalité diégétique du film. Par la transition de l'un à l'autre, un film établit non seulement les limites mais les résonances entre les deux mondes. Ces résonances peuvent révéler les observations ou désirs subjectifs d'un personnage sans s'écarter du point de vue objectif du narrateur, caméra ou réalisateur avec lequel certains théoriciens — comme Christian Metz — croient que le spectateur s'identifie [ 4 ] .
Il est également possible d'expliquer rétroactivement les éléments de l'intrigue passée comme une séquence de rêve pour maintenir une continuité plausible dans la fiction continue, comme une série télévisée. Tel était le cas de Dallas , où Bobby Ewing , l'un des personnages les plus populaires de la série avait été tué ; quand les scénaristes décident de remettre Bobby en scène, le premier épisode de la dixième saison ( Retour à Camelot ) révèle que les événements entre la mort de Bobby et la fin de la saison neuf faisaient partie d'un cauchemar de sa femme.
La séquence de rêve racontée par Atossa au début de la tragédie athénienne d' Eschyle , Les Perses (472 AEC), est l'une des premières dans l'histoire du théâtre européen [ 5 ] . La première séquence de rêve dans un film est plus contestée [ 3 ] . Le critique de cinéma Bob Mondello affirme que le premier film célèbre avec une séquence de rêve fut le Sherlock Junior de Buster Keaton (1924) [ 6 ] . Avant cela, Leslie Halpern affirme que la séquence de rêve la plus lointaine est dans Life of an American Fireman ( 1903 ) de Edwin S. Porter . Avant cela, James Walters note que G. A. Smith fait utilisation d'une séquence de rêve dans Let Me Dream Again (1900), mais il est prudent de noter la précarité de réclamer un film le premier à présenter une séquence de rêve compte tenu du développement transnational rapide du cinéma dans ses premières années et que tant de films de l'époque sont perdus.
Walters retrace la technique de la séquence de rêve consistant à révéler une chose comme étant une autre (révélant ce que le public pensait être un rêve pour être la réalité), retour aux spectacles de lanternes magiques comportant des diapositives "glissantes" dans lesquelles certaines diapositives de lanternes, par exemple, comporteraient deux feuilles de verre avec des images différentes peintes sur chacune, par exemple un cocon et un papillon. La première feuille est projetée, puis la seconde glisse dessus pour révéler un changement, comme un papillon qui émerge d'un cocon [ 3 ] . Les séquences de rêve sont devenues très populaires dans la première période du cinéma à la suite de ce changement de format de phase. Parallèlement à cette technique, une séquence de rêve qui est introduite par un personnage s'endormant puis entrant dans la séquence de rêve est également devenue populaire via des films tels que Rêve d'un fondu de fondue ( Dream of a Rarebit Fiend , 1906) d' Edwin S. Porter et Wallace McCutcheon . Ce qui est important, c'est que ces films ont créé un modèle pour des séquences de rêve dans lequel les pensées internes d'un personnage ne sont pas représentées subjectivement (du point de vue du personnage), mais à partir d'un angle de caméra objectif qui donne au public l'impression moins d'un personnage qui a un rêve que d'être transporté avec le personnage à un monde rêvé dans lequel les actions du personnage sont capturées par la caméra de la même manière que les vrais mondes.
Vous n'avez pas encore de compte ? Créez un compte
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/6f\/Interpret-Your-Dreams-Step-1-Version-3.jpg\/v4-460px-Interpret-Your-Dreams-Step-1-Version-3.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/6f\/Interpret-Your-Dreams-Step-1-Version-3.jpg\/v4-728px-Interpret-Your-Dreams-Step-1-Version-3.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<\/div>"}
Posez votre journal des rêves près de votre lit. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous en avez toutes les nuits. Vous pouvez vous aider à vous en souvenir si vous les notez quelque part. À côté de votre journal des rêves, laissez un crayon ou un stylo. Cela vous rappellera d'écrire vos rêves dès que vous vous réveillez [1]
X
Source de recherche
.
N'oubliez pas aussi d'amener votre journal des rêves avec vous lorsque vous partez en voyage.
Il vaudrait mieux que vous mettiez la date chaque fois que vous écrivez un rêve. Si vous le voulez, vous pouvez laisser de l'espace entre chaque entrée pour y noter votre interprétation du rêve.
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/eb\/Interpret-Your-Dreams-Step-2-Version-3.jpg\/v4-46
J'ai réussi à la faire trembler de plaisir