Une adorable ado devient perverse
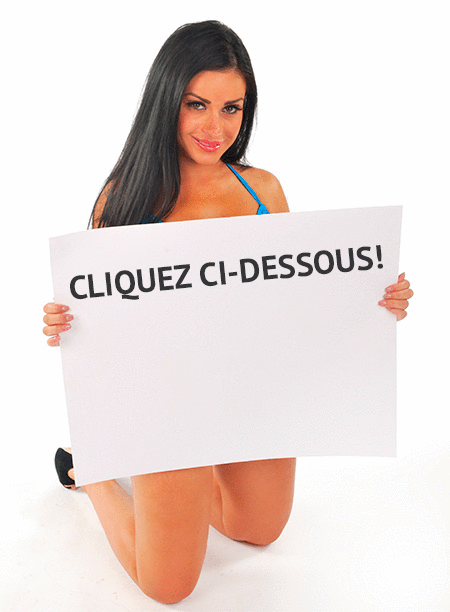
⚡ TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Une adorable ado devient perverse
Notre plateforme utilise des cookies à des fins de statistiques, de performances, de marketing et de sécurité. Un cookie est un petit code envoyé par un serveur internet, qui s'enregistre sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Il garde la trace du site internet visité et contient un certain nombre d'informations sur cette visite. Ces données nous permettent de vous offrir une expérience de navigation optimale.
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Les cookies de préférences permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.
Les cookies de marketing et communication sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification, ainsi que les fournisseurs de cookies individuels.
Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites web pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace. La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission. Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers qui apparaissent sur nos pages. À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement dès la Déclaration relative aux cookies sur notre site web. En savoir plus sur Cairn, comment nous contacter et comment nous traitons les données personnelles veuillez voir notre Politique confidentialité . Veuillez indiquer l'identifiant de votre consentement et la date à laquelle vous nous avez contactés concernant votre consentement. Votre consentement s'applique aux domaines suivants : www.cairn-sciences.info, www.cairn-mundo.info, www.cairn.info, www.cairn-int.info
Déclaration relative aux cookies mise à jour le 11.8.2022 par Cookiebot
Recherche avancée
help_outline Aide à la recherche
Pas encore enregistré ? Créer un compte
Revues Ouvrages Que sais-je ? / Repères Magazines Mon cairn.info
Accueil
Revues
La Pensée Numéro 2020/1 (N° 401) Comptes rendus
Comptes rendus
Dans
La Pensée
2020/1 (N° 401) , pages 137 à 146
Mis en ligne sur Cairn.info le 12/06/2020
https://doi.org/10.3917/lp.401.0137
file_download Zotero (.ris)
file_download EndNote (.enw)
open_in_new RefWorks
Distribution électronique Cairn.info pour Fondation Gabriel Péri © Fondation Gabriel Péri. Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
Avec le soutien du
Avec leur soutien
À propos
Éditeurs
Particuliers
Bibliothèques
Organisations
Abonnement Cairn Pro
Listes publiques
Dossiers
Réseaux sociaux
Contact
Cairn International ( English )
Cairn Mundo ( Español )
Cairn Sciences ( Français )
Authentification hors campus
Aide
Chargement en cours. Veuillez patienter...
Attention,
clear
l'identifiant saisi ne correspond pas à un compte Cairn.info.
Attention,
clear
le mot de passe saisi ne correspond pas au compte Cairn.info.
Attention,
clear
erreur à l'authentification.
Vous n’êtes actuellement pas connecté(e) en institution.
You might also want to visit our Cairn International Edition .
Tal vez desee visitar también nuestros contenidos en español en Cairn Mundo .
1 Sous le titre « Habiter », Bernard Klasen propose « une philosophie de l’habitat », un habitat qu’il explore sous l’angle de l’enracinement et du lieu. Il reprend le ternaire de Martin Heidegger, « bâtir, habiter, penser » : bâtir pour habiter sur une terre, et habiter pour pouvoir penser. Une relation posée comme déterminante : la manière dont nous habitons dit notre rapport au monde et façonne notre façon de le penser.
2 Cette réflexion philosophique repose sur un présupposé anthropologique : l’habitat est le lieu vital où l’homme peut se structurer en humanité. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un logement, mais « d’avoir lieu », de « faire corps », d’être au monde. « S’enraciner semble être le propre de notre humanité. Habiter est un des vecteurs les plus profonds de notre humanisation » (p. 21). Jean Greisch, dans sa préface, situe bien le propos : « Le thème central de l’ouvrage est le phénomène multiforme et plurivoque de l’habiter, dont il explore les différentes valences […] dans une perspective où s’entrecroisent des questions politiques, morales, économiques et religieuses » (p. 9).
3 Bernard Klasen creuse l’étymologie et la lexicographie des termes relatifs à l’habitat, à la demeure, à l’enracinement, au patrimoine, suivant l’inspiration d’Heidegger pour qui le langage est la maison que l’homme habite principalement. Il plaide pour l’enracinement, quelles que soient les modalités, individuelles ou collectives, de l’art d’habiter. C’est par l’habitat que l’homme peut se recueillir, qu’il construit son intériorité, qu’il se structure en humanité. En ces temps de mobilité incessante, de migrations voulues ou forcées, l’auteur se fait l’impitoyable pourfendeur du « nomadisme » qui, dit-il, n’est qu’une fable et ne saurait être un art de vivre. L’ouvrage prend une tonalité résolument polémique contre le besoin frénétique de déplacements qui caractérise la vie moderne. Dans son chapitre 3, il s’en prend à ceux qui valorisent ces mouvements et qu’il appelle les « déracineurs ».
4 Le livre navigue par questionnements et par oppositions : il en appelle à Aristote et à Platon (chapitre 4), et surtout à Heidegger, pour contrer les problématiques de l’architecte Radkowski ou du philosophe Lévinas, pour défendre celles d’Henri Maldiney ou de Mircea Eliade. Il scrute les actes concrets de l’habiter quotidien, s’intéressant particulièrement aux éléments architecturaux aussi concrets que le toit, l’escalier, le mur, la fenêtre, la porte et le seuil. Il est ponctué de nombreux « arrêts sur l’image », qualifiés « excursions », qui nous transportent de Meudon-la-Forêt avec Fernand Pouillon aux enclos paroissiaux en Bretagne, du musée des Civilisations anatoliennes d’Ankara et ses vases zoomorphes à une église du Finistère ou à l’abbaye de Vaucelles pour les vitraux de Gérard Lardeur, auprès de Boris, le fondeur de cloches du film Andrei Roublev de Tarkovski, dans l’architecture de Jean Nouvel pour le musée des Arts premiers, à Saint-Sauveur-in-Chora près des murailles de Constantinolple, sur la place du « clos cathédrale » à Metz, dans les bains suisses de Vals, sur la mosaïque de la « Terre sainte » d’une ancienne église de Jordanie, dans le grand cairn de Barnenez ou dans la mosquée Mihrimah Camii d’Istanbul, du temple d’Apollon à Didymes aux bétyles nabatéens de Pétra ou aux Biergarten peints par Marcel Gromaire. « Ces promenades », écrit l’auteur, permettent de « greffer l’intérêt de nos propos sur un monde vécu qui ne s’égare pas dans des théories trop abstraites » (p. 23). Elles font halte pour mieux cerner la force de l’art d’habiter sous toutes ses formes. Ces pérégrinations prêtent attention à des édifices qui parlent, voire qui chantent. La mise en perspective historique de ces exemples en ferait voir d’autres logiques, comme l’avaient fait par exemple Paul Blanquart dans son Histoire de la ville (La Découverte, 1997) ou Marcel Hénaff dans La ville qui vient (L’Herne, 2008). Mais ce type d’analyse sociohistorique est hors du propos d’un livre qui se veut philosophique, au sens où Heidegger entendait cette posture intellectuelle de questionnement du sens.
5 Tout homme est référé à ce que Bernard Klasen appelle un « élémental », une source première. L’importance qu’il accorde au « chez soi » renvoie à une expérience communément partagée. « Nous ne sommes guère que localement, et tous le sont, c’est notre commune condition première ; notre appartenance au monde qu’avec tout le monde nous partageons. Reconnaître cet humus premier, ce presque rien qui nous porte et qui nous fait, c’est la plus simple des sagesses » (p. 310).
6 Quels que soient les parcours de chacun, quelles que soient les errances multipliées dans un monde en mouvement accéléré, il y a en effet toujours un enracinement premier, un « chez soi » primordial, qui constitue le « sentir fondamental » de chacun. Dire « chez soi », c’est déjà postuler l’existence d’un « soi-même ». C’est ce dans quoi, ce par quoi, ce avec quoi et ce pour quoi nous régissons affectivement, viscéralement, parce c’est là notre premier terreau, celui qu’il est bon de retrouver pour se sentir « à la maison ». Cet enracinement est constitutif de ce qui nous structure en humanité. Il marque nos sensibilités et commande quantité de nos représentations. Le travail de Bernard Klarsen fait prendre conscience de ce que porte le désir de « demeurer ».
7 Il situe là, à juste titre, la « religion populaire » que l’on disait « païenne » (du latin paganus , paysan), car enracinée dans un terreau, dans un paysage, dans les gestes, les pratiques, les traditions et les croyances qui en font partie, notamment pour offrir des sépultures aux morts et bâtir des temples pour honorer leurs dieux. « Le lieu et le religieux ont partie liée […]. Le religieux a besoin de lieux, de points focaux, de centres, de clôtures, etc. » (p. 90 et 153). Il donne sens, dans le sens premier de ce mot « sens », qui est d’abord au niveau de la sensibilité, avant celui de l’interprétation ou celui de l’orientation d’un destin général que développent les religions instituées ou les messianismes sécularisés.
8 Cette apologie de l’enracinement n’est pas sans risque. La question est posée dans l’introduction de l’ouvrage : « Comment s’enraciner sans s’enfermer ? » (p. 22). Question décisive, en ces temps où les références à un monde passé ou à une tradition figée donnent lieu à maintes postures intégristes. C’est justement le rôle de l’école de sortir de ce risque d’enfermement. Par la prise de distance, par le travail de la raison et par la formation à l’esprit critique, grâce aux méthodes de pensée qu’apportent les différentes disciplines scolaires, le lieu et le temps de l’école permettent d’éviter que ce qui était enfantin ne devienne infantile et que l’identité première devienne de l’identitaire. Il se construit à l’école une identité d’un autre type, celle de l’homme comme être de passage, en perpétuel transit, puisqu’il s’agit aussi de savoir sortir de l’école pour entrer dans la société universelle. L’école est aussi un lieu de socialisation qui prépare à celle, plus large, de notre « maison commune », pour reprendre le sous-titre de l’encyclique Laudato Si’ (2016) du pape François citée par Bernard Klasen.
9 Ce temps de socialisation est source d’autres enracinements. Dans la confrontation des rapports sociaux s’explicitent des prises de conscience avec d’autres enjeux. L’écologie globale du texte du pape les souligne sans détour, quand la terre sur laquelle il faut vivre se transforme en « immense dépotoir », quand « l’environnement humain et l’environnement urbain se dégradent ensemble », dans une « globalisation de l’indifférence » à l’égard des exclus, et dans une évolution de la société « qui semble parfois suicidaire » (§21, 48, 52, 55). L’aggravation des injustices et la violence des rapports d’exploitation mettent à mal les conditions de vie des plus démunis, y compris leur habitat. Celui-ci est en crise avec la réduction massive du monde paysan et le dépeuplement des campagnes et avec le gigantisme des mégapoles sans forme et sans âme où « encasernement et inhumanité caractérisent nos médiocres boîtes à loyer mal insonorisées », comme l’écrivait déjà Le Corbusier en 1946 ( Manière de penser l’urbanisme , éditions de l’Architecture d’aujourd’hui). Crise socio-environnementale aujourd’hui aggravée par les flux migratoires de plus en plus massifs qui jettent sur les routes terrestres ou maritimes des millions de gens en déshérence.
10 Les réactions et les résistances sont elles aussi de plus en plus fortes et les nouveaux pouvoirs technologiques placent l’évolution de notre planète à la croisée des chemins. De ce monde qui est plus que jamais celui de la mobilité, du nomadisme, des flux et des échanges, Bernard Klasen n’en redoute que les aspects les plus négatifs, les plus déshumanisants. Il en est d’autres. Les combats pour la justice et la solidarité ouvrent de nouveaux espaces de fraternité, de vie et de penser pour « la sauvegarde de la maison commune » (sous-titre de Laudato si’ ). Le temps des passages et des métissages est aussi celui de nouveaux enracinements, pour le meilleur et pour le pire ; c’est aussi là que se tisse une nouvelle étape de l’humanisation.
11 La réflexion philosophique de Bernard Klasen ne s’aventure pas dans cette vertigineuse actualité. Elle rejoint cependant les préoccupations d’aujourd’hui sur l’architecture et sur l’occupation de l’espace, sur l’écologie et le patrimoine, en développant les enjeux culturels, sociaux, philosophiques, religieux et spirituels de cet art d’habiter. Elle éclaire de la sorte les défis de ces chantiers où notre humanité et notre terre ont communauté de destin. Elle ouvre des pistes pour une éthique et une sagesse de l’habiter qui se traduisent en « esthétique de la quotidienneté » comme la décline Laudato si’ . «Il devient difficile de nous arrêter pour retrouver la profondeur de la vie » (§113). Les quinze « excursions » de Bernard Klasen y invitent. Elles donnent au livre sa respiration et le ton d’une méditation qui nous ramène chaque fois à la même nécessité d’un lieu-source ou de référence, un lieu qui nous donne d’habiter. Raconter l’habitat de la sorte, c’est raconter les rapports de l’homme avec le cosmos, avec ses semblables et avec son propre corps, tout ce qui le fait « être au monde ». En soulignant la nécessité et l’urgence d’en traiter les modalités toujours du point de vue de l’homme.
12 C’est l’histoire d’un « jeune de banlieue » (comme ils disent).
13 « Tu peux faire ce que tu veux. Mais bientôt tu ne veux plus rien du tout… Même pas baiser… Encore moins bosser. Tu n’as plus de désirs. Et plus de volonté… Tu végètes… Tu survis. Tu tues le temps comme tu peux et le temps te tue. » Une histoire à pleurer, dans le genre Les Roses blanches de Berthe Sylva ? Pas du tout : un livre drôle, une somme anthropologique-humoristique en quelque sorte. « Tout cela est tragique… mais on rigole quand même ! », conclut l’auteur.
14 La vie de Jean-Pierre n’existe pas, Jean-Pierre n’a pas une vie, car il faut pour cela un minimum d’unité : une adresse fixe (au moins une ville), un travail continu avec des relations stables, des amis durables et (avec de la chance) un amour confiant. Jean-Pierre n’a rien de cela, ni adresse ni travail ni relations ni affections certaines. Ses « copains » basculent en quelques minutes du type « réglo » au « fils de pute » au gré d’une circonstance. Il va de squat en caravane (abandonnée ou « louée »), dort sous le périph’ ou dans une voiture et transforme ses lieux d’habitat en poubelle quand il trouve un local payé par son père. Bref, il n’a pas « une vie », mais « des vies », sautant de l’une à l’autre sans autre logique que le hasard et la recherche de « thune » pour vivre. Vivre : c’est-à-dire pouvoir se payer du shit (il fume une dizaine de pétards par jour… un budget !).
15 Si c’est drôle, ce n’est pas l’effet de l’humour bobo qui se plaît à railler les pauvres, leurs vêtements et leur inculture, mais par une écriture disjonctée qui manie la digression en tout genre, partant sur un mot, une idée, un calembour qui introduit une distanciation romanesque sur le mode linguistique, historique ou politique. Les pauvres manquent d’argent et F. Combes nous sort quatre-vingts mots qui le désignent (p. 60-61), ils manquent de femmes et les disent sous autant de petits noms (p. 103-106) ; « il n’y a pas de fatalité à ce que les pauvres le soient aussi dans le registre du langage ». Les débrouillardises illégales vacillent tout à coup dans la propagande néolibérale, et suivant le conseil présidentiel de « créer sa propre entreprise » quand on est au chômage, nous assistons à la création d’une
Indienne se fait démonter par derrière
Show cam à la bibliothèque
Je lui baise tous ses trous et elle avale tout