Première scène d'une déesse orientale
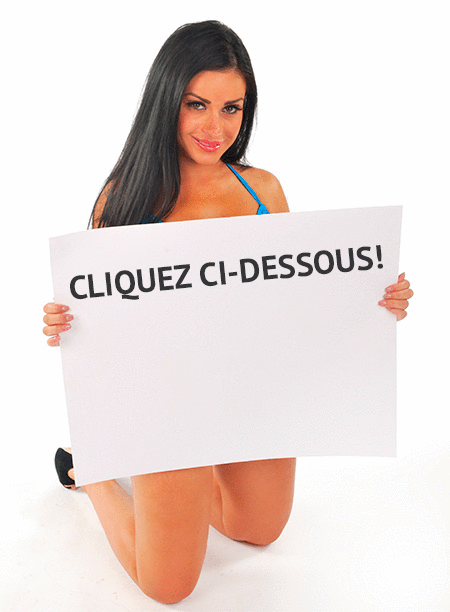
⚡ TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Première scène d'une déesse orientale
Collégien/lycéen Étudiant Professeur
Collège Lycée Ressources pédagogiques
Consulter les espaces
Espaces
Collégien/lycéen
Étudiant
Professeur
Fil d'Ariane
Accueil
Étudier Éros et Psyché dans la classe à travers la littérature et les arts avec Apulée
Psyché, l’âme-papillon (1) : une histoire d'ailes
AddThis est désactivé. ✓ Autoriser
AddThis est désactivé. ✓ Autoriser
Collégien/lycéen Étudiant Professeur
Collège Lycée Ressources pédagogiques
Contact
Crédits
Mentions légales
Accessibilité : non conforme
Pourquoi Odysseum ?
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse s’engage à traiter vos données à caractère personnel dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du RGPD.
Nous sommes particulièrement attentifs à la protection des données personnelles et nous veillons à ce que la collecte de vos données soit réduite au strict nécessaire.
Le site education.gouv.fr utilise l‘outil de mesure d’audience AT Internet pour comprendre le parcours de navigation des utilisateurs afin de vous fournir la meilleure information possible et d’enrichir votre parcours. Cet outil est dispensé du recueil du consentement de l'internaute relatif au dépôt des cookies analytics, l'autorité française de protection des données (CNIL) ayant accordé une exemption au cookie Web Analytics d’AT Internet ( en savoir plus ).
Vous pouvez à tout moment vous opposer à leur utilisation dans la section ci-dessous dédiée à la mesure d’audience.
Certaines fonctionnalités du site (partage de contenus sur les réseaux sociaux, lecteurs vidéos, contenus interactifs) font par ailleurs appel à des services proposés par des tiers. Ces fonctionnalités déposent des cookies leur permettant d’identifier les sites que vous consultez et les contenus auxquels vous vous intéressez. Ces cookies ne sont déposés que si vous donnez votre accord. Vous pouvez ci-dessous vous informer sur la nature de chacun des cookies déposés, les accepter ou les refuser à tout moment. Ce choix est possible soit globalement pour l’ensemble du site et l’ensemble des services, soit service par service.
S’informer sur les cookies et données personnelles du site education.gouv.fr, contacter ou exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données
✓ Tout autoriser ✗ Tout interdire
AT Internet (privacy by design) Ce service peut installer 5 cookies. Weiter lesen - Voir le site
✓ Autoriser ✗ Interdire
AddThis Ce service peut installer 2 cookies. Weiter lesen - Voir le site
✓ Autoriser ✗ Interdire
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse veille à protéger vos données personnelles. Ce site utilise des cookies afin de mieux vous informer et de vous proposer des vidéos, des fonctionnalités de partage et des contenus animés optimisés pour le web. Pour vous assurer une expérience de navigation optimale, vous avez la possibilité d’accepter l’activation de tous les cookies. ✓ Tout autoriser ✗ Tout interdire Personnaliser
πέφυκεν ἡ πτεροῦ δύναμις τὸ ἐμβριθὲς ἄγειν ἄνω...
"C’est la force naturelle de l’aile de mener vers le haut
ce qui est pesant..."
Les monuments figurés, au sens le plus large du terme (sculptures, peintures, bas-reliefs, pierres gravées, monnaies, etc.), éclairent les productions écrites et souvent même en disent plus qu’elles sur les goûts et les croyances populaires de leur époque. Aussi bien que les systèmes philosophiques et les créations poétiques, ils sont les témoins d’un patrimoine culturel qui se transmet par la tradition.
Le mythe de Psyché en est un exemple particulièrement intéressant : l’abondance de ses représentations sur tous les supports montre son extrême popularité. Bien avant les Métamorphoses d’Apulée (env. 125-170), les éléments constitutifs de la fable (au sens étymologique du latin fabula ) d’Éros et Psyché étaient très présents dans l’art du monde grec et romain.
N. B. Toutes les références iconographiques avec leurs copyrights sont citées à la fin de l’article.
En grec, le premier sens du nom féminin ψυχή ( psuchè ) est "souffle", du verbe ψύχω ( psuchô ), "faire passer un souffle sur". Il désigne le souffle de la vie, d’où l’âme, par opposition au corps. Comme on le verra plus loin, il signifie aussi "papillon".
Les poèmes homériques témoignent de la conception la plus ancienne de la psuchè dans le monde grec.
« La psyché joue dans l’existence terrestre un rôle absolument effacé ; repliée sur elle-même en une sorte de sommeil, matière subtile sans siège distinct, elle ne se manifeste que pour se séparer du corps et s’exhaler comme un souffle, psuchè , par la bouche avec le dernier soupir ( Iliade , IX, 408-409) ou par une blessure avec le sang qui s’en écoule ( Iliade , XIV, 518). » ( Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines , Daremberg et Saglio, 1877-1919, article Psychè signé Georges Nicole)
Dans l’ Iliade , on voit ainsi la psuchè du guerrier qui s’envole comme celle d’Hector, tué par Achille : « Le terme de la mort enveloppa Hector ; son âme, s’envolant (ψυχὴ πταμένη) de ses membres, s’en alla chez Hadès, gémissant sur son sort, abandonnant et vigueur et jeunesse. » ( Iliade , chant XXII, vers 361-363, traduction Mario Meunier, 1943)
Sur un grand nombre de vases, de petites figures dotées d'ailes d'oiseau représentent l’envol de l’âme humaine.
Ce type de représentation de l’âme telle un oiseau est certainement très ancien. On sait en effet que dans la tradition religieuse égyptienne, le bénou est l’oiseau représentant l’âme (le ba ) : « le bénou assimilé à l’âme ba des dieux et des hommes est psychagogue des défunts » (Françoise Lecocq, « Phénix, l’oiseau couleur du temps » , sur Odysseum). Cette tradition était toujours très présente dans le monde hellénistique gréco-romain, comme en témoigne le temple d’Isis à Pompéi.
Dans l’ Odyssée , les âmes des prétendants massacrés par Ulysse s’envolent, semblables à des chauves-souris.
« Cependant Hermès appelait à lui les âmes des prétendants. Il tenait en ses mains la belle baguette en or, avec laquelle il charme les yeux des hommes qu’il lui plaît d’endormir ou bien réveille ceux qui sont endormis. Avec cette baguette, il stimulait et conduisait leur troupe ; les âmes le suivaient en jetant de petits cris aigus. De même que les chauves-souris, dans le fond d’une grotte merveilleuse, prennent leur vol en jetant de petits cris aigus, lorsque l’une d’entre elles s’est détachée de leur grappe suspendue au rocher, car elles se tiennent agrippées les unes avec les autres ; de même, les âmes s’avançaient en troupe, en jetant de petits cris aigus. » (Homère, Odyssée , chant XXIV, vers 1-9, traduction Mario Meunier, 1943)
« Condamnée à l’effacement pendant la vie de l’homme, l’âme prend sa revanche au moment de la mort ; [...] la psyché survit. Sans corps désormais, elle en conserve la forme, elle en est l’image, le fantôme ( eidôlon , psuchè kai eidôlon ), semblable aux visions des songes et aux images-mémoire qui expliquent sa genèse. » ( Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines , ibidem)
L’âme du défunt a gardé l’aspect qu’il offrait de son vivant, tel Patrocle apparaissant à son ami Achille, mais elle n’est plus qu’une substance aérienne et volatile.
« Voici que survint l’âme (ψυχὴ) du malheureux Patrocle, toute pareille à lui-même pour la taille, les beaux yeux et la voix, et pareils aussi, tout autour de sa chair, étaient ses vêtements. [...] Achille étendit les bras, mais il ne saisit rien. L’âme, telle une fumée, s’était enfuie sous terre avec un cri aigu. Stupéfié, Achille se leva, se frappa dans les mains, et dit ces mots plaintifs :
- Hélas ! il est donc vrai qu’il existe, même dans la maison d’Hadès, une âme et un fantôme (ψυχὴ καὶ εἴδωλον), mais sans aucun organe corporel. Car, toute la nuit, l’âme du malheureux Patrocle s’est tenue près de moi, gémissante et pleurante ; elle me dictait chacune de ses recommandations, et ressemblait merveilleusement à lui-même. »
(Homère, Iliade , chant XXIII, vers 65-108, traduction Mario Meunier, 1943)
La manière de concevoir la psuchè se développe avec la pensée philosophique. « Les sectes orphiques proclament la nature supérieure de l’âme : le corps n’est qu’un tombeau, une prison, où elle est déchue par l’effet du péché ; l’idéal est de s’en affranchir à jamais, d’où la théorie de la métempsycose : l’âme s'épure par une série de naissances et d’incarnations nouvelles et quitte définitivement sa prison. Cette doctrine est reprise par les théologiens et les penseurs ; Empédocle et Platon en sont pénétrés. » ( Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines , ibidem)
Dans la construction de l’image de la psychè, telle qu’elle apparaît dans la culture occidentale, le rôle du philosophe Platon (env. 428-348 av. J.-C.) est déterminant aussi bien sur le plan des idées que des représentations.
« Platon est le continuateur de tout un ensemble de croyances sur l’âme depuis Homère. La mort est l’événement par lequel la crainte de la disparition et de la corruption de la personne pose la question de ce qu’il reste du "moi". Le terme psuchè chez Homère renvoie à ce "double" du héros, cette ombre épuisée, fantôme sans consistance de la personne morte au combat ; inversement, le sôma , le corps, désigne le cadavre inanimé, que la force vitale de la psuchè a déserté. Mais à partir d’Homère, et en particulier chez les présocratiques, la psuchè gagne en consistance pour désigner cette force vitale elle-même, garante du mouvement du vivant. En ce sens, l’âme est bien inséparable du mouvement qu’elle transmet au corps. Platon fait lui aussi de la mort un événement qui permet de mieux comprendre celui de la "vie". L’âme demeure pour Platon ce qu’elle est pour la majorité des Anciens : un principe vital, une force de tension qui permet au corps de se mouvoir et de croître. » (Olivier Renaut, « Platon : l’invention de la psychologie », Sciences-Croisée s , Aix-Marseille Université, 2010, Soin de l’âme, 7)
Dans un passage célèbre de son dialogue Phèdre , Platon définit ainsi « l’appareil ailé de l’âme » (τὸ τῆς ψυχῆς πτέρωμα, 246e).
« L’âme doit être quelque chose d’inengendré, aussi bien que d’immortel. Sans doute en est-ce assez pour ce qui concerne son immortalité, mais pour ce qui est de sa nature, voici comment il en faut parler : dire quelle est cette nature est l’objet d’un exposé en tout point absolument divin et bien long, mais dire à quoi elle ressemble, l’objet d’un exposé humain et moins étendu. C’est donc de cette façon qu’il faut que nous en parlions. Elle ressemble, dirai-je, à une force à laquelle concourent par nature un attelage et son cocher, l’un et l’autre soutenus par des ailes. [...] Toute âme prend soin de tout ce qui est dépourvu d’âme et, d’autre part, circule dans l'univers entier, en s’y présentant tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Or, lorsqu’elle est parfaite et qu’elle a ses ailes, c’est dans les hauteurs qu’elle chemine , c’est la totalité du monde qu’elle administre. Quand, au contraire, elle a perdu les plumes de ses ailes, elle en est précipitée , jusqu’à ce qu’elle se soit saisie de quelque chose de solide, et, une fois qu’elle y a installé sa résidence, qu’elle a revêtu un corps de terre auquel le pouvoir appartenant à l’âme donne l’impression de se mouvoir lui-même, c’est à l’ensemble formé d’une âme et d’un corps qui est un assemblage, qu’on a donné le nom de vivant, c’est lui qui possède l’épithète de mortel. [...] Envisageons maintenant la cause de la perte par l’âme des plumes de ses ailes et, par suite, de sa chute. Or voici de quelle sorte peut bien être cette cause. C’est la force naturelle de l’aile de mener vers le haut ce qui est pesant , en le faisant monter aux régions élevées qu’habite la race des dieux, et, entre les choses qui se rapportent au corps, l’aile est, en un sens, ce qui, au plus haut degré, participe au divin . Quant au divin, c’est ce qui est beau, savant, bon et tout ce qui est du même genre ; qualités dont se nourrit, dont s'accroît, au plus haut degré même, l’appareil ailé de l’âme . » (Platon, Phèdre , 246a-e, traduction Léon Robin, 1940)
L’aile, signe du divin, joue un rôle essentiel dans l’allégorie platonicienne : elle est la marque et le privilège de l’âme. Si la croyance populaire ancienne imagine la psuchè avec des ailes d’oiseau, les artistes de la période hellénistique la dotent progressivement d’ailes de papillon. Il est fort probable que ce type de représentation puise son origine dans un jeu de mots sur le double sens du nom psuchè : en effet, celui-ci désigne aussi en grec ce que nous appelons "papillon", comme l’explique Aristote (384-322 av. J.-C.).
« Ce qu’on appelle les papillons (αἱ καλούμεναι ψυχαὶ) naissent des chenilles ; et les chenilles se trouvent sur les feuilles vertes, et spécialement, sur le légume connu sous le nom de chou. D’abord, la chenille est plus petite qu’un grain de millet ; ensuite, les petites larves grossissent ; elles deviennent en trois jours de petites chenilles ; ces chenilles se développent et elles restent sans mouvement ; puis elles changent de forme ; alors, c’est ce qu’on appelle des chrysalides ; et elles ont leur étui qui est dur. Quand on les touche, elles remuent. Elles sont entourées de fils qui ressemblent à ceux de l’araignée ; et l’on ne distingue à ce moment ni leur bouche ni aucune partie de leur corps. Après assez peu de temps, l’étui se rompt ; et il en sort, tout ailés, de ces animaux volants que nous appelons papillons (πτερωτὰ ζῷα, ἃς καλοῦμεν ψυχάς). » (Aristote, Histoire des animaux , livre V, 17, 5 – 551b, traduction J. Barthélemy-Saint-Hilaire, 1883)
On voit comment le jeu sur le mot psuchè sous-tend la comparaison entre les deux "créatures aériennes" : l’âme enfermée dans le corps mortel, comme le papillon dans sa chrysalide, prend comme lui son vol au jour de la délivrance.
Le papillon est très présent dans l’art égyptien, du début de la période pharaonique (env. 3000 av. J.-C.) jusqu’à sa fin (env. 100 av. J.-C.). On le trouve aussi bien dans la décoration des tombes, des palais et des temples que sur des objets de la vie quotidienne. Les premiers exemples figurent sur des bijoux datant de la IV e dynastie, sur le site de Gizeh.
Au-delà d’un simple motif décoratif, les papillons avaient sans doute une forte portée symbolique et magique liée à l’au-delà, dont la signification exacte reste encore à déterminer. Certains spécialistes considèrent en effet qu’ils étaient des symboles de régénération destinés à vaincre la mort ou des sortes de talismans aux vertus protectrices.
Comme le grec psuchè , le nom latin anima (f.) signifie "souffle" et "âme" (dont il est l’étymon). Dans la continuité culturelle avec la Grèce, le papillon est aussi le symbole de l’âme dans le monde romain. Une célèbre mosaïque pompéienne en témoigne : on peut y lire une réflexion philosophique d’inspiration stoïcienne sur le sens de la vie terrestre saisie dans sa "vanité".
Dans l’esprit même du memento mori , le papillon est directement associé à l’évocation de la mort : une inscription funéraire provenant de Bétique (région de Séville en Espagne) formule ainsi non sans humour le souhait de faire s’envoler l’âme-papillon ( papilio ) dans l’ivresse, tandis qu’un gobelet du célèbre trésor de Boscoreale met en scène une ronde de squelettes dont l’un tient délicatement sa petite âme-papillon ( psuchion ).
Dans le domaine de la numismatique, on observe aussi la présence du papillon dans certaines émissions de monnaie : sans doute une allusion au principe de l’ anima / psuchè , sans qu’on puisse vraiment expliquer le symbole avec certitude.
On retrouve enfin la présence symbolique du papillon dans plusieurs sarcophages de la période romaine impériale (III e - IV e siècles) en lien avec le mythe de la création de l’homme par Prométhée : ici encore les ailes du papillon représentent "l’appareil ailé de l’âme", pour reprendre les mots de Platon.
Le sarcophage conservé au Palazzo Nuovo des Musées du Capitole à Rome est caractéristique de cette production. En effet, l’un de ses panneaux donne à voir la "fabrication" de l’homme et sa destinée de mortel, déroulées à la manière d’une bande dessinée.
Au centre, Prométhée façonne les corps humains, tandis qu’Athéna, la déesse de l’intelligence et de la sagesse, leur donne l’âme sous la forme d’un papillon. Représentée quatre fois, suivant le cycle de la vie et de la mort, l’âme-papillon est rendue visible sous sa double forme : soit celle de l’insecte proprement dit (dans la main d’Athéna au moment de la naissance et s’élevant au-dessus du corps du gisant au moment de la mort) ; soit celle de la jeune fille dotée d’ailes de papillon (en couple avec l’Amour et guidée par Hermès-Mercure psychopompe), incarnation de la psuchè popularisée par la "fable" ( fabula ) d’Éros et Psyché (voir ci-après).
Une mise en scène très théâtrale, telle qu’on pouvait en voir précisément sur scène, selon le témoignage de Porphyre de Tyr (234-env. 310) : « L’âme végétative une fois venue au jour avec le fruit, le pilote y entre sans y être forcé. Sans doute, comme je l’ai vu au théâtre, ceux qui jouent Prométhée sont forcés de faire entrer l’âme dans le corps alors que l’homme récemment façonné est étendu sur le sol : cependant les Anciens peut-être, par ce mythe, n’avaient pas dessein de montrer que l’entrée de l’âme est chose forcée, ils faisaient voir seulement que l’animation a lieu après l’enfantement et quand le corps a été façonné. » (Porphyre, Lettre à Gauros, sur la manière dont l’embryon reçoit l’âme , XI, 1, traduction Joseph Trabucco, 2006)
Il faut dire que la figure de Prométhée créateur de l’homme connaît au IIIe siècle un regain de succès, dû très certainement au développement du christianisme : comme en témoigne Porphyre, le théâtre, vraisemblablement sous la forme de la pantomime, contribue largement à la diffusion d’une culture iconographique, dont les sarcophages et les mosaïques se font l’écho.
Au papillon en tant qu’insecte vient se superposer la figure d’une jeune fille dotée d’ailes de papillon. En effet, à la place de l’image ( eidolon ) du défunt ailé comme un oiseau, telle qu’on la trouvait dans les représentations archaïques et classiques pour montrer l’âme séparée du corps, on voit apparaître cette nouvelle figure qui devient un motif très répandu à l’époque hellénistique et romaine (à partir du IV e siècle avant J.-C.) dans tout le monde méditerranéen.
Ce nouveau type de Psyché dans l’art d’influence grecque corresp
Andrea se masturbe dans la cuisine
Une compilation de vidéos vintages
Du sexe dans le débarras