Le Maître et ses nouvelles esclaves
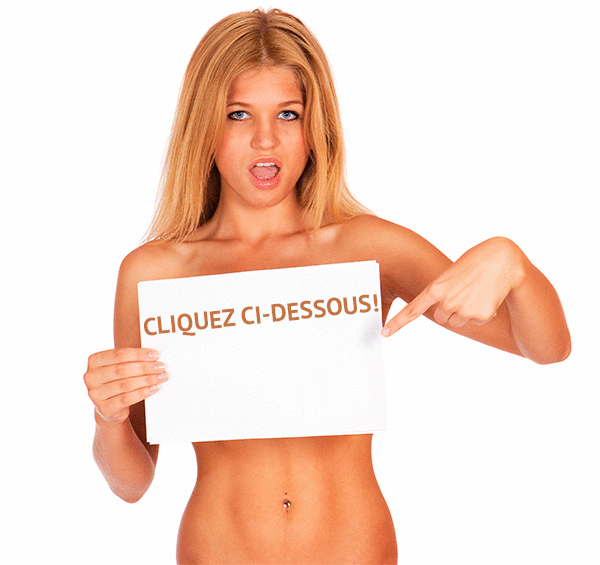
🛑 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Le Maître et ses nouvelles esclaves
3 – Objet de recherche
4 – Sources, méthodes et questionnements
5 – Résumé de la démarche
1 – Les termes désignant les esclaves dans le vocabulaire ottoman
2 – Les termes de l’esclavage et leurs voisins sémantiques
Première partie : le fait servile dans l’Empire ottoman I/ Les fondements juridiques et leur application
1 – Les méthodes légales et inadmissibles d’asservissement
3 – Les droits et devoirs des esclaves et de leurs maîtres (Vous êtes ici)
1 – Litiges autour de l’acte de vente
2 – Les esclaves « autorisés »
3 – Abus et mauvais traitements infligés aux esclaves
FR
|
EN
L’acte d’acquisition entame la relation entre le maître et son esclave : cette relation débute
donc par l’entrée en possession qui est déterminante pour la suite. Le pouvoir du maître sur son
esclave est absolu : il détient un certain nombre de droits et privilèges sur la personne, la
progéniture et les biens de son esclave 184 . Le droit de la guerre et la naissance sont fondateurs du
statut servile : dans le deuxième cas, pour qu’une personne puisse être possédée dès sa naissance, il
faut déjà que ses parents soient en la possession de quelqu’un qui va réclamer cet enfant comme sa
nouvelle propriété humaine 185 . Je propose d’aborder successivement les dimensions mutuelles et
unilatérales des obligations entre esclaves et maîtres : ces obligations sont conçues clairement à
l’avantage des propriétaires, mais apportent un certain nombre de protections aux esclaves.
Néanmoins, cette protection ne diffère pas dans ses grandes lignes de celle de la propriété en
général 186 .
Le pouvoir absolu du maître sur ses esclaves implique qu’« [i]l peut les employer à tel
service ou à tels travaux que bon lui semble. 187 » Le corollaire de ce pouvoir absolu est la
soumission totale de l’esclave dont la volonté et le libre arbitre doivent s’assimiler aux ordres et
exigences du maître : « l’esclave a le devoir de servir loyalement. 188 » En contrepartie, le maître est
dans l’obligation formelle et « morale » « d’assurer l’entretien matériel (nafa aḳ ) » de son esclave :
il a donc le devoir de subvenir à ses besoins en termes de nourriture, vêtement et hébergement 189 . Le
défaut total du maître à remplir ce devoir entraîne comme sanction juridique la vente de l’esclave à
une personne qui dispose des moyens nécessaires et suffisants pour ce faire 190 . Autoriser l’esclave à
travailler pour son propre compte est une première solution, la cession étant l’ultime recours dont il
existe deux formes : la donation pure et simple à une tierce personne et l’affranchissement absolu,
sans que l’esclave contracte une quelconque dette envers son propriétaire 191 . Il s’agit d’assurer le
strict minimum vital au point de vue des obligations du maître sur le plan juridique : assurer cet
184. Mouradgea d’Ohsson, Tableau général de l’Empire ottoman, divisé en deux parties, dont l’une comprend la
législation mahométane ; l’autre, l’histoire de l’Empire ottoman, t. VI-VII : Code Civil, Codes Judiciaire et Pénal,
Istanbul, Les Éditions Isis, 2001 [1788-1824], p. 5.
185. Ibid. Robert Brunschvig, « Abd ʿ », art. cit., p. 27.
186. Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford, Clarendon Press, 1964, p. 127.
187. Mouradgea d’Ohsson, Tableau général de l’Empire ottoman, op. cit., t. VI-VII, p. 6.
188. R. Brunschvig, « Abdʿ », art. cit., p. 26.
entretien matériel a, par ailleurs, la fonction de mettre l’accent sur l’inégalité fondamentale entre les
positions et statuts des deux parties concernées : il ne s’agit nullement d’un partage équitable des
ressources matérielles et pécuniaires du maître et de sa maisonnée 192 . Étant donné que les
propriétaires s’engagent définitivement à assurer l’entretien matériel de leurs esclaves, les esclaves
sont normalement exclus de toute distribution charitable de denrées alimentaires : ils ne peuvent
donc être considérés parmi les laissés-pour-compte, à moins d’être des fugitifs misérables ou des
affranchis indigents 193 . Ce devoir d’entretien matériel comprend toutes les dimensions du bien-être
de l’esclave possédé par un particulier, à commencer par sa santé. À ce titre nous pouvons évoquer
le cas de Mürsel Beg, qui autorisait le 18 rebī ü-l-ā ir ʿ ḫ 1103 / 8 janvier 1692, le chirurgien immīẕ
Ayvā , fils de Tōdōrōs, à opérer son esclave Yūsuf souffrant d’une hernie (ẓ
olmaġla mu arib olubẓṭ ), dans la ville de Konya 194 .
Pour le maître, une autre conséquence directe de son autorité quasi-absolue sur son esclave a
trait à la responsabilité juridique de ce dernier. La responsabilité criminelle de l’esclave en droit est
amoindrie : cette responsabilité n’est pas entière, il essuie généralement la moitié des peines
applicables à des musulmans libres ; les amendes que doivent payer un esclave engagent également
la responsabilité de son maître qui peut opter pour la vente de son esclave condamné afin de couvrir
ce type de frais 195 . Concernant les crimes de sang, en cas de culpabilité de son esclave, le maître a le
choix entre le paiement de la somme due et l’abandon noxal (dafʿ ou noxæ deditio) ; si l’esclave est
victime d’un crime, le maître devient le créancier des coupables condamnés par la justice 196 .
Sur le plan religieux, l’esclave musulman dispose d’« un statut […] en principe identique à
celui de ses coreligionnaires de condition libre » 197 . Néanmoins, le principe d’égalité entre fidèles,
eu égard à leurs statuts juridiques respectifs, n’est absolu que sur le plan théologique et plus
précisément au point de vue sotériologique, dans l’au-delà. Car le statut servile impose de
192. Le Coran, trad. par Denise Masson, Paris, Gallimard, 2005 [1967] (Folio / Classique), vol. I, p. 332 [XVI : 71] :
« Dieu a favorisé certains d’entre vous, plus que d’autres, dans la répartition de ses dons. Que ceux qui ont été favorisés
ne reversent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves, au point que ceux-ci deviennent leurs égaux. — Nieront-ils
les bienfaits de Dieu ? — » Ibid., vol. II, p. 500 [XXX : 28] : « [...] Avez-vous, parmi vos esclaves, des associés qui
partagent les biens que nous vous avons accordés, en sorte que vous soyez égaux ? [...] »
193. Suraiya Faroqhi, Pilgrims and Sultans. The Hajj under the Ottomans. 1517-1683, Londres-New York, I. B. Tauris,
1994 [1990], p. 88.
194. Le document, issu des registres de cadi, a été publié dans Coşkun Yılmaz et Necdet Yılmaz (éds), Osmanlılarda
Sağlık / Health in the Ottomans, [vol.] II: Arşiv Belgeleri / Archival Documents, Istanbul, Biofarma, 2006, p. 209
195. Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, op. cit., p. 127-128. Rudolph Peters, Crime and Punishment in
Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century, New York, Cambridge University
Press, 2005 (Themes in Islamic Law 2), p. 60 et 80. Heyd, Ottoman Criminal Law, p. 97 [art. 8], 108 [art. 51], 287 n. 7
et 288. Yvonne Seng, « A Liminal State: Slavery in Sixteenth-Century Istanbul », in Shaun E. Marmon (éd.), Slavery in
the Islamic Middle East, Princeton, Markus Wiener Publishers, 1999, p. 31.
196. J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, op. cit., p. 128. R. Brunschvig, « Abd ʿ », art. cit., p. 30.
197. R. Brunschvig, « Abdʿ », art. cit., p. 28.
nombreuses dérogations qui vont toujours de pair avec la dépendance stricto sensu de l’esclave à
l’égard de son propriétaire : l’esclave ne peut avoir l’obligation rigide d’accomplir des actes pieux
et rituels nécessitant le déplacement de sa personne comme la prière du vendredi, le pèlerinage ou la
participation à la guerre sainte qui n’est pas un devoir individuel 198 . Les esclaves font partie des
onze catégories de croyants excusés en droit hanéfite concernant ce type d’obligations de piété
nécessitant un déplacement physique : l’obligation rituelle ne devrait pas constituer une tâche
déraisonnable, impraticable ou impossible 199 . La disponibilité permanente de l’esclave vis-à-vis du
propriétaire et de ses exigences prime sur tout le reste.
Les différents types d’affranchissement relèvent de la réciprocité structurante de cette
relation, mais aussi de l’autorité péremptoire et unilatérale que le maître exerce sur son esclave : on
les abordera plus loin dans une typologie complète des issues légales de l’esclavage 200 . Il convient à
l’heure actuelle de passer au traitement de ce qui est du ressort de l’arbitraire pur et simple du
propriétaire à l’égard de son esclave.
L’unilatéralité des droits du maître sur son esclave : la soumission totale au
règne de l’arbitraire
L’analyse des droits et obligations des maîtres et esclaves qui s’articulent dans une
réciprocité parfois relativement équilibrée serait incomplète sans la prise en considération de la
dimension unilatérale de cette relation de domination : l’on pourrait également évoquer les
prérogatives du maître sur son esclave à ce propos. À l’asymétrie évidente entre ces deux positions
opposées et complémentaires à la fois, s’ajoute la distinction entre esclaves de sexe masculin et
esclaves de sexe féminin : sur les uns et les autres, les maîtres ne disposent pas des mêmes droits.
De surcroît, les maîtresses ne disposent pas non plus des mêmes droits que les maîtres sur leurs
propres esclaves : les hommes conservent un statut privilégié à cet égard. La différence des genres,
combinée à l’institution servile, ébranle complètement toute conception d’unité de l’espèce
humaine 201 .
199. Les dix autres catégories exemptées de l’obligation d’assister à la prière du vendredi sont : ceux pour qui l’appel à
la prière est inaudible ; les malades ; les femmes ; les enfants ; les fous ; les aveugles ; les estropiés ; les prisonniers ; les
craintifs (les personnes qui vivent dans la peur des tyrans, des voleurs, etc.) ; les personnes qui font l’expérience de
conditions météorologiques difficiles (Sara Scalenghe, Disability in the Ottoman Arab World, 1500-1800, New York,
Cambridge University Press, 2014 (Cambridge Studies in Islamic Civilization), p. 76).
201. Baber Johansen, « The Valorization of the Human Body in Muslim Sunni Law », Princeton Papers.
Le concubinage légal, institution d’une grande portée sociale, est la seule forme de
« cohabitation licite » entre un homme et une femme en dehors du cadre matrimonial : le seul
critère est que la concubine (sürriyye ou o alıṭ ḳ , d’où vient le français « odalisque ») soit une femme
esclave qui appartient à l’homme qui est en droit d’entretenir des rapports sexuels avec elle 202 . Cette
concubine ne peut être l’esclave de l’épouse de l’homme, même si l’épouse donne explicitement
son aval ; en revanche, il semble qu’il y avait une certaine tolérance concernant les rapports sexuels
qu’entretient un homme avec la femme esclave appartenant à son fils 203 . Une femme possédant un
esclave n’a nullement les mêmes prérogatives sexuelles sur sa propriété humaine : les rapports
sexuels licites pour une femme libre n’ont lieu que dans le cadre matrimonial 204 . L’interdit reste le
même au sujet des hommes esclaves possédés par des hommes 205 . Les interdits qui régissent les
modalités du concubinage légal entre maîtres et femmes esclaves sont comparables à ceux qui se
rapportent au mariage : impossibilité en cas de parenté naturelle ou acquise ; impossibilité en cas de
profession d’une religion païenne par la femme ; inadmissibilité de prendre deux sœurs de condition
servile comme concubines en même temps 206 . En revanche, le nombre des concubines n’est pas
limité par la loi, contrairement à celui des épouses : dans le cas des esclaves, la limite est celle des
moyens financiers 207 . Les enfants qui naissent de ces unions, si le maître ne reconnaît pas
formellement sa paternité, relèvent du même statut juridique que de celui de leur mère ; ils naissent
et demeurent libres en cas de reconnaissance de la part du maître et leur mère acquiert le statut
d’ümm-i veled 208 . Même si cette reconnaissance n’a pas immédiatement lieu, à moins de reconnaître
le nouveau-né comme celui d’un autre père, le maître continue de préserver le droit de reconnaître
le rejeton comme son ayant droit ultérieurement, à sa convenance 209 . Le propriétaire a, par ailleurs,
un certain nombre de « devoirs de continence » envers ses esclaves femmes lorsque celles-ci sont
« nouvellement acquises » :
L’homme qui acquiert une esclave ne doit pas avoir commerce avec elle avant un certain terme, lequel est
d’un mois pour les filles non nubiles ; à l’égard des autres, il doit attendre qu’elles aient éprouvé une
évacuation périodique, ou, en cas de dérangement de santé, l’espace de trois mois lunaires.
C[ommentaire]. Cette continence, istibra, qui doit être absolue, a pour objet de s’assurer pleinement que
l’esclave n’est pas enceinte ; car si elle l’était, le patron ne pourrait user de ses droits sur elle, qu’après la
202. R. Brunschvig, « Abdʿ », art. cit., p. 28-29.
203. Ibid., p. 29. Heyd, Ottoman Criminal Law, p. 100 [art. 22].
204. Mohammed-H. Benkheira, L’amour de la Loi. Essai sur la normativité en islâm, Paris, PUF, 1997 (Politique
d’aujourd’hui), p. 141. Baber Johansen, « The Valorization of the Human Body », art. cit., p. 79.
205. B. Johansen, « The Valorization of the Human Body », art. cit., p. 84.
206. R. Brunschvig, « Abdʿ », art. cit., p. 29.
208. Mouradgea d’Ohsson, Tableau général de l’Empire ottoman, op. cit., t. VI-VII, p. 7. On abordera plus bas le statut
d’ümm-i veled parmi les issues légales de l’esclavage. Cf. I-C-4.
La violation de cette abstinence réglementée constitue un « p[é]ch[é] contre [l]a conscience » et
« les lois de la chasteté » ; « le patron qui est déterminé à vendre une esclave doit également se faire
scrupule de continuer à la voir : il s’interdira tout commerce avec elle. 211 » Le but de ces précautions
est d’éviter que le maître se trouve dans la possibilité de reconnaître l’enfant de la femme esclave
vendue dans le cas où l’accouchement aurait lieu dans les six premiers mois qui suivent la
transaction commerciale 212 . Si une femme esclave est possédée en copropriété, si elle est donc un
bien « commun » (ar. muštarak ; tr. müşterek) d’au moins deux individus, aucun de ces maîtres n’a
le droit d’entretenir des rapports sexuels avec elle : le concubinage est un lien exclusif qui nécessite
un propriétaire unique 213 . En revanche, une fatwa d’Ebū-s-su ūd sous-entend que lorsque lesʿ
copropriétaires d’une esclave étaient un couple marié, l’époux pouvait coucher avec l’esclave avec
l’autorisation ([zevcesi]nüñ i ni ile ta arruf édübẕ ṣ ) de sa femme 214 .
La question des unions mixtes entre libres et esclaves a longtemps fait débat au sein des
écoles juridiques du droit musulman. La position consensuelle des juristes hanéfites représente
l’Ancienne Doctrine (AD) au sein de ce débat : un homme libre peut épouser une femme esclave
qu’il ne possède pas, à condition de ne pas être déjà marié à une femme libre ; la femme de
condition servile peut être juive, chrétienne ou musulmane ; une femme libre peut également
épouser un homme esclave à condition qu’il ne soit pas le sien 215 . Pour qu’un homme libre puisse
épouser sa propre esclave, il faut qu’il l’affranchisse dans un premier temps ; étant donné que la
liberté s’accorde à l’esclave sous condition de mariage, le maître se trouve théoriquement en droit
210. Ibid., p. 10.
211. Ibid.
212. Ibid., p. 8.
213. R. Brunschvig, « Abdʿ », art. cit., p. 27 et 29. Mouradgea d’Ohsson, Tableau général de l’Empire ottoman, op. cit.,
t. VI-VII, p. 22-23. Suraiya Faroqhi, « From the slave market to Arafat: Biographies of Bursa women in the late
fifteenth century », Turkish Studies Association Bulletin XIX/2, 2000, p. 9.
214. Ertu rul Düzdağ (éd.), ǧ Şeyhülislâm Ebussu’ûd Efendi Fetvaları Işı ında 16. Asır Türk Hayatıǧ , Istanbul, Enderun
Kitabevi, 1983 [1972], p. 121 (fetvā n° 548).
215. Mohammed-Hocine Benkheira, « Un libre peut-il épouser une esclave ? Esquisse d’histoire d’un débat des origines
à al-Shāfi‘ī (m. 204/820) », Der Islam 84/2, 2008, p. 246-355. Quant à la Nouvelle Doctrine (ND), à laquelle adhèrent
les autres sunnit
Baise POV et doigtage anal
Jolies lesbiennes baisent ensemble
Baisant sur le terrain de football