La manière dont la table tourne
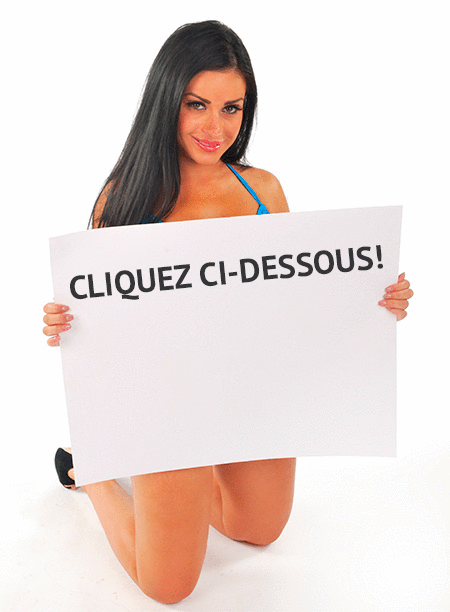
🛑 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
La manière dont la table tourne
Suivez Russia Beyond sur
Facebook
Au début du XIXe siècle, les repas des pomechtchiks, ces propriétaires fonciers russes, constituaient une science à part entière, régie par ses propres lois et règles. Même le moindre détail avait sa signification – ainsi, la place à table réservée à tel ou tel invité traduisait non seulement la nature de ses relations avec le hôte, mais témoignait également de son statut social.
Plus d'histoires et de vidéos passionnantes sur
la page Facebook de Russia Beyond.
Russia Beyond est un média dirigé par l'organisation à but non lucratif "TV-Novosti", 2022. © Tous droits réservés.
En décrivant l’hospitalité russe, le philosophe français Hippolyte Auger disait qu’on pouvait venir à l’heure du déjeuner et se mettre à table sans être invité. En Russie au XIXe siècle , les hôtes offraient toute liberté à leurs invités, mais en même temps ne gênaient pas pour disposer du temps à leur guise et ne pas prêter attention aux visiteurs. Alors en quoi consistait la fameuse hospitalité des pomechtchiks russes ?
Le début du XIXe siècle en Russie est l'époque des propriétaires fonciers et des paysans. Et si le quotidien de ces derniers était extrêmement dur, les pomechtchiks cherchaient à mener une vie somptueuse et organisaient de grands repas qui se déroulaient dans les salles à manger et réunissaient toute la famille autour d’une grande table. Éduqués aux bonnes manières, les domestiques servaient à table les repas qu’eux-mêmes avaient préparés. Les riches propriétaires fonciers se permettaient d’avoir un cuisinier étranger , une occasion de se vanter devant les voisins.
C’est vers midi ou à 13h00 qu’on déjeunait à l’époque. On dit qu’en apprenant que la duchesse Golovina déjeunait à 15h00, Paul Ier a dépêché un officier de police chez cette noble qui lui a alors prescrit d’organiser les repas à 13h00. Quant à l’empereur, il prenait ses repas à heure fixe.
« Pendant les années qui ont précédé la guerre avec Napoléon , on déjeunait en général à 13h00, ceux qui étaient plus importants à 14h00 et seuls les snobinettes déjeunaient plus tard que les autres, mais pas après 15h00 », écrivait l’homme de lettres et fonctionnaire Dmitri Beguitchev.
Les pomechtchiks pouvaient profiter des déjeuners et des dîners pour aborder des questions d’affaires avec leurs invités ou avec le gérant.
La place à table avait une importance cruciale. À sa tête, on trouvait le pomechtchik, la place à sa droite était réservée à son épouse et à sa gauche s’asseyait son invité favori. Plus la place était éloignée, moins important était le rang du fonctionnaire qui l’occupait et plus faibles étaient les liens qui le liaient au propriétaire. Superstitieux, les hôtes veillaient à ce que le nombre de personnes présentes à table ne soit en aucun cas égal à 13.
La manière dont la table était servie était étroitement liée au bien-être matériel des hôtes. Le plus souvent, on se servait de couverts en argent. On sait, par exemple, qu’en 1774 l’impératrice Catherine II a offert à son favori, le compte Orlov, des couverts en argent pesant plus de deux tonnes au total.
Les serviettes dont on se servait à table étaient ornées au milieu des initiales du maître.
Selon la tradition russe, on ne servait pas tous les mets en même temps, mais on les apportait l’un après l’autre. Au milieu du XIXe siècle, cette tradition a été empruntée aux Russes par les Français avant de se propager ailleurs en Europe. Les vins étaient servis après chaque plat à l’exception du « vin ordinaire en carafe qu’on consommait avec de l’eau » ( Art de la table du XIXe siècle , Elena Lavrentieva)
De coutume , c’est l’invité le plus honoré qui était le premier à lever sa coupe. On ne le faisait pas au début du repas, mais après le changement des plats, le plus souvent après le troisième mets. Si l’empereur était présent à table, il portait un toast à la santé de la maîtresse de maison.
Il y avait toute une série de sujets tabous. On ne pouvait ainsi discuter à table des maladies, des domestiques ou encore des relations galantes. En outre, il n’était pas bien perçu de garder le silence à table, ceci pouvant être perçu comme un manque de savoir-vivre ou comme un signe de mauvaise humeur. Il était, en revanche, de bon ton de maintenir une conversation mondaine et décontractée. Si deux personnes assises l’une à côté de l’autre causaient, elles devaient parler fort pour que les autres puissent entendre le contenu de leur conversation.
Si le signe de croix ouvrait le repas, c’est l’apparition des desserts qui le clôturait. À la fin du repas, on servait traditionnellement des fruits, une glace ou des bonbons. Une fois le repas fini, on distribuait des tasses pour se rincer la bouche – cette tradition s’est enracinée en Russie dès la fin du XVIIIe siècle. En se levant de la table, les invités faisaient le signe de croix et c’est l’invité le plus haut placé qui devait être le premier à quitter la table. Maintenant, c’était au tour des invités de convier les hôtes chez eux. Toutefois, cette visite devait avoir lieu durant la période comprise entre le troisième et le septième jour suivant le repas.
Et maintenant nous vous invitons à découvrir les « règles » non écrites des repas contemporains.
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
Recevez le meilleur de nos publications hebdomadaires directement dans votre messagerie.
Ce site utilise des cookies. Cliquez ici pour en savoir plus.
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Afficher / masquer la barre latérale
Sur cette version linguistique de Wikipédia, les liens interlangues sont placés en haut à droite du titre de l’article. Aller en haut .
2.1 Une responsabilité partagée entre les joueurs
2.1.1 Interprétation des personnages-joueurs
2.3 Différences entre un texte narratif et une partie de jeu de rôle
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Article détaillé : Interprétation du rôle .
Article détaillé : Partage narratif .
Article connexe : Topos (littérature) .
↑ par exemple dans Ryuutama ou Apocalypse World
↑ par exemple dans Fiasco
↑ « Podcast JDR : Responsabilité, Positionnement et Machines à Saucisses » [ archive ] , sur La Cellule , 52 min 05–53 min 20
↑ Coralie David et Jérôme Larré , « Je vois (encore) le genre », Casus Belli , Black Book , vol. 4, n o 17, décembre 2016
↑ Tristan et Pierre Nuss , « Nobody's perfect : Et pourquoi je serais pas beau, fort, intelligent et modeste », Casus Belli , Casus Belli Presse, vol. 3, n o 2, septembre 2010 , p. 56–57 ( ISSN 0243-1327 )
↑ Tenga , p. 7
↑ Wuxia , p. 24–25
↑ le cas extrême étant la total party kill , une partie au cours de laquelle les personnages-joueurs se font décimer
↑ « Dossier : le narrativisme », Jeu de rôle magazine , Promenons-nous dans les bois, n o 18, mars 2012 , p. 25 ( ISSN 1964-423X )
↑ Shylock , « Apocalypse World : Le post-apo qui fait table rase », Casus Belli , vol. 4, n o 6, mars 2013 , p. 56–59 ( ISBN 978-2-36328-113-5 )
↑ (en) « What is IIEC? » [ archive ] , sur The Forge Forums , 9 août 2001
↑ (en) « What is Fortune in the Middle » [ archive ] , sur The Forge Forums , 9 août 2001
↑ (en) « Clarify Fortune in the Middle? » [ archive ] , sur The Forge Forums , 2 décembre 2005
↑ Revenir plus haut en : a b et c voir la conférence [vidéo] Le jeu de rôle : une autre forme de littérature de jeunesse ? [ archive ] sur YouTube , section III-3 Intertextualité et stéréotypie (25:22–32:10), Université Paris 13, colloque « La littérature de jeunesse dans le jeu des cultures matérielles et médiatiques : circulations, adaptations, mutations », 24 septembre 2014
↑ Olivier Caïra ( dir. ), Jérôme Larré ( dir. ), Daniel Dugourd et al. , Jouer avec l'histoire , Pinkerton Press , 2009 , 160 p. ( ISBN 978-2-9533916-0-2 ) , « Maléfices. Odeur de soufre sur l'École des chartes », p. 44
↑ Sanne Stijve , « Mon truc à moi… Le jeu de rôle avec des déficients visuels », Di6dent , Plansix, n o 10, janvier 2014 , p. 28–31 ( résumé [ archive ] )
↑ Daniel Dugourd , « Maléfices — Odeur de soufre sur l'École des chartes » , dans Jouer avec l'Histoire , Pinkerton Press, 2009 ( ISBN 978-2-9533916-0-2 , présentation en ligne [ archive ] )
↑ Joseph Young, « Le système et l’espace imaginaire commun » [ archive ] , sur Places to Go, People to Be , 2005 (consulté le 1 er juin 2016 )
↑ Denis Gerfaud ( ill. Pierre Koernig), La Cité des treize plaisirs , Ludodélire , coll. « Miroir des Terres médianes », septembre 1988 , 48 p. ( ISBN 2-907102-03-6 )
↑ Joseph Young, « Le Truc impossible avant le petit-déj’ » [ archive ] , sur Places to Go, People to Be , 2005
↑ sur la linéarité, voir en particulier : Jérôme « Brand » Larré , « MJ Only : La Vie du rail », Casus Belli , Casus Belli Presse, vol. 3, n o 5, février 2011 , p. 60–61 ( ISSN 0243-1327 )
↑ Jérôme Larré, « [théorie théoricienne] Aristote vs Power Girl… » [ archive ] , sur Tartofrez , 29 septembre 2006
↑ Régis Jaulin , Grégory Molle et Mael Le Mée , « Dossier : Les héros ne meurent jamais », Casus Belli , Arkana press, vol. 2, n o 7, avril 2001 , p. 38–49 ( ISSN 0243-1327 )
↑ Blake Snyder ( trad. uctrice), Les règles élémentaires pour l’écriture d’un scénario [« Save the Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need »], Dixit, 2006 , 192 p. , 16 × 24 ( ISBN 978-2-84481-117-2 , présentation en ligne [ archive ] )
↑ Tenga , p. 141–143
↑ Raphaël Bombayl , « Aventures en Oblis », Casus Belli , vol. 4, n o 4, juillet 2012 , p. 183–184 ( ISBN 978-2-36328-109-8 )
↑ (en) Dave Chalker, « The 5 × 5 Method » [ archive ] , Critical-hits, 2009
↑ Étienne Goos, « La Méthode 5 × 5 » [ archive ] , L'Art de la table, 2012
↑ FC , p. 368
↑ « Most games up till then were combat-centric. Adventures centered on fighting. In the horror genre, the weakest conceivable monster is probably a cultist, who is, by definition, just as tough as an investigator (since they're both humans). Something like a werewolf or ghost is fierce enough that a whole novel or movie can be plotted around just one.
It was obvious that Call of Cthulhu needed a different focus beyond combat, so I zeroed in on investigation, which also fit Lovecraft's characters and stories. I basically substituted investigation and research and uncovering of secrets for the combat. » dans (en) Ed Grabianowski, « [ archive ] Call Of Cthulhu Was The First Role-Playing Game To Drive People Insane » [ archive ] , sur io9.com , 9 avril 2015
↑ SW , p. 219–221
↑ FC , p. 4
↑ FC , p. 403–404
↑ Revenir plus haut en : a et b Pierre Rosenthal , « Le début de l'aventure : ou comment impliquer les personnages », Casus Belli , Excelsior , vol. 1, n o HS 25 « Manuel pratique du jeu de rôle », mai 1999 , p. 35–36 ( présentation en ligne [ archive ] , lire en ligne [ archive ] )
↑ FC , p. 368
↑ S. John Ross (trad. Loïc Prot), « La Grande Liste des intrigues de jeu de rôle » [ archive ] , sur FRudge , 30 mars 2007 (consulté le 9 mars 2016 )
↑ Arnaud, « Idées d'aventures » [ archive ] , sur AideDD (consulté le 9 mars 2016 )
↑ la rencontre dans l'auberge, ou la taverne, est un des clichés des jeux de rôle médiévaux fantastiques
↑ Tristan , « Le coin du scénariste : le MacGuffin », Casus Belli , Casus Belli Presse, vol. 3, n o 2, septembre 2010 , p. 60–61 ( ISSN 0243-1327 )
↑ Sébastien Delfino , « Campagne interactive », Di6dent , Plansix, n o 6, septembre 2012 , p. 114 ( lire en ligne [ archive ] ) . Voir aussi « Sandbox : 4] Pour des campagnes interactives… » [ archive ] , sur Memento ludi , 15 novembre 2016 (consulté le 21 novembre 2017 )
↑ Laurent Gärtner, « Gérer le conflit » [ archive ] , sur Aux Portes de l'imaginaire , 15 février 2017 (consulté le 15 février 2017 )
↑ Billy « Moffom » Bécone , « Anatomie d'un scénario », Jeu de rôle magazine , Promenons-nous dans les bois, n o 13, février 2011 , p. 79–81 ( ISSN 1964-423X )
↑ Tenga , p. 34–42
↑ lire par exemple (en) « A front » , dans Apocalypse World basic player refbook & MC playsheets ( lire en ligne [ archive ] ) , p. 29–30
↑ en particulier Gary Gygax , Guide du maître : Règles avancées de Donjons & Dragons [« Dungeon Masters Guide »], Transecom, 1987 avec ses descriptions d'environnements (chapitres Aventure …) et ses listes d'objets, ou encore tous les suppléments sur les mondes de fictions servant de cadre de campagne , comme Glorantha pour RuneQuest
↑ Revenir plus haut en : a et b (en) Kevin Siembieda , Old Ones , Palladium Books , 1993 , 216 p. ( ISBN 0-916211-09-6 )
↑ Graham Bottley et al. , Défis fantastiques, le jeu de rôle [« Advanced Fighting Fantasy »], Scriptarium , 2013 , 340 p. ( ISBN 978-2-9543631-0-3 )
↑ Revenir plus haut en : a et b Jérôme Larré , « Mourir dignement : Acte III, La forteresse » , dans 6 Voyages en Extrême-Orient , Les XII Singes , 2013 ( ISBN 978-2-918045-74-8 ) , p. 58–62
↑ Gary Gygax , Manuel des joueurs : Règles avancées de Donjons & Dragons [« Players Handbook »], Transecom, 1987 , p. 38
↑ Peter C. Fenlon et al. , Manuel des combats [« Arms Law & Claw Law »], Hexagonal , 1989 ( ISBN 2-84188-001-X )
↑ (en) Bill Coffin , Western Empire , Palladium Books , 1999 , 229 p. ( ISBN 978-1-57457-015-1 )
↑ Ian Belcher et August Hahn , Loup Solitaire : L’Encyclopédie du monde [« Lone Wolf, the roleplaying game »], Le Grimoire , 2007 , 332 p. ( ISBN 978-2-95142-087-8 )
↑ Keith Baker et al. , La Mer Intérieure : Cadre de campagne [« The Inner Sea World Guide »], Black Book Éditions , 2011 , 320 p. ( ISBN 978-2-36328-003-9 )
↑ voir par exemple Christophe Debien , « Générateur d'idées », Casus Belli , Excelsior , vol. 1, n o HS 25 « Manuel pratique du jeu de rôle », mai 1999 , p. 57–58 ( présentation en ligne [ archive ] , lire en ligne [ archive ] ) , Jérôme Larré , « 119 intros in medias res » [ archive ] , sur Tartofrez , 9 février 2010 (consulté le 20 avril 2016 ) ou bien S. John Ross (trad. Loïc Prot), « La Grande Liste des Intrigues de Jeu de Rôle » [ archive ] , sur FRudge , 2007-30-03 (consulté le 25 septembre 2017 )
↑ Le Grümph ( ill. Franck Plasse ), Imagia , Les XII Singes , 2013 ( EAN 3770002129180 )
↑ « Imagia » [ archive ] , sur Le GRoG
↑ mentionnons par exemple Steve Christensen, « Adventuresmith » [ archive ] , sur github.io
↑ * [Dessaux 2016] Nicolas Dessaux , « Jouer old school » , dans Mener des parties de jeu de rôle , Lapin Marteau, 2016 ( ISBN 978-2-9545811-4-9 ) , p. 369–370, 376–378
↑ Johan Scipion , « Quickshot », Sombre , Terres Etranges, n o 5, novembre 2015 , p. 16–51 ( ISBN 978-2-9552-9204-4 , ISSN 2118-1411 )
La dernière modification de cette page a été faite le 1 février 2022 à 22:33.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques . En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence .
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc. , organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.
Politique de confidentialité
À propos de Wikipédia
Avertissements
Contact
Version mobile
Développeurs
Statistiques
Déclaration sur les témoins (cookies)
Modifier les paramètres d’aperçu
Pages pour les contributeurs déconnectés en savoir plus
Sommaire
déplacer vers la barre latérale
masquer
Le but des jeux de rôle sur table , et de manière plus générale des jeux narratifs , est de créer une histoire . La manière dont se construit l'histoire utilise des mécanismes qui sont souvent implicites dans le cas des jeux de rôle datant d'avant les années 2000 — les ouvrages contiennent au mieux une section « conseils aux meneurs de jeu » — ou bien qui sont édictés par des règles dans le cas d'un certain nombre de jeux publiés à partir des années 2000 (dont les jeux dits narratifs).
On peut distinguer typiquement trois phases dans l'élaboration de l'histoire :
Dans certains jeux post-2000, les trois niveaux sont mis en œuvre pendant la partie ; dans le cas d'un jeu de rôle « classique » — avec un meneur de jeu et un scénario préparé à l'avance —, les deux premiers niveaux font partie de la préparation par le meneur de jeu, seul le troisième niveau concerne la partie de jeu proprement dite.
Nous présentons d'abord la phase qui concerne tous les joueurs de tous les jeux, donc les phases sont présentées à rebours.
Notons que cet article ne traite pas du « narrativisme » en tant que manière de jouer, mais de la narration quel que soit le style de jeu, y compris « ludiste » ou « simulationniste ».
Dans le jeu de rôle, la narration est issue de l'imagination des créateurs du jeu et des joueurs. Ces éléments issus de l'imaginaire sont mis en commun, partagés :
La naissance de l'histoire est soumise à des contraintes :
La finalité d'une partie de jeu de rôle étant la création d'une histoire, on peut dire que tout ce qui intervient dans la partie — dont les ouvrages de jeu (règles, description de l'univers, scénario), les accessoires (feuilles de personnage, dés, figurines, aides de jeu…), les interventions des joueurs — font partie des mécanismes narratifs ; on retrouve là le principe de Baker-Care « tout est système ». Toutefois, si la finalité (ce que l'on obtient à la fin) est une histoire, ce n'est ne revanche pas nécessairement l' objectif de tous les joueurs : certains veulent relever des défis, d'autres veulent s'immerger dans le monde fictionnel et éprouver des émotions… Tous les éléments n'interviennent donc pas au même degré.
Quel que soit le jeu — de rôle ou narratif — la finalité de la partie est la formulation orale d'une histoire, à plusieurs conteurs. Cette phase est proche du théâtre d'improvisation , puisqu'elle met en œuvre des capacités d'interprétation et d'improvisation avec des contraintes — thème donné, mécanismes de simulation .
Dans sa définition la plus large, on peut dire que
Dans les jeux considérés, l'histoire s'écrit à plusieurs voix, chacun est donc responsable de la « bonne construction » du récit. Un élément important est de limiter la suspension consentie de l'incrédulité : si les participants acceptent des situations inhabituelles et des événements impossibles, en particulier dans les genres fantastiques et de science-fiction , il faut néanmoins une cohérence interne à l'univers fictif, et que les personnages, joueurs comme non-joueurs , aient un comportement plausible.
Une jolie ado se masturbe la chatte
Blonde sexy avec des beaux seins baise un amant
S'étouffer sur votre bite