L’élève prend la queue de l’élève
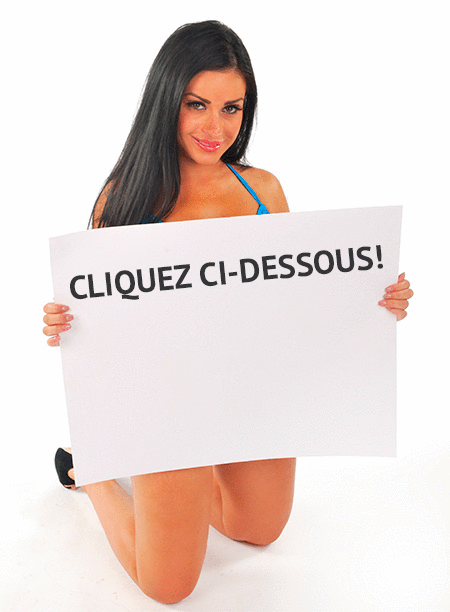
⚡ TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
L’élève prend la queue de l’élève
Notre plateforme utilise des cookies à des fins de statistiques, de performances, de marketing et de sécurité. Un cookie est un petit code envoyé par un serveur internet, qui s'enregistre sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Il garde la trace du site internet visité et contient un certain nombre d'informations sur cette visite. Ces données nous permettent de vous offrir une expérience de navigation optimale.
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Les cookies de préférences permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.
Les cookies de marketing et communication sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification, ainsi que les fournisseurs de cookies individuels.
Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites web pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace. La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission. Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers qui apparaissent sur nos pages. À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement dès la Déclaration relative aux cookies sur notre site web. En savoir plus sur Cairn, comment nous contacter et comment nous traitons les données personnelles veuillez voir notre Politique confidentialité . Veuillez indiquer l'identifiant de votre consentement et la date à laquelle vous nous avez contactés concernant votre consentement. Votre consentement s'applique aux domaines suivants : www.cairn-sciences.info, www.cairn-mundo.info, www.cairn.info, www.cairn-int.info
Déclaration relative aux cookies mise à jour le 11.8.2022 par Cookiebot
Recherche avancée
help_outline Aide à la recherche
Pas encore enregistré ? Créer un compte
Revues Ouvrages Que sais-je ? / Repères Magazines Mon cairn.info
Accueil
Revues
Le Journal des psychologues Numéro 2008/7 (n° 260) Les caractéristiques psychologiques...
Les caractéristiques psychologiques des élèves : la face cachée de l'école
Suivre cet auteur
Martine Alcorta
Dans
Le Journal des psychologues
2008/7 (n° 260) , pages 64 à 67
Précédent
Suivant
Se sentir capable de réussir est aussi important que de posséder réellement les compétences pour réussir.
Se sentir capable de réussir est aussi important que de posséder réellement les compétences pour réussir.
Bibliographie En ligne Ames C., 1992, « Classrooms : Goals, Structure and Student Motivation », Journal of Educational Psychology, 84 (3) : 260-267. En ligne Anderman E. M. et al., 1998, « Motivation and Cheating During Early Adolescence », Journal of Educational Psychology, 90 (1) : 84-93. Bandura A., 1986, Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory, Englewood Cliffs N. J., Prentice Hall. Bandura A., 2002, Autoefficacité ; le sentiment d’efficacité personnelle, Paris, De Boeck. Bressoux P. et Pansu P., 2003, Quand les enseignants jugent leurs élèves, Paris, PUF. En ligne Cosnefroy L., 2004, « Apprendre, faire mieux que les autres, éviter l’échec : l’influence de l’orientation des buts sur les apprentissages scolaires », Revue française de pédagogie, 147 : 107-128. En ligne Covington M. V., 1999, « Caring about Learning : the Nature and Nurturing of Subject-Matter Appreciation », Educational Psychologist, 34 (2) : 127-36. Eccles J. E., 1983, « Expectancies, Values and Academic Behaviors », in Spence J. T. (éd.), Achievment and Achievement Motives, San Francisco, Freeman Press. En ligne Harackiewicz J. M. et al., 1998, « Rethinking Achievement Goals : When are they Adaptative for College Students and why ? », Educational Psychologist, 33 (1) : 1-21. Martinot D., 2004, Le Défi éducatif, Paris, Armand Colin. En ligne Mc Combs, 1989, « Self-Regulated Learning and Academic Achievement : A Phenomenological View », in Zimmerman B. J. et Schunk D. H. (éds), Self-Regulated Learning and Academic Achievement : Theory, Research and Practice, New York, Springer-Verlag. Rollet B., 2007, « Ceux qui sont forts en évitement d’efforts », Cahiers pédagogiques, 429-430. Tajfel H. et Turner J. C., 1986, « The Social Identity Theory of Intergroup Behavior », in Worchel S. et Austin W. G. (sous la direction de), The Psychology of Intergroup Relations, Chicago, Nelson Hall. Vygotski L. S., 1997, Langage et Pensée, Paris, La Dispute.
Maître de conférences en psychologie du développement et de l’éducation, laboratoire de psychologie ea 3662, université de Bordeaux-2
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/12/2010
https://doi.org/10.3917/jdp.260.0064
Précédent
Suivant
file_download Zotero (.ris)
file_download EndNote (.enw)
open_in_new RefWorks
Distribution électronique Cairn.info pour Martin Média © Martin Média. Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
Avec le soutien du
Avec leur soutien
À propos
Éditeurs
Particuliers
Bibliothèques
Organisations
Abonnement Cairn Pro
Listes publiques
Dossiers
Réseaux sociaux
Contact
Cairn International ( English )
Cairn Mundo ( Español )
Cairn Sciences ( Français )
Authentification hors campus
Aide
Chargement en cours. Veuillez patienter...
Attention,
clear
l'identifiant saisi ne correspond pas à un compte Cairn.info.
Attention,
clear
le mot de passe saisi ne correspond pas au compte Cairn.info.
Attention,
clear
erreur à l'authentification.
Vous n’êtes actuellement pas connecté(e) en institution.
You might also want to visit our Cairn International Edition .
Tal vez desee visitar también nuestros contenidos en español en Cairn Mundo .
1 L orsque l’on se penche sur les mécanismes mis en œuvre dans les apprentissages, l’étude de la dimension cognitive est nécessaire mais pas suffisante. Il faut aussi étudier le type d’engagement de l’élève, de ses stratégies et du contexte scolaire.
2 Henri Wallon le disait déjà il y a plus de cinquante ans : « L’école n’est pas seulement l’endroit où l’enfant vient recevoir des bribes d’instruction, l’école c’est la vie de l’enfant. » L’éducation scolaire était à son goût trop intellectualiste, il lui reprochait de négliger le développement des aptitudes sociales pour favoriser uniquement son développement intellectuel. La théorie de H. Wallon apporte à la question scolaire cette dimension psychologique que la théorie de J. Piaget a, en revanche, totalement négligée. Un demi-siècle plus tard apparaissent timidement des préoccupations concernant le développement des compétences sociales des élèves, même si l’intérêt pour les aspects sociaux de la personnalité de l’élève reste encore très limité. Nombreux sont pourtant les travaux de recherche qui montrent une relation inextricable entre les déterminants scolaires, affectifs et sociaux du développement.
3 Selon l’approche sociocognitive de l’apprentissage (Bandura, 1986), les facteurs d’ordre motivationnel (estime de soi, perception de ses compétences, sentiment d’autoefficacité) ont une influence déterminante sur les processus d’apprentissage des élèves. Mais, au-delà des représentations de soi, les représentations du contexte, c’est-à-dire la manière dont les élèves conçoivent leur engagement dans les tâches scolaires (types de buts poursuivis), ont aussi été mises en évidence comme des éléments pouvant agir sur ces processus. Penser d’un point de vue théorique la question de la motivation, de l’effort ou du mérite, non pas comme de simples traits de la personnalité, qui n’engageraient que la responsabilité de l’élève, mais comme une question qui interroge aussi les représentations psychosociales, nous oblige à intégrer les pratiques pédagogiques, éducatives, évaluatives, dans notre réflexion et notre compréhension des comportements observés. La dimension consciente des représentations doit être traitée par une approche globale qui n’exclut ni le sujet ni le contexte. Cette reconsidération théorique des apprentissages devrait nous permettre de faire comprendre aux acteurs du système éducatif qu’un désengagement dans les tâches scolaires, qu’un manque de motivation et d’efforts ne relèvent pas seulement d’attributs personnels, mais qu’ils peuvent être la conséquence de stratégies d’adaptation à un contexte scolaire devenu hostile au développement personnel du sujet.
4 De nombreuses recherches anglo-saxonnes ont montré un lien positif entre sentiment d’autoefficacité et réussite scolaire (Eccles, 1983 ; McCombs, 1989). Plus les élèves sont en réussite et plus leur sentiment d’autoefficacité est élevé. Se sentir capable de réussir dans tel ou tel domaine ou telle ou telle tâche est aussi important que de posséder réellement les compétences pour réussir. Un sentiment élevé d’autoefficacité a également été mis en corrélation avec une plus grande motivation, une meilleure persévérance face aux difficultés et une plus grande potentialité à fournir des efforts. Selon A. Bandura (2002), le sentiment d’efficacité personnelle concerne les capacités subjectivement perçues que l’on pense pouvoir mobiliser pour réaliser des actions spécifiques en vue d’atteindre un certain résultat. Il est clair que les sentiments d’efficacité ne peuvent pas suffire à expliquer, à eux seuls, la réussite d’une personne. Il convient également de prendre en compte ses compétences objectives. Toutefois, les personnes « entreprenantes » se caractériseraient par le fait que leur sentiment de compétence serait un peu (mais pas trop) supérieur à leurs compétences réelles, ce qui aurait un effet dynamisant en amenant ces personnes à se dépasser et à progresser. Comment ne pas envisager qu’à l’école les élèves construisent non seulement des capacités réelles, mais aussi des connaissances, qui peuvent être vraies ou fausses, sur ces capacités ? Comment faire en sorte que ces connaissances ou croyances soient supérieures à leurs compétences réelles pour créer cet effet dynamisant qui pousse les élèves à l’effort et au dépassement de soi ? Le concept de zone proximale de développement emprunté à la théorie de L. S. Vygotski (1997) est essentiellement utilisé pour mettre en lien les capacités réelles avec les capacités potentielles des élèves et déterminer une zone de développement possible. On peut toutefois s’en servir pour concevoir un cadre d’apprentissage qui serait favorable au développement d’un sentiment d’autoefficacité adéquat. Si on propose, en effet, à l’enfant une tâche qui est en dessous de ses capacités réelles, elle peut lui procurer un sentiment de facilité qui ne l’aidera pas à s’attribuer la réussite et ne contribuera pas à renforcer la croyance dans ses capacités. C’est ce qui peut arriver lorsque l’on rabaisse trop les exigences envers des élèves jugés en difficulté. Il n’est pas bon que ce soit la tâche qui surdétermine la croyance dans ses capacités. Mais, d’autre part, si la tâche est au-dessus de ses capacités, l’élève submergé par la difficulté, développera le sentiment de ne plus pouvoir maîtriser le travail scolaire et risquera, à moyen terme, de se résigner et de perdre toute motivation. C’est ce qui peut arriver aux élèves en difficulté qui, à un moment donné, perdent « pied » et décrochent cognitivement des apprentissages. La répétition de cette situation peut même créer de la frustration et engendrer une crainte de l’échec qui peut conduire l’élève à adopter ultérieurement des stratégies d’évitement d’effort. On a alors une surdétermination de la responsabilité individuelle ; ce n’est pas la tâche qui est jugée cette fois cause des difficultés, car celles-ci sont injustement attribuées à ses propres capacités. Une telle situation peut entraîner perte de confiance et dévalorisation de soi dans le domaine scolaire. La vraie motivation ne peut se créer que si la tâche est située dans la zone potentielle de développement qui exige des efforts, une confrontation aux difficultés, dans des limites qui ne dépassent pas les potentialités actuelles de l’élève. Cette situation d’adéquation entre les caractéristiques de la tâche et celles du sujet est propice à développer, chez l’élève, des vécus émotionnels positifs comme un sentiment de fierté ou de satisfaction personnelle indispensable à l’investissement psychique dans les tâches scolaires. On voit bien, à travers cet exemple, comment il est possible d’agir sur le cadre, en l’occurrence, ici, la difficulté de la tâche, pour modifier les dimensions psychologiques de l’élève. Comme le souligne A. Bandura lui-même, le sentiment d’autoefficacité est de manière plus générale le sentiment d’avoir « prise » sur sa vie, sur ses actions, le sentiment d’être « maître » de soi-même. L’abandon psychique de soi-même dans un domaine est à mettre en lien avec l’abandon de l’engagement de la personne dans ce domaine. Si un élève perd à un moment donné le sentiment de pouvoir maîtriser les conséquences de ses actions, il y a de fortes probabilités qu’il se désengage et décroche de ses activités scolaires.
5 L’estime de soi ne se confond pas avec le sentiment d’autoefficacité, car elle est liée au sentiment de valeur propre et non au sentiment de compétence. C’est une dimension psychologique qui prend une double importance. D’une part, elle peut agir comme le sentiment d’autoefficacité sur les apprentissages scolaires et, d’autre part, elle reste une dimension à part entière à partir du moment où l’on refuse de réduire la personne à l’élève, l’enfant à l’élève ou l’adolescent à l’élève. Elle prendra donc dans notre analyse une dimension particulière dans la mesure où nous ne renonçons pas à considérer qu’un élève en difficulté scolaire devrait inéluctablement être une personne en échec, un adolescent dévalorisé et démotivé. C’est pourtant ce que l’on constate en écoutant les discours d’adolescents « sortis » trop tôt du système scolaire et qui nous disent qu’à l’école, ils ont passé leur temps à s’entendre dire qu’ils étaient « nuls ». Peu importe de savoir si on leur a vraiment dit les choses ainsi, notre intérêt portera ici sur : comment faire pour qu’à l’école « avoir un zéro » ne se traduise pas par : « Je suis un zéro, un nul » ?
6 Comme pour le sentiment d’autoefficacité, les corrélations entre estime de soi et réussite scolaire sont positives. Toutefois, selon P. Bressoux (2003), l’estime de soi scolaire diminue progressivement au fur et à mesure que le niveau scolaire des élèves diminue, mais jusqu’à un certain seuil que l’on peut considérer être celui des plus faib
Porno Danois des années 70
Une belle russe se fait brutaliser
Avec ses mains partout sur vous