Isis monte la queue de son amant
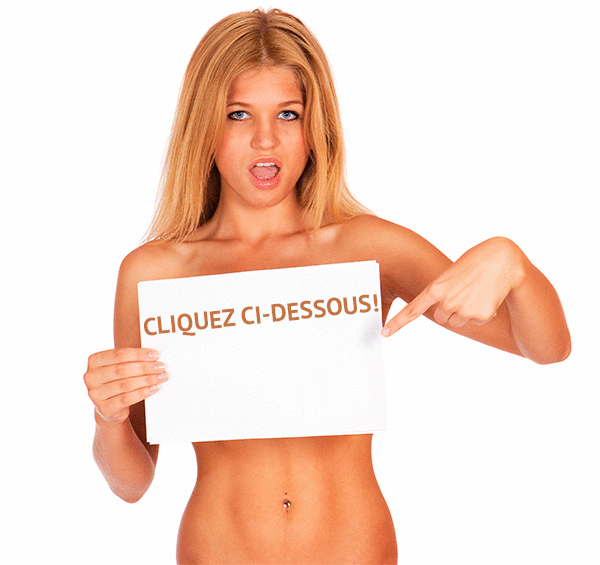
⚡ TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Isis monte la queue de son amant
One more step
Please complete the security check to access www.fictionpress.com
Please stand by, while we are checking your browser...
Please enable Cookies and reload the page.
Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.
If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.
If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.
Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Firefox Add-ons Store .
Cloudflare Ray ID: 738f8fe55cd77b5b
•
Your IP:
Click to reveal
2.59.50.109
•
Performance & security by Cloudflare
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
journal période initiale La Divine Épopée Théophile Gautier Bureau de la Revue des Deux Mondes 1841 Paris V tome 26 La Divine Épopée Revue des Deux Mondes - 1841 - tome 26.djvu Revue des Deux Mondes - 1841 - tome 26.djvu/7 107-126
Dernière modification il y a 6 ans par Hsarrazin
Les Français n’ont pas la tête épique ! — Telle est la plainte déjà bien ancienne et bien usée qui se formule à l’apparition de chaque épopée ; c’est là une de ces assertions en manière d’axiome que nous ne discuterons pas. Toujours est-il que, si les Français n’ont pas la tête épique, cela ne les empêche cependant pas de faire des épopées. On dirait que la nation s’est piquée d’honneur et de tout temps ait essayé de combler cette lacune déshonorante dans notre littérature ; en effet, il est douloureux pour un peuple bien situé sur la carte de l’Europe d’être entièrement dénué de poème épique. — Les Grecs ont l’Iliade et l’Odyssée , les Latins l’Enéide , les Italiens la Divine Comédie , le Roland furieux , la Jérusalem délivrée ; l’Angleterre a le Paradis perdu , l’Allemagne les Niebelungen et la Messiade , le Portugal la Lusiade , l’Espagne l’Araucana , l’Inde Nal et Damayanti , la Perse le livre des Rois ; nous autres nous n’avons rien, c’est-à-dire la Henriade .
Pourtant la liste des poèmes épiques connus en France, à partir de la Franciade de Ronsard tiendrait à elle seule un volume, si l’on avait la patience d’en faire le relevé. Sous le règne de Louis XIII, cette idée de doter la France de l’épopée qui lui manquait agita les cerveaux de tous les poètes : de mémoire nous en citerions une douzaine, la Pucelle de Chapelain, le Saint Louis du père Le Moine, le Clovis de Desmarets, le Moïse sauvé de Saint-Amant, l’Alaric du sieur de Scudéry la Madeleine au désert du père Pierre de Saint-Louis, le Constantin du père Mambrun, le Martel de M. de Boissat, le Saint Paul de monseigneur l’Evêque de Vence, et bien d’autres enfoncés au plus profond des eaux noires de l’oubli, tous parfaits, tous construits selon les lois de l’architectonique, de la symbolique, de l’ésotérique, et autres recettes admirables, chefs-d’œuvre auxquels ne manque, pour pouvoir être lus, qu’une toute petite chose bien dédaignée, bien repoussée aujourd’hui par les mystagogues et les rêveurs à grandes prétentions…. la forme, rien que cela !
Sous l’empire et au commencement de la restauration, il y eut recrudescence d’épopées ; Népomucène Lemercier, novateur malheureux que l’absence de style empêcha d’être un poète, en a fait trois ou quatre à lui seul, l’Atlantide, Attila , les Chants cataloniques, Alexandre, Homère et la Panhypocrisiade , poème bizarre où se joue devant les démons la grande comédie du XVIe siècle. On cite encore le Philippe-Auguste de M. Parceval de Grand-Maison, la Pucelle d’Orléans de M. Lebrun des Charmettes, la Caroleïde de M. d’Arlincourt, la Philippide de M.Viennet.’
Les contemporains ont aussi tenté le poème épique. Il. n’est pas besoin de rappeler aux lecteurs de cette Revue l’Ahasvérus , le Napoléon et le Prométhée de M. Edgar Quinet. M. de Lamartine a fait, outre Jocelyn, la Chute d’un Ange , poème dont l’étendue et le style sont des plus épiques. Il nous semble, d’après cela, que nous ne sommes pas si dénués d’épopées que nous en avons l’air.
M. Alexandre Soumet a-t-il enfin doté la France de l’épopée si impatiemment attendue ? c’est là la question, that is question , comme dit Hamlet.
Nous allons tâcher de faire entrer dans le cadre étroit d’une analyse ce gigantesque poème qui n’a pas moins de deux vol. in-8°.
L’invocation sacramentelle est remplacée par une vision d’apocalypse où le poète voit un aigle symbolique planer et lutter dans un ciel orageux avec une effroyable tempête à travers la noire épaisseur des nuées, l’aigle tâche de diriger son vol vers le soleil ; mais le soleil agonisant pâlit et s’efface, et la tempête triomphante au milieu d’un déluge d’éclairs foudroie l’astre et l’oiseau, car les derniers jours du monde sont arrivés : une plume à demi brûlée s’échappe de l’aile de l’aigle mourant et tombe en tournoyant sur la terre des hommes, et le poète la recueille, comme saint Jean dans l’île de Pathmos, pour qu’elle lui serve à tracer « les récits étoilés de son drame mystique. » - Tu seras peut-être foudroyée de nouveau, s’écrie le poète en s’adressant à la plume, mais nul ne peut se refuser à l’inspiration, et il faut la suivre où elle nous conduit comme Dante suivait le laurier de son maître Virgile ; on n’a pas le doit de désobéir à l’esprit évoqué.
L’univers n’est plus. — Dieu a replié, la création et l’a serrée dans les magasins du chaos, comme une décoration de théâtre quand le spectacle est fini. Il n’y a plus rien que le paradis et l’enfer, pour que l’éternelle justice puisse s’accomplir. — Le paradis a toujours été l’écueil des opéras et des poèmes épiques. Dante lui-même, et MM. Feuchères, Séchan, Dieterle et Desplechins, y ont médiocrement réussi. Notre terre, qui peut fournir d’innombrables variétés de douleurs, est bien stérile en images heureuses. Quand le poète a peint son ciel avec l’outre-mer le plus pur, qu’il a doré ses étoiles et ses auréoles à neuf, qu’il a illuminé à giorno du gaz sidéral le plus éclatant les palais de sa Jérusalem céleste, qu’il a mis un lis de Saron dans la main de chacun de ses bienheureux, qu’il a bourré ses cassolettes et ses encensoirs de toutes sortes de parfums bibliques ignorés d’Houbigant et de Laboullée, il est au bout de ses imaginations, qui ne vont pas au-delà des splendeurs d’un bal comfortable. Le ciel de M. Alexandre Soumet ne vaut pas mieux que les ciels de ses devanciers, et c’est assurément le morceau le plus faible de son poème. Il y a cependant prodigué les roses et les parfums de manière à contenter les nerfs olfactifs les plus exigeans et les plus délicats. Comprenant lui-même que les délices qu’il décrivait ne suffiraient pas à défrayer une éternité de bonheur, il a essayé quelques créations en dehors du monde connu, telles que l’oiseau Alexanor , qui n’a figuré, que nous sachions, dans aucun recueil d’ornithologie. le meloflore ou melosiflore , car ils se trouve écrit de deux façons, qui est, autant que nous avons pu comprendre, une espèce d’arbrisseau musical qui a des gammes et des arpéges pour feuilles, des trilles ou des points d’orgue pour fleurs. Dans quelle catégorie Linnée et Reicha placeraient-ils piano végétal ? Il y a encore un arbre Nialel , d’une botanique suspecte, et une certaine matière baptisée Argyrose , dont sont bâtis les palais des anges, que M. Alexandre Soumet prétend avoir été inconnue aux splendeurs d’Ophyr , et que nous croyons inconnue à des splendeurs moins problématiques que celle d’Ophyr, attendu qu’aucun dictionnaire n’en fait mention. Nous ne parlerons pas du Nictantès , de l’ Ixia , de l’ Osmonde , et autres végétations élyséennes d’une botanique beaucoup trop recherchée. M. Alex. Soumet ne paraît pas savoir qu’une langue s’appauvrit de tout ce qu’on lui ajoute, et que, s’il est permis de créer des mondes, il ne l’est pas de créer des mots.
Dans ce ciel, outre le Père et le Fils, le Saint-Esprit et la sainte Vierge, personnages indispensables et consacrés, le poète en a placé d’autres qui personnifient les vertus et les gloires humaines : Adam et Eve, Jeanne d’Arc, Dante, Milton, Raphaël, sainte Cécile, chantant le Stabat de Pergolèse, plus quelques milliers d’anges musiciens exécutant de colossales symphonies avec accompagnement d’ extaséon , instrument dû sans doute à la fertile imagination de M. Soiumet, car nous ne l’avons encore vu figurer dans aucun orcherstre de ce globe terraqué. Entre les rameaux touffus de ces plantes fantastiques voltigent et sautillent, au lieu d’oiseaux, les ames blanches de lait des petits enfans qui sont morts en venant au monde, et dont les yeux ne se sont ouverts qu’à la lumière céleste.
A la place de ce paradis fiévreux et convulsif, où le poète s’épuise en invention stériles et en mignardises gigantesques, nous aurions mieux aimé un petit paradis gothique tout simple, tout naïf, dans le goût de Giotto ou de Fra Angelico de Fiesole, Dieu le père en habit d’empereur, Dieu le fils en tunique et son manteau traditionnels, le Saint-Esprit, sous la forme d’un pigeon, les pieds et le bec rouges, deux ou trois collerettes de chérubins cravatés d’ailes, quelques anges à longues figures ovales, aux mains fluettes, avec des dalmatiques de brocard et de belles robes blanches se recourbant comme une écume légère autour de leurs pieds d’ivoire, jouant du kinnor, du rebec ou de la basse, une sainte Vierge bien chaste, bien candide, bien étonnée, avec ses grands yeux en amande bordés de cils blonds, exécutés un à un par l’artiste plein de foi et de patience ; le tout sur fond d’or gaufré de fers et d’impressions dans le goût byzantin. M. Taillandier, l’auteur de Béatrice , poème trop peu connu, a su parfaitement s’approprier cette sobriété calme et naïve des artistes pisans qui ont donné à la mythologie catholique des formes dont on ne doit pas s’éloigner lorsque l’on traite des sujets chrétiens, sous peine de dénaturer des types consacrés désormais, et de commettre en quelque sorte une hérésie iconographique : au lieu de celà, M. Alexandre Soumet semble avoir pris à tâche de transporter dans la poésie les conceptions désordonnées de Martin, qui sont plutôt des cauchemars de titans que de l’art véritable.
Un personnage d’invention, Sémida, antithèse d’Eve, dernier effort de la nature expirante, qui réunit en elle seule toutes les perfections de la femme, la seule qui eût pu sauver le monde et devenir la mère d’une nouvelle humanité, s’ennuie beaucoup dans le paradis de M. Soumet. Elle regrette la création évanouie, songe disparu d’un Dieu qui s’éveille à l’aurore de l’éternité ; elle seule, parmi tous les bienheureux, n’a pas perdu le souvenir ; Marie-Madeleine, la plus compatissante de toutes les saintes, en sa qualité de grande repentie, s’inquiète de la mélancolie de Sémida, qui exhale sa tristesse en jouant de la viole au pied d’un mélodore , et elle l’interroge doucement sur la situation de son cœur, Sémida lui raconte que, même dans les splendeurs célestes, il est un nom qu’elle ne saurait oublier, et elle demande à la sainte de prier pour elle ; à quoi Madeline répond fort judicieusement que les élus ne peuvent pas prier l’un pour l’autre, et qu’elle s’adresse au Christ, le grand consolateur des affligés ; Sémida suit ce conseil et dévoile à Jésus les tristesses de son ame ; elle lui avoue qu’elle adore toujours Idaméel, l’amant auquel elle a si vertueusement résisté sur la terre, que le monde en a fini. Or, cet Idaméel n’est autre que l’Antechrist, le dernier né du Caucase, un Prométhée, plus impie et plus audacieux encore que le Prométhée antique ; Idaméel est irrévocablement perdu, il a lutté avec Dieu et détrôné Satan dans l’enfer ; à moins que Sémida ne descende comme Eloa sa cousine vers les sphères infernales et les régions maudites, il n’y a guère de probabilité que les amans se rencontrent jamais. Une grande pitié s’émeut dans l’ame de Jésus à l’aspect de cette douleur que ne peuvent consoler les félicités éternelles ; il prend subitement une grande résolution, et monte l’escalier symbolique qui conduit dans les abîmes de l’incréé. O prodige ! À chaque pas qu’il fait, les stygmates de ses anciennes blessures reparaissent, son flanc saigne, la couronne épineuse de la passion se mêle aux rayons de l’auréole. – Tous les cieux gémissent dans une attente pleine d’anxiété ; les chérubins voilent leur face du bout de leurs ailes ; la sainte Vierge sent se rouvrir les cicatrices faites par les sept points du glaive des douleurs, car une résolutiont errible et suprême vient d’être prise dans le triangle mystérieux, celle du rachat de l’enfer ! Si nous étions des théologiens, nous tancerions d’importance cette imagination qui sent l’hérésie d’une lieue à la ronde, et qui, au moyen-âge, eût fait brûler très proprement tout vif l’auteur qui s’en serait avisé ; mais nous ne somme qu’un poète, et nous nous contenterons de relever les hérésies poétiques de M. Soumet, qui sont assez nombreuses.
Après le ciel vient l’enfer ; c’est dans cette partie du poème que se trouvent les morceaux les mieux réussis, à notre sens, de l’épopée deM. Alexandre Soumet. Selon lui, l’enfer est composé de quatre élémens qui sont la haine, la colère, l’orgueil et la mort. Comme Dante, dont il a bien fait de suivre l’exemple en cela, il divise le royaume funèbre, tout infini qu’il soit, en neuf parts ou cercles. Sans les parcourir les uns après les autres, le poète se contente d’esquisser treize tableaux ou visions, où sont décrits les supplices des principaux damnés ; quelques-uns de ces tableaux sont d’une invention vraiment infernale et d’une exécution vigoureuse, quoique déparés çà et là par l’afféterie et la fausse élégance, défauts passés à l’état chronique chez M. Alexandre Soumet. Parmi ces damnés figure Byron, ce qui ne paraît pas charitable de la part d’un poète ; les gorgones, les chimères monstrueuses, les méduses au regard pétrifiant, les sphinx à l’œil oblique et cruel, toutes les formes repoussantes et hideuses que l’idée du mal a produites en s’accouplant à la perversité humaine, car Dieu ne peut créer que le beau, grouillent, rampent, sautent et fourmillent dans la brume enflammée qui monte incessamment des lacs de bitume et de soufre en fusion. Mais le poète ne s’arrête pas long-temps aux bagatelles de la porte, et va tout droit au trône où siége Idaméel, l’amant de Sémida : seul entre tous les maudits, il a gardé la beauté, beauté pâle et terrible, plus effrayante peut-être que la laideur. Idaméel, qui a vainement, tenté de reculer la fin du monde en tâchant de séduire Sémida, la vierge féconde, la dernière Ève, et de faire ainsi dévier la volonté de Dieu, s’est proclamé roi de l’abîme et n’a eu besoin que d’un geste pour détrôner Satan, qui languit captif dans un coin obscur de l’enfer. Le nouveau monarque a refait le code des tortures avec une supériorité toute romantique ; les vieux supplices ne sont que des délassemens en comparaison ; il sait à fond ce que peuvent produire d’angoisses le plomb fondu, le fer, la flamme, le poison, la glace, le cauchemar ; il trouve pour chacun un tourment spécial, mais il cache à tous le sien, qu’il n’a pas inventé. Bien qu’il souffre une punition égale à son orgueil, aucun : signe ne trahit sa douleur, son masque garde une majestueuse immobilité, et les damnés qui l’épient n’ont pas la satisfaction d’y voir passer l’ombre d’une souffrance. Cependant le cœur d’Idaméel est en proie aux agitations les plus tempestueuses ; des ouragans de blasphèmes, des trombes de désirs furieux labourent ce noir océan sans fond et sans rivage.
La pensée de Sémida l’agite et le torture ; il voudrait s’élancer jusqu’au ciel pour l’arracher du sein de la béatitude, et la faire monter de lui sur le trône brûlant des enfers. — Souvent, le front pensif, il va relire les trois tables d’airain où est écrite en caractères cabalistiques l’histoire de son ame et de son esprit ; c’est tout ce qu’il a emporté d’humain au fond de son ténébreux royaume, et la trace de l’existence du monde ne vit plus que sur ces tablettes mystérieuses. Pour distraire sa mélancolie, Idaméel ordonne une fête, une orgie infernale qui doit dépasser tout ce qu’ont produit de plus violent les énormités cyclopéennes, les vertiges des Lylacq et les monstruosités de Gomorrhe, les raffinemens de Sardanapale et les tigreries de Néron ; tout l’enfer se réveille et se rue aux bacchanales titaniques ; les sphinx sournois, les psylles au vol sifflant, les brucolaques infects, les vampires vermeils les hydres vertes de poison, les briarées aux bras de polype, les chimères aux ailes onglées, les incubes obscènes, les harpies fétides, les mammouths, les dugongs, le dinotherium giganthœum , toutes les formes hideuses et fourmillantes qu’ébauche le cauchemar sur la toile noire de la nuit, se dirigent vers la salle du banquet en toute hâte. Cela rampe, cela vole, cela se culbute dans un pêle-mêle inimaginable, comme dans le Walpurgisnacht-stourm de Goethe.
Après ce repas qui laisse bien loin en arrière les magnificences de Balthazar, les princes des damnés se racontent leurs bonnes fortunes et leurs exploits sur un ton de rouerie et de fatuité supérieures. Celui-là a vendu son ame pour séduire une religieuse, ajoutant à la passion le raffinement du sacrilège ; Néron prend la parole à son tour, et raconte en vers très beaux, que l’on peut ranger parmi les meilleurs et les plus irréprochables du poème, ce célèbre festin où les convives furent enterrés sous une pluie de fleurs. Don Juan explique sa dernière aventure : ce n’est pas, comme on l’a cru jusqu’ici, le commandeur aux talons tonnans, le spectre au poignet de marbre qui l’a fait plonger vivant dans les flammes bleues de l’enfer ; son trépas ne fut qu’un dernier rendez-vous avec une duchesse Esmeralflor de Grenade, morte voluptueuse à qui Satan rend pour une heure la vie et la beauté.
Ces histoires ne manquent pas de saveur ; cependant le sphinx les trouve fades, et voudrait quelque chose d’un goût plus relevé. — Maître, dit-il à Idaméel, absolument comme un jeune poète au génie d’une soirée littéraire, tu devrais bien nous lire quelque chose.
Idaméel, qui n’est point un grimaud, ne donne pas dans le piége vulgaire de débiter sa poésie lui-même ; il envoie trois cents filles de rois chercher les tables d’airain que l’on expose aux regards de l’assemblée. Le sphinx, en sa qualité d’expert aux choses obscures, est chargé d’expliquer les endroits difficiles ; mais, quelque étrange et singulier que puisse paraître le texte, personne n’a le droit de demander des explications au maître.
Sur la première table d’airain est écrite la biographie d’Idaméel ; toutes sortes de présages sinistres ont accompagné sa naissance. Venu au monde par le moyen de l’opération césarienne, il est sorti vivant du sein mort de sa mère. Ce jour-là, son père disparut frappé par la foudre, et, à dater de cette naissance, tous les hymens furent stériles ; ces signes non équivoques montraient que la terre, arrivée à sa décrépitude, touchait au jour suprême. Aucune femme ne voulut d’abord nourrir le petit Idaméel ; mais enfin, il s’en trouva une qui pleurait auprès d’un berceau vide, et qui, émue de compassion, entr’ouvrit sa tunique et le nourrit moins de lait que de larmes et de sang.
Un vieux rabbin juif, retiré dans les grottes d’Eléphanta, résumant sous son crâne chauve toutes les sciences et toutes les sagesses humaines, fit l’éducation du jeune Idaméel ; leur cabinet d’étude était une de ces immenses pagodes souterrain
Cette bite est mon ami, qui me donne du plaisir quand il n'y a pas un homme qui veut le faire
Rousse utilise ses seins captivants pour séduire le manager
Le père de mon amie est un amant exceptionnel