Il est un soulèvement causé par l'esclave
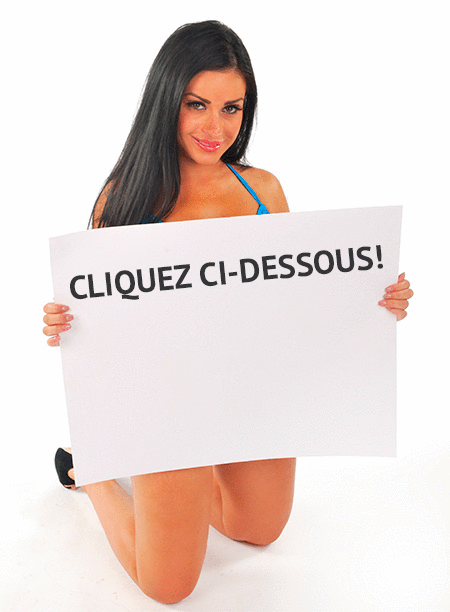
🔞 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Il est un soulèvement causé par l'esclave
العربية
Deutsch
English
Español
Français
עברית
Italiano
日本語
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Svenska
Türkçe
中文
العربية
Deutsch
English
Español
Français
עברית
Italiano
日本語
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Svenska
Türkçe
中文
L'ukrainien est maintenant disponible sur Reverso !
Rejoignez Reverso, c'est gratuit et rapide !
arabe
allemand
anglais
espagnol
français
hébreu
italien
japonais
néerlandais
polonais
portugais
roumain
russe
suédois BETA
turc
ukrainien BETA
chinois
Synonymes
arabe
allemand
anglais
espagnol
français
hébreu
italien
japonais
néerlandais
polonais
portugais
roumain
russe
suédois BETA
turc
ukrainien BETA
chinois
ukrainien
Ces exemples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche
Ces exemples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche
Traduction de "un soulèvement d'esclave" en anglais
uprising
lift
uplift
upheaval
rising
slave
of slavery
of slaves
of a servant
slavish
Le peuple d'Haïti a une histoire profonde de lutte, devenant le premier pays à gagner l'indépendance d'une puissance coloniale européenne par un soulèvement d'esclave en 1804.
The people of Haiti have a deep history of struggle, becoming the first country to win independence from a European colonial power through a slave uprising in 1804.
Pire encore, à l'occasion d'un soulèvement d'esclaves marrons, il fit décapiter l'un des meneurs et menaça de tuer tous les fugitifs - hommes, femmes et enfants.
More serious, he reacted with undue violence towards a maroon uprising by beheading one of the leaders and threatening to kill all runaway men, women, and children.
Considérée comme le plus fort des Maîtres d'Effroi, Bestia s'est fait remarquer pour la première fois en tant qu'apprentie Sith, lorsqu'elle a écrasé un soulèvement d'esclaves sur Ziost, sans aucune aide extérieure.
Perhaps the most powerful of the Dread Masters, Bestia first made a name for herself when, as a Sith apprentice, she singlehandedly crushed a slave rebellion on Ziost.
À l'aube de la Révolution haïtienne en 1791, un soulèvement d'esclaves réussi dans la colonie française, connue alors sous le nom de Saint-Domingue, permit alors à la population locale de prendre le contrôle au gouvernement.
With the dawn of the Haitian Revolution in 1791, a successful slave rebellion on the French colony, then known as Saint-Domingue, allowed the local population to gain control over the government.
En 1656, un grand soulèvement d'esclaves a lieu.
In 1656, a great uprising of slaves took place.
Un important soulèvement d'esclaves a eu lieu le jour de la Saint-Patrick, en 1768.
A major slave uprising occurred on St. Patrick's Day in 1768.
Le site National Historique rassemble des témoins uniques en relation directe avec l'Indépendance d'Haïti, issue d'un soulèvement général d'esclaves déportés d'Afrique.
Unique testimonies directly connected to the independence of Haiti, resulting from a general uprising of slaves deported from Africa, are united here.
En Virginie, les législateurs de l'État et des historiens ont déterminé que Nat Turner, chef de file d'un soulèvement sanglant d'esclaves du XIXe siècle, figurerait parmi ceux qui seraient honorés sur le projet de monument contre l'esclavage.
In Virginia, state lawmakers and historians determined Nat Turner, leader of a deadly 19th century slave uprising , would be amongst those honoured on a planned anti-slavery monument.
L'idée d'un soulèvement des esclaves est repris en 1771 par Louis-sébastien Mercier dans son roman 2440.
Louis-Sébastien Mercier took up the idea of an uprising of slaves in 1771 in his novel 2440.
Selon Louis Ruchame, l'insurrection d'esclaves de Southampton initiée par Turner fut l' un des quelque 200 soulèvements d'esclaves survenus de 1776 à 1860, mais fut l'une des plus sanglantes et sema ainsi la peur dans le camp sudiste.
According to Louis Ruchame, The Turner rebellion was only one of about 200 slave uprisings between 1776 and 1860, but it was one of the bloodiest, and thus struck fear in the hearts of many white southerners.
Les craintes des planteurs de soulèvements d'esclaves augmentent à mesure que la guerre se poursuit.
Planter fears of slave uprisings increased as the war went on.
Les autorités ne peuvent expliquer ces soulèvements d'esclaves intelligents correctement traités et protégés.
Authorities are as yet unable to explain these fresh outbreaks of treasonable disobedience by well-treated, well-protected , intelligent slaves .
A joué un rôle capital lors de plusieurs soulèvements d'esclaves , suggérant un fort engagement politique.
He was instrumental in several slave rebellions , which suggests strong political beliefs.
Les premiers soulèvements d'esclaves eurent lieu.
The first of the slave uprisings took place.
44 ABY Soulèvements d'esclaves généralisés dans toute la galaxie.
44 ABY Widespread slave uprisings spread throughout the galaxy, inspired by the Freedom Flight organization.
Cette révolte est la toute 1ère documentée des soulèvements d'esclaves en Amérique du Nord.
This incident is the first documented slave revolution in North America.
Leader-née, elle participa aux révoltes et aux soulèvements d'esclaves de la province brésilienne de Bahia.
A natural leader, Mahin became involved in revolts and uprisings of slaves in the Brazilian province of Bahia.
Il y a déjà eu des soulèvements d'esclaves par le passé.
We have known slave uprisings in the past.
Les soulèvements d'esclaves et le marronnage ont nourri notre vocation d'êtres libres.
The uprisings of slaves and their running away nurtured our hunger for freedom.
1791 - Premier soulèvement d'esclaves en Haïti suite à la cérémonie de Bois-Caïman.
1791 - Beginning of the Haitian Slave Revolution in Saint-Domingue.
Traduction de voix , fonctionnalités offline , synonymes , conjugaison , jeux éducatifs
Résultats: 8846 . Exacts: 1 . Temps écoulé: 597 ms.
© 2013-2022 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.
L’affranchi devenu général, Toussaint Louverture
La survie économique de l’île dépend des cultures, notamment de la canne à sucre
Caricature de l’indécision napoléonienne ©V. P. playbacpresse
Haïti doit emprunter pour payer son indépendance
Fête des travailleurs indiens. Louis Antoine Roussin, Paul Eugène Rouhette de Monforand ; d’après A. Léon. 1998. Lithographie.
La culture se vit au quotidien, en 5 minutes, pour des journées plus colorées et ouvertes sur le monde qui nous entoure.
Si la vie des esclaves dans les colonies françaises était difficile ( voir partie 1 ), la topographie des îles permettait aux prisonniers de s’évader et de trouver refuge dans les montagnes. On appelait ces esclaves en fuite des « marrons » (venant de l’espagnol « Cimarron » qui désigne les animaux domestiques qui repartent à la vie sauvage. Charmant…). Ils se mêlaient souvent à la population indigène locale, créant des sociétés à part et menant des actions de guérilla contre les planteurs.
Les révoltes avaient généralement à leurs têtes des commandants charismatiques, tels que Makandal et Boukman, qui initièrent respectivement les insurrections de 1758 et 1791 à Saint-Domingue. Cette dernière conduisit à une première tentative d’abolition de l’esclavage français.
Au XVIIIe siècle, Saint-Domingue était la colonie la plus rentable des Caraïbes ! Au niveau mondial, elle était le premier producteur de sucre, et représentait 60% de la production de café et un tiers de celle de coton. C’était le joyaux de la colonisation française et un important pilier de son économie. La population comprenait environ 50 000 personnes libres (blanches et affranchies) pour 500 000 esclaves.
Le 14 août 1791, Boukman, un chef marron, appela à l’insurrection lors d’une cérémonie vaudou . Dans la nuit du 22 au 23 août, esclaves et affranchis prirent les armes et initièrent un véritable massacre. Plusieurs centaines de colons et leurs familles furent tués et près de 200 plantations incendiées.
Au cours des affrontements, un affranchi se distingua par sa bravoure et son stratège. Il se prénomme Toussaint Bréda , du nom de la plantation où il est né esclave, et sera connu plus tard sous le nom de Toussaint Louverture.
En France, la révolution de Saint-Domingue va servir d’argument de campagne, aussi bien aux esclavagistes qu’aux abolitionnistes. L’égalité des hommes étant un principe fondamental de la nouvelle constitution de 1791, le maintien en servitude de millions de personnes dans les colonies est difficile à justifier.
En attendant que l’État français se décide, les soulèvements insulaires se poursuivent. Finalement, la proclamation de l’affranchissement général des esclaves sera déclarée, unilatéralement, le 29 août 1793 par Léger-Félicité Sonthonax . Trois députés, un de chaque « castes » (noir, blanc, mulâtre) seront envoyés en France, afin d’amener la Convention à ratifier l’émancipation. C’est ainsi que, le 4 février 1794 , l’abolition de l’esclavage est entérinée pour l’île de Saint-Domingue, puis élargie à la Guadeloupe et à la Guyane.
Malgré les textes et les beaux discours, l’affranchissement fut compliqué à mettre en place. En effet, comment faire fonctionner une société basée sur l’esclavage sans esclaves ? C’est la question que dut se poser Toussaint Louverture au lendemain de l’abolition.
En 1801, Toussaint rédigea une constitution dont l’article 3 stipulait : « Il ne peut exister d’esclaves sur ce territoire, la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français « . Après l’Emancipation, les anciens esclaves, désormais citoyens français , espéraient pouvoir avoir une terre et cultiver à leur compte.
Néanmoins, la réalité fut toute autre. En effet, l’économie de Saint-Domingue reposait sur la culture des terres . Il était impossible de se débarrasser des planteurs comme ça. Louverture, qui avait lui-même était planteur et avait possédé des esclaves, savait cela. Le héros de la Libération était désormais un politicien, soumis aux réalités économiques de la colonie. Il n’y avait pas d’autres choix pour maintenir l’île à flot. Il fallait que les anciens esclaves, dénommés « cultivateurs » dans la nouvelle constitution, reprennent le travail.
Les droits des affranchis restèrent donc partiellement limités, au nom du principe selon lequel la colonie « ne pouvait souffrir la moindre interruption dans les travaux de ses cultures » (art 14). Pour garantir la collaboration des planteurs français, Louverture dut faire des concessions. Les anciens esclaves vont donc être forcés à repartir travailler sur les plantations , dont le propriétaire aura le statut de « père » et non plus de « maître » (art 15). Il n’aura plus le droit de punir ses cultivateurs et des jours de repos seront obligatoires. En contrepartie, les anciens esclaves ne pourront aller travailler dans une autre plantation, ou à leur compte, sans l’accord de leur « père ». Cette restriction de leur liberté de mouvement a pour but de prévenir un manque de maintenance des cultures, qui entrainerait un déclin économique et serait donc contraire à l’ordre public.
La liberté des citoyens de Saint-Domingue est donc relative. Les esclaves, n’ayant connu que la persécution et l’asservissement pendant 150 ans, reproduisent un système proche de celui de leurs oppresseurs et de l’Ancien régime . La religion catholique est la seule tolérée, le divorce est interdit, l’accent est mis sur l’importance de la famille et sur le rôle du père et du bon citoyen. Toussaint se proclame gouverneur pendant « le reste de sa glorieuse vie » (art 28) et choisit lui-même son successeur. Tout cela ressemble fortement au système royaliste, plébiscité par les planteurs.
En plus de rédiger une constitution pour la colonie, Toussaint Louverture s’assure de la continuité des accords de libre-échange avec l’Angleterre et les États-Unis, met en place un système d’assemblée et fait la guerre à ses voisins espagnols. Ces prises d’initiative et d’autonomie ne plaisent pas au nouveau consul, Napoléon Bonaparte.
Les positions de Napoléon sur l’esclavage demeurent incertaines. Abolitionniste ou esclavagiste, le futur empereur est avant tout pragmatique. S’il est peu enclin au rétablissement de l’esclavage en 1799, les actions de Toussaint et les pressions du lobby pro-esclavagiste l’ont conduit à reconsidérer la question.
L’objectif de Bonaparte est d’agrandir son influence dans les Caraïbes et, pour cela, tous les moyens sont bons. Dans les mémoires qu’il rédigera lors de son exil, Napoléon reconnaitra que deux possibilités s’étaient offertes à lui : reprendre le contrôle dans les Antilles en reinstaurant l’esclavage, puis envahir les îles britanniques voisines, ou valider l’ordre établi par Toussaint et utiliser la force militaire des anciens esclaves pour ses propres desseins impériaux. Il finit par choisir la première option et reconnaitra, plus tard, son erreur .
Le 20 mai 1802, un décret-loi rétablit donc officiellement l’esclavage dans les colonies. Napoléon, ayant anticipé la récalcitrance des anciens esclaves, envoya début 1802 plusieurs expéditions armées dans les Antilles, afin d’y maintenir l’ordre. La plus importante sera la force de 30 000 hommes qui débarquera à Saint-Domingue.
Face à cette armée napoléonienne surentrainée et supérieure en nombre, Toussaint et ses lieutenants pratiquent la politique de la terre brulée : les villes sont évacuées avant d’être incendiées. Cependant, cela ne sera pas suffisant pour ralentir l’armée française. En à peine 3 mois, Toussaint Louverture doit capituler. Il sera déporté en France et décédera le 7 avril 1803 dans sa cellule, dans l’omerta la plus totale.
Alors que la fièvre jaune fait des ravages au sein du corps expéditionnaire français, les seconds de Toussaint attendent leur heure. Réduite à 8 000 hommes, l’armée napoléonienne ne pourra rien face à la nouvelle vague insurrectionnelle menée par Jean-Jacques Dessalines , ancien lieutenant de Toussaint.
La dernière bataille aura lieu le 18 novembre 1803, à Vertières, et verra la capitulation de l’armée française. Le 1er janvier 1804, l’indépendance de la colonie est proclamée. Elle prend le nom d’Haiti et devient le premier État libre à émerger suite à une révolte d’esclaves .
Le séisme que provoqua l’indépendance d’Haiti dans les Caraïbes ne se répercutera pas dans les colonies voisines de la Guadeloupe et de la Martinique. Il faudra attendre la deuxième République, et le travail acharné de Victor Schoelcher , pour qu’une seconde abolition soit décrétée le 27 avril 1848 .
Le texte prévoyait que l’affranchissement général se ferait deux mois après réception du décret par chaque colonie, afin de permettre une transition en douceur pour les planteurs. Cependant, les gouverneurs locaux furent contraint d’annoncer prématurément l’abolition à la Martinique et en Guadeloupe afin de prévenir un soulèvement. L’esclavage fut donc officiellement aboli, dans ces îles, respectivement les 22 et 27 mai . En Guyane et à la Réunion, les délais initiaux furent maintenus, la colonie insulaire étant la dernière à libérer ses esclaves le 20 décembre 1848.
Si la nouvelle de l’abolition et l’indépendance d’Haïti semblent un pas dans la bonne direction, la libération de millions d’esclaves eut néanmoins un coût. Littéralement.
Ainsi, la nouvelle république haïtienne se retrouva, dans ses premières années de vie, commercialement ostracisée par la France. Les États-Unis isolèrent également la jeune nation de peur que des idées abolitionnistes ne se répandent sur leur sol. Il faudra attendre 1825 pour que le roi Charles X accepte de reconnaitre l’indépendance de la nation haïtienne, sous certaines conditions.
En effet, la France demanda en échange une compensation financière pour la perte de ses esclaves, le massacre des blancs lors des soulèvements et la perte des plantations par les propriétaires français. Après discussion, la somme de 90 millions de francs fut convenue, soit environ 18,5 milliards d’euros actuels. Pour pouvoir payer, les haïtiens durent contracter des prêts auprès de banques… françaises ! Pour venir à bout de cette somme colossale, de nouveaux impôts vont être levés. La première dette, celle de l’indépendance, sera acquittée en 1883. Cependant, il faudra attendre 1952 pour venir à bout du remboursement des intérêts des emprunts. Soit 127 ans de paiement…
Pour beaucoup de contemporains, l’indemnité imposée par la France a contribué à la pauvreté actuelle d’Haïti. Les revenus annuels de la nation partaient parfois jusqu’à hauteur de 80% dans le remboursement de la dette, au détriment du dév
Rousse baise en publique
Jeune nympho dans un group de mecs
Grosse bite noire pour une femme asiatique