Dévastation anale à la maison
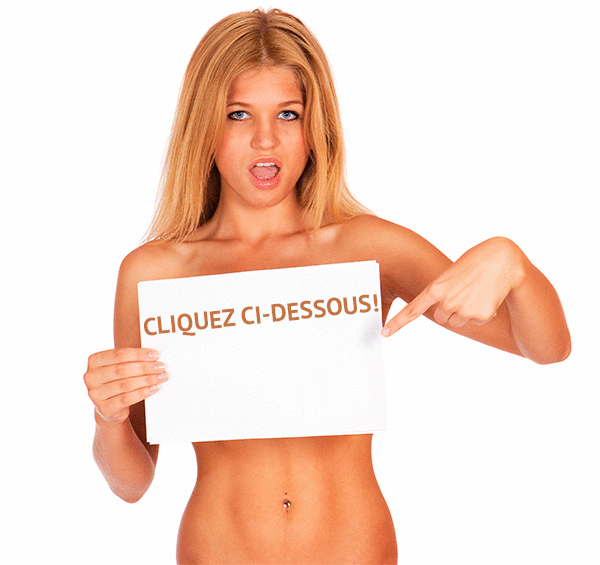
🔞 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Dévastation anale à la maison
Home mieux-connaitre Ménopause Et Démangeaisons Anales et Ménopause Acupuncture
You have entered an incorrect email address!
Please enter your email address here
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.
L’aspect corporel et l’humeur touchés La ménopause est aussi des effets sur la forme du corps. Les mamelons diminuent de taille et perdent leur avoir la possibilité de érectile, seins se transforment et deviennent essentiellement constitués de graisse. C’est également une période où une prise important survient, pour plusieurs de laquelle l’une est liée à la carence en œstrogènes: leur absence entraîne une augmentation du nombre la taille des cellules graisseuses à l’échelle de l’abdomen. La peau se modifie aussi. C’est d’accord l’organe qui, après l’utérus, est sensible aux œstrogènes, spécialement au pas du visage. Le déficit en œstrogènes va accentuer le vieillissement cutané dans assèchement et amincissement de la peau, perte d’élasticité et accentuation des rides. La pilosité et la chevelure ne sont pas d’ailleurs épargnées. Les cheveux deviennent cassants, leur densité diminue, quelquefois jusqu’à l’alopécie. De même la pilosité pubienne et celle en or échelon des aisselles se raréfient. En revanche, une pilosité à rez de la lèvre supérieure et sur les joues faire son apparition. Le déficit en œstrogènes va accentuer le vieillissement cutané selon assèchement et amincissement de la peau, perte d’élasticité et accentuation des rides. L’humeur aussi être affectée chez l’arrivée de la ménopause. Les adénome sexuelles ont d’accord la faculté d’agir sur des régions cérébrales impliquées a l’intérieur du contrôle des émotions et du comportement. Troubles de l’émotivité, anxiété, irritabilité, fatigue ou bien dépression concernent 40% des femme ménopausées. Par ailleurs, œstrogènes ont un effet neuroprotecteur. Leur absence est donc un impact sur les performance cognitives et encourage le déclin cognitif. Quant à la sexualité, la ménopause ne l’empêche pas mais peut la perturber. Chez certaines femmes, elle peut d’ailleurs induire ainsi qu’à accentuer des troubles et provoquer une perte de libido. La carence oestrogénique peut diminuer la sensibilité et spécificité du clitoris et pourquoi pas au contraire l’augmenter à outrance. La sécheresse vaginale et la dyspareunie qui en découle peuvent redonner difficiles rapports. Enfin, les troubles urinaires tel que l’incontinence motiver l’évitement des relations.
AVANT LA MÉNOPAUSE : LA PÉRIMÉNOPAUSE La ménopause se positionne progressivement après une période charnière : la périménopause qui durer de de de deux ans ans à quatre ans. La périménopause se manifeste selon : une alternance de tricycle courts et longs : les méthodes sont irrégulières ; un syndrome prémenstruel (avant règles) : seins sont tendus et l’humeur est irritable ; premières bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. Ces symptômes surviennent, en général, vers l’âge de 47 et sont dus à une carence en hormone progestérone, l’une des principales ganglion féminines. La sécrétion d’œstrogènes est préservée. Quelle contraception en périménopause ? L’éventualité d’une grossesse diminue avec l’âge par contre une grossesse reste vraisemblable même la ménopause. Comme l’âge de la ménopause varie d’une demoiselle à l’autre et ne peut pas être déterminé individuellement, la contraception doit être poursuivie à la certitude de la ménopause. En période de péri-ménopause, le vous proposer l’arrêt de la contraception hormonale et son remplacement par une contraception « barrière » afin de suivre l’évolution des règles jusqu’à leur arrêt. Les méthodes naturelles de contraception ne sont pas indiquées en raison de l’irrégularité des vélocipède et du risque d’échec. Si vous approchez de la ménopause, soyez vigilante sur : initial symptômes d’une éventuelle grossesse en cas d’arrêt ou d’erreur d’utilisation du contraceptif, la survenue des liminaire signes de la ménopause. N’oubliez pas que le seul moyen de prévenir IST est le préservatif. LES SYMPTÔMES LORS DE LA MÉNOPAUSE La ménopause s’accompagne fréquemment de troubles dits climatériques (symptômes qui accompagnent les modifications hormonales associées à l’arrêt de la fonction ovarienne) desquelles l’intensité varie selon les femmes. Ces symptômes sont dus à la carence hormonale en œstrogènes et en progestérone. Ils ne sont pas systématiques et certaines femmes y échappent complètement. Ces troubles climatériques sont : des bouffées de chaleur ou bien bouffées vasomotrices (présentes chez huit femmes sur dix). Ces signe se traduisent par une brusque sensation de chaleur de tout le corps, suivie d’une rougeur notamment de la face et du cou, de sueurs frissons. Brèves, bouffées de chaleur durent rarement plus de quelques minutes. Elles peuvent être occasionnelles ainsi qu’à survenir plusieurs en heure. Elles se manifestent particulièrement la nuit et perturbent le sommeil. Elles apparaissent aussi la journée : elles sont alors favorisées chez la chaleur ambiante, la prise d’un repas, l’alcool, l’exercice et l’émotion ; des sueurs couche-tard isolées dépourvu bouffées de chaleur ; des symptômes génitaux disposant d’une sécheresse vulvovaginale, une dyspareunie (douleurs pendant les rapports sexuels), une diminution de la libido (baisse du désir sexuel) ; des échauffement ou bien puanteur urinaires plus fréquentes ; des souffrances de tête, une fatigue, des insomnies, une irritabilité, de l’anxiété ; des articulaires, diffuses et changeantes, plus marquées a.m. et diminuant après le dérouillage matinal. Certains troubles climatériques comme bouffées de chaleur, sueurs, fatigue… peuvent être transitoires, cependant persistent de temps en temps d’or cours de la ménopause. D’autres sont durables comme la sécheresse vaginale, les troubles urinaires.
Le diagnostic de la ménopause repose sur l’absence de règles 12 mois chez une femme d’environ 50 ans. Aucun positif n’est, est priori, nécessaire dans ce cas. En de doute, le médecin peut recourir en or « exercice à la progestérone ». Cela consiste à prescrire cette hormone 10 jours pendant mois, pendant trois mensualité d’affilée. S’il s’agit d’une ménopause, la logique ne réapparaissent pas. Les posologie hormonaux sont ordinairement inutiles la prise en compte de l’âge et des symptômes cliniques suffisent. Qu’appelle-ton ménopause précoce ? On parle de ménopause précoce lorsque celle-ci survient l’âge de quarante ans. Celle-ci être naturelle ou bien provoquée parmi un traitement (ablation des ovaires, chimiothérapie, radiothérapie, pendant exemple).
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Je suis Lila et je partage avec vous mon expérience de la ménopause qui est arrivé pour ma part à 51 ans. J’espère que grâce à mon expérience vous arriverez à passer aux mieux cette expérience qui est inévitable et parfois pas facile à affronter.
7d3d0f81-21b2-11ed-b701-4b6352715559
I keep getting the "Please try again" message
Access to this page has been denied because we believe you are using automation tools to browse the website.
This may happen as a result of the following:
Please make sure that Javascript and cookies are enabled on your browser and that you are not blocking them from loading.
Reference ID: #7d3d0f81-21b2-11ed-b701-4b6352715559
Adolescences et violences dans la scène primitives
psychologue, psychanalyste, président du Collège international de l’adolescence (CILA), professeur à l’université Sorbonne Paris Nord, unité transversale de psychogenèse et psychopathologie (UTRPP).
Ne jamais séparer les dimensions sexuelles et agressives mais au contraire toujours chercher les creux de l’une qui pourraient être masqués par les aspérités de l’autre, telle est la perspective que je vais déplier ici à travers l’exploration de la situation de Miguel et de ses parents. Le dialogue narcissique interminable entre mère et fils maintient un niveau d’excitation permanent qui n’est pas sans évoquer ces séparations impossibles, quand la fragilité de la permanence de l’objet implique une reprise récurrente de la présence de l’objet par des actes agressifs et violents les plus divers, dans un corps à corps plus érotisé qu’il n’y paraît.
J’envisage trois pistes de réflexion : lorsque Freud (1905) s’intéresse à l’adolescence et à ses transformations psychiques, il considère que la plus douloureuse tâche du processus consiste à « se soustraire de l’autorité des parents » ( Ibid , p. 137), ce qui implique une désensualisation progressive du lien aux figures parentales. Freud prend l’exemple d’une jeune femme névrosée qui masque ses désirs oedipiens par sa tendresse exagérée envers les parents et se dérobe ainsi à la rencontre sexuelle génitale ; il ajoute que c’est aussi « à la grande joie des parents » que la jeune fille reste attachée à ses parents. L’idée de parents trop tendres, participant à la genèse de la névrose ultérieure, indique que l’enfant reste un jouet érotique pour le parent bien au-delà de l’enfance. Une mère qui ne peut « résister » aux demandes de son fils adolescent maintiendrait une source actuelle de tendresse qui, trop érotisée, participe du maintien des désirs incestueux « à vif », entravant le retour du refoulement propre à une fin d’adolescence potentielle.
Dans un registre plus archaïque, les familles à transaction pathogène incluent un lien d’inter-dépendance sur fond d’indifférenciation psyché-soma (Houssier, 2011). Ce fantasme de corps commun s’inscrit dans des liens incestuels anti-pensée relevant de l’articulation agir-faire agir. Dans Les temps modernes , le personnage de Charlot se retrouve passivé dans les rouages d’une immense machine à broyer la psyché, dans un engrenage anti-symbolisant le transformant de sujet en objet manipulable. Cette machine qui l’agit le fait ensuite agir comme une machine dans la rue, où il ne peut pas s’empêcher de visser tout ce qu’il trouve avec une pince dans chaque main, confondant in fine les seins d’une femme avec les boulons d’une machine. En suivant Klein et Racamier (1995), être agi dans le sens de l’identification projective, puis agir-faire agir s’articule donc avec des fantasmes anti-fantasmes, sur fond d’indifférenciation sujet/objet. Enfin, si on suit le fil d’une forme de communication, ici mère-adolescent, le propos de Winnicott revient sur le devant de la scène : la délinquance est le signe d’une carence émotionnelle précoce liée à une communication inconsciente. La délinquance trouve son équivalent non pathologique dans l’éducation : « un enfant normal, s’il a confiance en son père et en sa mère, arrache toutes les limites » et « …le premier travail de l’enfant est de tester le cadre, surtout s’il a des doutes quant à la stabilité du cadre parental familial » (Winnicott, 1957, p. 115). L’impossibilité d’élaborer la perte voire la disparition de l’objet constitue le fil rouge des violences tant verbales que physiques qui traversent cette famille (Houssier, 2014).
Miguel a quinze ans. Ses parents, qui l’accompagnent à mon cabinet, décrivent d’emblée l’enfer quotidien qu’il leur fait vivre, notamment par la multiplicité de ses actes transgressifs (vol de portable, de chéquiers, fugue, violences intrafamiliales), des conflits incessants accompagnés d’injures, et d’une dynamique de déscolarisation qui les préoccupe. Monsieur est agent immobilier, Madame est infirmière. Le contact avec Miguel est de bonne qualité ; plutôt intelligent, son propos s’arrête néanmoins assez rapidement, sans association consécutive ; à une question posée, il me répond souvent par un « Je ne sais pas », appuyé par une moue dubitative évoquant un manque de réflexivité. Après quelques séances, il interrompt les entretiens avec moi. Miguel me donne l’impression de ne pas pouvoir s’intéresser à son monde interne, au profit d’un mouvement projectif destiné à témoigner des injustices que ses parents lui font subir, en miroir de leur plainte. L’accroche transférentielle s’effectuera cependant du côté parental, en dépit de l’apparente hostilité maternelle. Les parents désirent poursuivre les consultations et il est convenu de la possibilité pour Miguel de revenir quand il le souhaite. La consultation thérapeutique familiale se met en place toutes les semaines, d’autant qu’une thérapie familiale incluant la sœur aînée de Miguel a échoué. Les parents expliquent que cette thérapie a été désertée par Miguel, contribuant à la rendre impossible. Un peu plus tard dans la prise en charge, la mère débute une psychothérapie.
Miguel et sa sœur ont été adoptés dans le même pays d’Afrique, Madame étant stérile sans que ses explications à ce sujet me permettent d’y voir clair. Le récit des débuts de la vie de cet enfant dont Madame fait le récit, est émaillé des ruptures du lien. A six mois de grossesse, sa mère biologique vient à l’hôpital dans le but d’avorter, les raisons de cette demande d’avortement restant inconnues. Pendant deux semaines, Miguel est pris en charge par une nourrice pour être ensuite placé dans un orphelinat. Puis, cinq semaines plus tard, ses parents adoptifs viennent le chercher. « C’était un bébé en colère », commente la mère. Pendant les neuf premiers mois en France, ce bébé malingre et fragile hurlait même après être rassasié. Les propos de Madame soulignent l’impossible apaisement de ce bébé, vécu comme l’expression d’une critique envers elle, s’offrant comme miroir de ses propres défaillances, au moment où l’adolescence de leur fils met à l’épreuve de nouvelles fonctions parentales (impuissance parentale). Sa mère précise également qu’il souffre encore d’ enbedment , il se berce en se balançant avant de s’endormir ; évoquant sa chambre, elle relate que le sol de celle-ci est jonché de détritus et d’objets divers, cette incurie s’accompagnant de la présence d’objets provenant parfois de vols ou d’objets troqués. Elle se plaint avec virulence de ce qu’il leur fait subir, la famille devient un champ de dévastation. « Je n’en peux plus, il me bouffe », dit la mère en écho de son fils insatiable, avant d’ajouter une formulation condensant des aspects à la fois cannibalique et sensuellement anaux : « Il me susurre mon argent ». Pourtant, je remarque qu’après la tempête pulsionnelle maternelle et les préoccupations concrètes du père – où Miguel va-t-il aller, que va-t-il faire -, d’autres aspects apparaissent, souvent en fin de séance. Ainsi, tout en écoutant leurs souffrances quotidiennes, j’entends un jour une nuance sonore : alors que j’ai cessé de vraiment entendre la plainte répétitive de la mère, je l’entends à nouveau, d’une autre façon : sa colère se mue progressivement en complainte, une sorte de gémissement qui m’évoque la protestation d’un nourrisson, à la façon d’un bébé qui geint. Transférentiellement, ce bébé qui geint, d’une voix plus douce mobilise davantage d’empathie que le bébé furieux et revendiquant, lui plus souvent présent dans le discours maternel.
Miguel finit toujours par faire échouer toute tentative d’éloignement du domicile familial (foyer, vacances, séjour éducatif) pour mieux retrouver ses parents à la maison. Il lui arrive de faire irruption dans le cabinet médical de sa mère, interrompant ses consultations, pour lui réclamer de l’argent, ou encore de la suivre dans la rue avec un de ses copains. Les parents sont sensibles à l’humour, ce qui me permet un jour de m’exclamer à l’adresse de la mère, à la façon d’un jeu psychodramatique : « Mais quelle formidable histoire d’amour entre votre fils et vous ! ». La mère réagit alors, émue, avec un sourire jusqu’aux oreilles, elle entend… sur le moment. Elle associe sur le fait qu’elle ne peut pas résister aux demandes de son fils, elle sait bien mais quand même, ou encore « c’est l’amour fou » me dit-elle, alors que d’un autre côté, Miguel traite son père de « pédé » ou de « tantouze ». Miguel laisse aussi des messages, des signaux agis plutôt que parlés ; la mère s’étonne qu’il a pris un biberon pour manger sa soupe, souriant du fait qu’il n’a pas trouvé la tétine. Cette séquence m’évoque la souffrance de Miguel : le bébé qui vit en lui sait où se trouve le sein, mais ne sait pas comment le rendre conforme à ses attentes et ses désirs ; la déception répétée produit chez lui une colère à la hauteur du désespoir ressenti. Un peu plus tard, il laisse en évidence trois photos de lui bébé : dans les bras de sa mère, puis nourri au biberon par une cousine paternelle et maternelle. « Mais il cherche à communiquer avec vous, il continue de vous chercher », leur dis-je en pensant à une forme de communication primaire mêlant agressivité et séduction.
Les plaintes réciproques de Miguel et de ses parents maintiennent un lien serré nourri au lait des reproches justifiant l’impossibilité à pouvoir se « lâcher » mutuellement. « Je me rends compte que je ne peux pas tout faire, être éducateur, mère, père, assistante sociale, médecin. Il faut que je lâche quelques fonctions », avoue la mère. Le père sourit alors, semblant soulagé de pouvoir se déculpabiliser face aux difficultés de sa femme. Ils s’accusent mutuellement de diverses défaillances éducatives. Lorsque le père est sous la douche, Miguel lui vole sa carte bleue pour retirer de l’argent, pour acheter divers objets et vêtements de marque. Lorsque j’interroge le lien à l’argent, le père indique : « Je laisse ma femme s’occuper de ma carte bleue, ça lui fait plaisir », dans une position passive qui s’articule avec la toute-puissance maternelle dans la famille. Elle commente en disant à son mari : « Tu veux qu’il te pique ton argent !», dénonçant sa faiblesse.
Lorsque je réalise que je m’adresse plus souvent à la mère, je me rends compte que j’ai en tête d’être plus proche de celle qui est la plus fragile, mais également, un peu plus tard, que c’est elle qui semble au centre des liens familiaux, réels comme fantasmatiques. Cela ne m’empêche pas de dire un jour au père qui se plaint d’être court-circuité, que la place de père, ça se prend, qu’il ne peut pas attendre qu’on la lui donne ; il semble entendre à la fois le sens « direct » de mon propos, ainsi que mon soutien à des prises de position plus fermes de sa part. « On a trouvé des préservatifs mais on n’y croit pas beaucoup », commente-t-elle maintenant. Elle associe sur sa pratique d’infirmière : « Je me demande ce qui s’est passé chez la mère biologique de Miguel, si elle a connu du stress, parce que chez les mères que je rencontre, il suffit de gratter un peu et il y en a toujours une qui cache quelque chose, comme avoir été violée par son père ». L’expression par la mère de ce fantasme de viol incestueux assigne Miguel à une place d’enfant de l’inceste et interroge l’inscription inconsciente du désir d’enfant de Madame dans sa propre fantasmatique œdipienne. L’adoption d’un enfant d’une autre, abandonné, ne préserve pas, à l’instar du mythe d’Œdipe, du drame. Elle ajoute : « Ma psy m’a dit que le jour où mon fils partira de la maison, je vais m’effondrer ». Elle refuse qu’une autre femme, la mère d’un copain ou la sœur de son mari avec laquelle Miguel n’a pas de problème relationnel, s’occupe de son fils, arguant défensivement qu’elle ne veut pas que quelqu’un d’autre souffre à cause de lui. Un fantasme infanticide commence à affleurer lorsqu’elle évoque le désir de l’abandonner. Elle ajoute, dans un retournement sacrificiel, traducteur d’une impossible triangulation : « De toute façon, j’ai l’impression que moi ou mon mari, quelqu’un doit mourir pour que Miguel ait un déclic et qu’il puisse faire sa vie ».
Pour elle, son fils est incontrôlable, il peut devenir fou ; cette folie supposée contraste avec l’adolescence trop tranquille vécue par la mère, prise dans l’angoisse de désobéir à ses parents, ce qui pourrait les faire mourir. Le caractère inélaboré des fantasmes meurtriers maternels laissent penser à une destructivité infantile qui n’a pas pu être traversée par la mère au moment de son adole
Maman et une ado baisent papa
À cheval entre deux bites
Un cadeau pour se faire pardonner