Couple Allemand en public
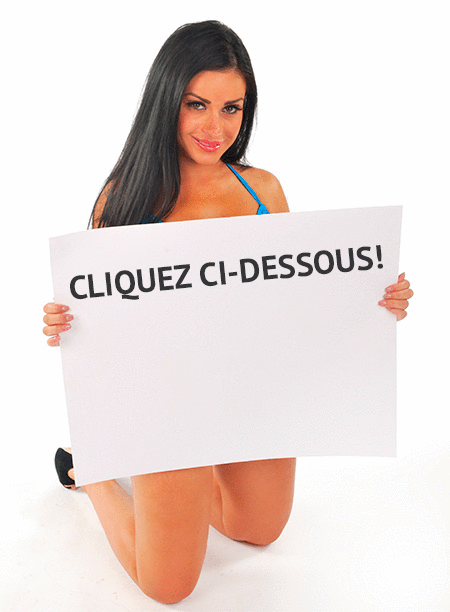
🛑 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Couple Allemand en public
Le terme de couple franco-allemand renvoie à la conception de la France comme une personne. Cest notamment après la guerre de 1870-71 que la relation entre les deux peuples est vue comme celle dune femme innocente agressée par le prussien, incarnation dune virilité violente. Avec la réconciliation scellée par le traité de lElysée de 1963, la métaphore du couple franco-allemand est devenue monnaie courante pour exprimer les relations intimes entre les deux nations. La métaphore ne conduit-elle pas, cependant, à trop dramatiser les rapports entre deux peuples, qui obéissent à une autre logique quà celle régnant entre les individus?
Content may be subject to copyright.
Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universit ät Freiburg
Naissance et histoire d’une métaphore
Originalbeitrag erschien en in: 2001.
France-Allemagne ; pas sions croisées
Ort: Aix-en-Provence, 22-24 März 2001, S. 51- 60.
Naissance et histoire d’une métaphore.
À l’occasion du Salon du livre dont l’Allemagne a été l’hôte d’honneur, le m ensuel Le
Monde des débats a lancé un numéro spécial „France / Allemagne” avec le sous-titre „La
peur du divorce”, qui a été également le titre de l’éditorial de Jean Danie l. Ce titre suggère la
métaphore du couple franco-allemand et Jean Daniel y revient en eff et en écrivant: „Le
couple France-Allemagne fonctionnait à plein dans l’Europe des Douze. Déjà, à quinze ce
n’était plus la même chose”; et il continue en écrivant que l’on admet „que sans le couple
franco-allemand rien n’aurait été possible [à savoir l’évolution considérable allant du pool
charbon-acier jusqu’à l’euro], et on a peur du divorce” 1 . La question qui est au centre du
numéro entier est affichée dans la suite: „Ce couple, crucial pour l’Europe, est-il en crise?”
Et Jacques Juillard donne une réponse déjà à travers le titre de sa contribution: „Le couple
inévitable”, et il précise la signification qu’il donne à la métaphore:
Il en va du couple franco-allemand comme de la plupart de s couples modernes: il est libéral,
tolérant, autorise quelques écarts, fait de moins en moins enfants, ne vit plus sous le même toit.
Son principal enne mi est la durée, son atout majeur est q u’on n’a rien t rouvé d’aut re pour le
La métaphore semble donc de moins en moins suggérer une relation passionnelle; on
pense plutôt à un mariage de raison et Jacques Juillard revient pour cette raison à la
Le choix de l’a xe franco-a llemand n’es t donc pas af faire de se ntiments ni de pré férences
idéologiques, il est tout simplement le seul qui soit réaliste. Le couple franco-allemand, c’est le
Le terme du couple franco-allemand apparaît constamment dans des titres de publications
françaises: Le couple franco-allemand depuis 1945 . Chronique d’une relation exemplaire de
Laurent Leblond 4 , et puis le recueil Le couple franco-allemand en Europe , publié sous la
direction d’Henri Ménudier 5 et ensuite Le couple franco-allemand et la défense de l’Europe
1 Jean D ANIEL , „France-Allema gne. La peur du divorce”, Le Monde des débats , 23,
2 Jacques J UILLARD , „Le couple inévitable”, Le Mond e des débats , 23, mars 2001, p.
5 Institut d’allemand, Asnières, 1993.
par Karl Kaiser et Pierre Le llouche. En allemand, le terme est rarement employé pour
désigner les rapports entre les deux nations. On parle sous un ton neutre des relations franco-
allemandes et avec plus d’emphase de la réconciliation franco-allemande ou d’amitié franco-
allemande. Le terme ‘couple franco-allemand’ est bien sûr une métaphore; le sens littéral ne
désigne que la relation entre deux individus: avec le terme ‘couple franco-allemand’ on
projette le rapport individuel et affectif sur le niveau collectif; la métaphore renvoie à la fois
à un sens premier littéral (le couple individuel) et connote un sens figuré (ici les rapports
entre deux nations). En allemand, le sens premier semble être plus présent de sorte que le
terme ‘Paar’ paraît trop réduire les relations entre les deux nations à une dimension intimiste.
En France, en revanche, on est beaucoup plus habitué à imaginer la nation comme une
personne; cette identification y a été particulièrement précoce. Elle a commencé à prendre
forme humaine – Domina Francia – au moment où l’histoire de France se constituait comme
genre. En 1224, Primat l’a ainsi exprimé au début des grandes chroniques: „Ainsi ne fut-elle
pas sans raison dame renommée sur les autres nations.“ 6 C’est notamment Michelet qui a
donné corps à cette projection collective: „L’Angleterre est un Empire; l’Allemagne est un
pays, une race, la France est une personne. La personnalité, l’unité, c’est par là que l’être se
place dans l’échelle des êtres.“ ( Tableau de la France , 1831) 7 On se rappelle aussi les
premières phrases des Mémoires de guerre du général de Gaulle: „Ce qui il y a, en moi,
d’affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou l a madone aux
fresques des murs [..].“ 8 Les Français se sont forgé dès la Révolution de 1789 une image
positive de leur nation sous les traits d’une femme incarnant la liberté, se faisant plus tard
connaître sous le nom familier de Marianne. En Allemagne, en revanche, la figure de
Germania, guerrière, dirigeant son regard vers l’Ouest, n’a été répandu e qu’après la guerr e
franco-prussienne comme expression du nouvel Empire pour disparaître totalement dès la fin
de la Deuxième Guerre mondiale de l’imaginaire collectif. 9 L’ima ge du couple franco-
6 Jacques R EVEL , „Le fardeau de la mémoire“, in: Etienne F RANÇOIS ( éd.), Lieux de
mémoire. Erinnerungsorte. D’un modèle français à un projet allemand. Berlin, Centre Marc
8 Général DE G AULLE , Mémoires de guerre , t. I, Le Livre de Poche, Paris, 1968, p.5.
9 Il y a bien sûr avant la Révolution de s allégories féminines comme Francia ou
Germania, mais ces figures sont aux pieds des rois. C’est le roi qui est le représentant de la
monarchie, le pays et le peuple lui sont soumis. Ce n’est que dans les Ré publiques que l’on
trouve des allégories féminines comme représentations de l’Etat, ainsi dès le début du XVI e
siècle la Venetia à Venise ou à Amsterdam, ou aux Pays Bas, et bien sûr en Suisse; i l y a un
tableau d’un peintre anonyme, daté entre 1665 et 1668, qui montre une Helvetia, incarnation
allemand ne date cependant pas seulement de l’époque de la réconciliation. Dès la
Révolution française, l’idée du couple formé par les deux nations est apparue, l’Allemagne
soulignant surtout son aspect complémentaire par rapport à la France. C’est en 1848 que l’on
trouve des représentations telle que celle attribuée à Lorenz Clasen montrant Germania et
Marianne comme deux sœurs unies cherchant libert é et autonomie. 10 L’Allemagn e était
devenue dès le choc de 1870-1871 la référence principale pour l a France. Si la France ne
pouvait plus alors se déterminer qu’en fonction de l’Allemagne, la mobilisation de
l’affectivité des masses, la manipulation de l’affe ctivité, allait devenir, comme l’écrivit René
Cheval, un des leviers majeurs de l’action politique. L’Allemagne sera représentée
notamment à travers la figure de Bismarck, l’homme le plus caricaturé en France. 11 Trois
éléments reviennent alors constamment dans la caricature des Allemands après 1871: les
bottes, les moustaches e t le casque à pointe: „trois symboles de sur-mâle à la virilité
de la liberté, entourée de potentats européens (m asculins) qui recherchent ses faveurs
(d’après Thomas Maissen, „Von wackeren alten Eidgenossen und souveränen Jungfrauen.
Zur Datierung der frühesten Helvetia-Darstellungen”, in Zeitschrift für Schweizerische
Archäologie und Kunstgeschichte , t. 56, 1999, p. 280-281; voir aussi Joseph J URT ,
„Symbolische Repräsentationen nationaler Identität in Frankreich und Deutschland nach
1789“, in Ruth F LORAC K (éd. ), Nation als Stereotyp. Fremdwahrnehmung und Identität in
deutscher und französischer Literatur . Niemeyer, Tübingen, 2000, p. 115-146.
10 Voir Marie-Louise P LESSEN (éd.), Marianne und Germania 1789-1889. Frankreich
und Deutschland. Zwei Welten - Eine Revue . Argon, Berlin, 1997, p. 57-58.
11 Au sujets des caricatures de Bismarck que nous devons à Daumier voir André Stoll
(éd.), Die Rückkehr der Barbaren. Europäer und ‘Wilde’ in der Karikatur Honoré Daumiers ,
Hans Christians, Hambourg, 1985, p. 369-423.
12 D’après René C HEVAL , „Cent ans d’affectivité franco-allemande ou l’ère des
stéréotypes“, Revue d’Allemagne , IV, 3, juillet-sept. 1972, p.606. Le stéréotype de Bismarck
est revenu au moment de l’unification allemande en 1990. Dans le numéro spécial de
Libération consacré à l’Allemagne année zéro paru en septembre 1990, on pouvait voir
l’image d’un aigle allemand noir énorme avec une Mercede s comme tête et le commentaire
suivant: „Ombre. Que fera l’Allemagne unie de sa puissance? L’unification n’est pas sans
éveiller souvenirs et fantasmes, touchant fibres et chairs. Mais la crainte, en Europe, de voir
émerger une puissance économique trop forte est elle, bien réelle.“ L’ima ge de l’aigle
énorme jetant son ombre, rappelait une caricature de Daumier publiée en 1871 montrant un
casque à pointe énorme obscurissant la lumière du soleil Liberté et jetant l’ombre sur
l’Europe: „L’éclipse sera-t-elle totale?“L’événement de l’unification allem ande de 1990 a été
souvent interprété par l’opinion publique française à travers les catégories du p assé,
notamment par le rappel de la première unification opérée par Bismarck à Versailles,
événement resté traumatisant dans la mémoire coll ective française. A travers la figure du
chancelier Bismarck, vainqueur de 1871, on conjurait les spectres du passé. Pour J ean-
François P ONCET , „le problème est de savoir si l’Allemagne choisit l’Europe de Jean Monnet
ou celle de Bismarck“ (Paris-Match, 16/11 – 1989). Pour Valeurs actuell es la réponse fut
évidente: „Bismarck balaye Monnet“ – tel était le sous-titre sur la couverture de la revue, le
C’est alors que se constitue cette image stéréotypée d’une Allemagne masculine
représentée par le soldat et de la France, imaginée c omme une jeune femme innocente, violée
par l’agresseur allemand. La perception des rapports entre les deux peuples se sont ainsi
sexualisés comme le devait remarquer Jules Romains dans un ouvrage publié en 1934,
justement sous le titre significatif: Le couple France-Allemagne :
Il y a bien dans l’hi stoire franco-allemande, dans le dram e séculaire de ces deux peuples, dans les
attirances et les haines, également ardentes, qu’ils éprouvent d’âge en âge l’un pour l’autre, et
surtout du côté allemand, quelque chose de sexuel, quelque chose qui semble une transpositio n du
Cette sexualité latente apparaît aussi sous la plume d’un Renan écrivant dans la Préface à
la Réforme intellectuelle et morale : „L’Allemagne a été ma maîtresse; j’avais c onsacré de lui
devoir ce qu’il y a de meilleur en moi“ 14 alors que Nerval a vait définit l’Allemagne comme
„notre mère à tous“. 15 Dans Le Tour de la France par deux enfants , livre qui avait connu
20 novembre 89. Georges Valance, un des rédacteurs en chef de l’ Express , publia en avril
1990, aux éditions Flammarion, un livre intitulé France–Allemagne: le retour de Bismarck .
L’auteur rappellait le rêve de Helmut Kohl: „être un second Bismarck“(39). Dans le même
livre Gauscher fut présenté, comme „héritier spirituel“ de Bismarck (92). Dans le Canard
enchaîné et le Monde , les caricaturistes affublèrent à plusieurs re prises le chancelier Kohl
d’un casque à pointe. Dans le numéro spécial „Allemagne“du Figaro , on écrit Allemagne en
lettres gothiques et un dessin montre un Kohl souriant à côté d’un Bismarck au casque à
pointe. 13 Jules R OMAINS , Le couple France-Allemagne , Paris, Flammarion, 1934, p. XI.
Jules Romains avait souligné en 1934 le rapport conflictuel de la relation franco-allemande
en mettant en relief „les différences profondes, les oppositions, qui dressent l’un contre
l’autre ces deux pays“, mais que, ajouta-t-il, „pourraient aussi bien les joindre.“ A ses yeux,
c’est la situation géo-politique qui condamne les deux pays à faire couple: „Couple malgré
lui. Soit. Mais aucun des deux partenaires n’en est responsable; et personne n’ y changera
rien. Ce n’est ni la France ni l’Allemagne qui ont décidé d e cohabiter sur la même p resqu’île,
sur ce bout de l’Europe, qui n’est pas très grand ni très logeable; et il n’est pas en leur
pouvoir de divorcer. Même s’il se prononçait, leur divorce resterait tout formel. Personne n’a
le moyen d’en faire une vraie séparation “. De la bonne entente des deux peuples dépend
pour Jules Romains la paix en Europe: „Couple dont les querelles retentissent sur l’Europe
entière, et le monde entier, et sans l’apaisement duquel l’Europe ne retrouvera pas la paix.“
( Ibidem , p. X-XI). Une idée similaire est aujourd’hui exprimée par Philippe Delmas dans son
livre au titre quelque peu racoleur De la prochaine guerre avec l’Allemagne : „Depuis
cinquante ans, la nécessité a rapproché la France et l’Allemagne comme les deux lèvres
d’une plaie. A défaut d’affection, elles furent suturées par la peur: celles des guerres passées
menées l’une contre l’autre et celles de la guerre future à mener ensemble. Aujourd’hui, elles
doivent se choisir et, cela, elles ne l’ont jamais fait.“ (Philippe D ELMAS , De la prochaine
guerre avec l’Allemagne , Paris, Editions Odile Jacob, 1999, p.187)
15 Cette image positive de l’Allemagne a trouvé sa source dans De l’Allemagne de
M me de Staël, qui valorisait le naturel et la spéculation métaphy sique en Allemagne par
sous la Troisième République une résonance énorme, on montre deux enfants, André et
Julien, doublement orphelins, ayant perdu leur père et leur patrie. Nous avons voulu montrer,
écrivait l’auteur, „comment chacun des fils de la mère commune arrive à tirer profit des
richesses de sa contrée“. Eclairante formule, écrit René Cheval, mais la mère, dans l’attent e
d’un nouveau père, maintient et gère un capital encore considérable. 16 Dans Colette
Baudoche de Barrès, livre très répandu à la même époque, la jeune Messine qui est le
symbole de la France veuve et vaincue, se refuse à épouser un Allemand pourtant
sympathique, car cela serait reconnaître l’autorité du vainqueur alors que Barrès recommande
après 1918 le mariage de la Française avec l’Allemand puisque, membre d’une nation
victorieuse, elle saurait maintenant le civiliser.
„Il n’est guère douteux que depuis 1945, les rapports franco-allemands se sont déchargés
d’une partie de leur agressivité irrationelle, écrit René Cheval en 1971. Mais on se tromperait
gravement en pensant qu’ils sont désormais à l’abri des poussées affectives“, et l’auteur
constate que face à l’ Ostpolitik active de Willy Brandt, les susceptibilités s’a vivent, que des
inquiétudes s’expriment en coulisse. „Il faudra beaucoup de vigilance pour éviter qu e
l’affectivité ne s’alimente à nouveau aux stéréotypes hérités du passé.“ 17
Depuis, nous sommes habitués à l’image apaisante du couple franco -allemand, terme qui
permet toute une série de développements très imagés des rapports entre les deux peuples.
„France– Allemagne: un drôle de couple“, pouvait-on ainsi lire dans les colonnes du
magazine Le Point , le 11 octobre 1997; on y présente le traité de l’Elysée de 1963 comme
opposition à une vie mondaine et à la civilisation pleine d’esprit mais superficielle qu’elle
croyait constater en France. Son ouvrage, qui est loin d’être exclusivement positif
(notamment à l’egard des Allemands du Sud) a eu la force d’un mythe fascinant. En
témoignent les propros précités de Nerval, de Renan, de Michelet affirmant en 1854: „Mon
Allemagne. Force scientifique qui m’a fait poussé des questions! Pain des forts!“ La guerre
franco-prussienne conduisit cependant à un désenchantement. Renan attribua pou rtant le
militarisme à la seule Prusse, continuant à considérer le pays en tant que tel comme libéral et
pacifique: „La Prusse passera, l’Allemagne r estera.“ C’est alors que le mythe des deux
Allemagnes prit naissance, en décembre 1870 d’abord sous la plume du philosophe Elme-
Marie Caro: „Il y a deux Allemagnes: l’une idéaliste et rêveuse , l’autre pratique à l’excès sur
la scène du monde, utilitaire à outrance, âpre à la cur ée.“ (Voir à ce su jet Wolfgang L EINER ,
Das Deutschlandbild in der französischen Literatur . Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1989; Joseph Jurt, „Le mythe des deux Allemagnes“, Le Monde , 9 juin
1990 (supplément ‘Liber’); id. „Deutsch-französische Fremd-und Selbstbilder in der
Literatur und Publizistik der Gegenwart“, Frankreich-Jahrbuch 1995, Opladen, Leske und
16 Voir Jacques et Mona O ZOUF , „Le tour de France par deux enfants”, in Pierr e Nora
(éd.), Les lieux de mémoire . E.F.: La République , Gallimard, Paris, 1984, p. 201-322.
acte fondateur du couple. Dans le même texte, l’image réapparaît sous la forme d’une
En janvier [1997], on soufflera les 35 bou gies du couple franco-all emand. Mais l a couronne de
mariage ne man que pas d’ép ines et elle par aît bien défr aîchie à l’é preuve du tem ps.
Si l’on parle ensuite du tandem France–Allemag ne comme moteur de l’Europe on revient
ensuite à la métaphore consacrée 18 :
Ce drôle de couple n’est cer tes pas né d’un mariage d’amour, m ais par un acte de volonté
politique. Cette volonté demeure, mais le lien franco-allemand fait de p lus en plus figure de
La relation France–Allemagne, „ça a toujours été un peu couple au bord de la crise de
nerfs“, remarque Anne-Marie Le Gloannec pour ajouter cependant: „Ça ne les a jamais
empêchées de progresser ensemble.“ 19
La relation entre les deux nations a été souvent représentée d’une manière s ymbolique par
la relation entre les dirigeants des deux pays à commencer par l’accolade historique de
Gaulle - Adenauer. Helmut Schmidt a rappelé récemment toute l’importance de la bonne
entente entre lui et Giscard d’Estaing après les rapports plus distants de son prédécesseur
avec Pompidou. La bonne entente entre Schmidt et Giscard a été selon le premier non
seulement le fondement, mais le moteur de l’intégration européenne. Ce furent eux qui
avaient lancé l’idée d’une monnaie européenne; elle n’a pas été le prix à pa yer pour
l’unification allemande comme l’affirment certains. 20 Les bonnes relations entre Mitterrand
et Kohl ont trouvé leur expression symbolique par la main dans la main des deux dirigeants
lors d’une cérémonie funèbre à Verdun le 22 septembre 1984. Cette entente a duré jusqu’au
Malheur eusemen t, Helm ut Kohl et François Mitterrand n’ont pas conduit la meilleure politiq ue
dans des moments essentiels. Le chancelier a refusé de relancer l’union monétaire européenne
avant l’unification allemande qui pèse sur le déficit public o utre-Rhin. Le président français a
18 Les termes ‘tandem’ et ‘moteur’ qui reviennent constamment au sujet du rapport
entre la France et l’Allema gne se retrouvent en puissance déjà chez Jules Romains qui avait
distingué un double sens du mot couple – un sens sexuel-biologique et un sens physique et
mécanique: „Le problème France-Allemagne, s’il est un problème de vie et de passion, est
aussi un problème d’agencement de forces. Un problème de psychologue, mais aussi un
problème d’ingénieur.“ (Jules R OMAINS , op. cit ., p. XI)
20 Helmut S CHMIDT , „Patrioten setzen auf Europa. Die deutsch-französische Entente
liegt im beiderseitigen strategischen Interesse“, Die Zeit , n°33, 12 août 1999, p.8.
montré sa méfiance vis-à-vis de l ’Allemagne après la chute du mur de Berlin en novembre 1989.
Cette réaction négative a laissé des traces. 21
Tout récemment on a encore décrit les rapports entre le chan celier allemand et le président
de la Républi
Brune débauchée le pousse à la dévorer
Première double pénétration
Ange aux gros seins aime la bite