Chienne riche dépouillée de sa dignité
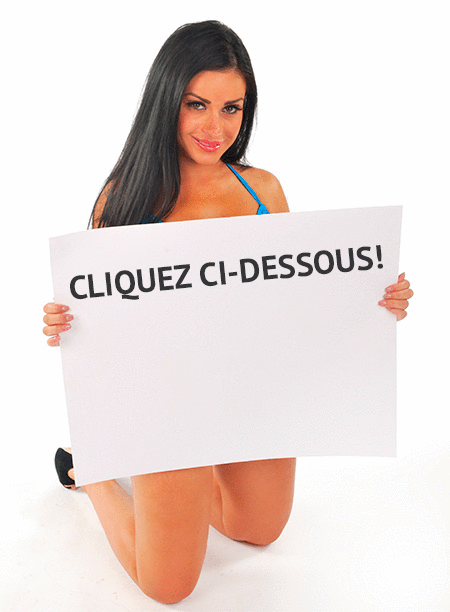
🛑 TOUTES LES INFORMATIONS CLIQUEZ ICI 👈🏻👈🏻👈🏻
Chienne riche dépouillée de sa dignité
Le suicide de Lucrèce selon Tite-Live : transgresser l’interdit au nom de l’honneur
Le suicide de Lucrèce selon Augustin : le respect de l’interdit pour préserver le bien de l’âme
Conclusion
Le problème de la dignité
La notion de dignité, du mot à la chose
Repères grecs de la dignité : l’être humain somme et sommet du vivant (Vous êtes ici)
Repères chrétiens de la dignité : l’être humain comme « imago Dei »
Repères modernes de la dignité : l’être humain comme sujet sensible et autonome
La dignité dissociée entre « mort paisible » et « mort en paix »
La dignité dissociée entre autonomie et liberté
La dignité dissociée de l’expansion au retournement
La dignité dissociée dans l’opinion entre « doxa » et « endoxe »
Médecine palliative et ultime dignité, l’ouverture au « beau mal »
Autonomie et expansion de la liberté individuelle
Autonomie et loi
Autonomie et altérité
Les notions d’autonomie et de liberté des mots aux choses
Sous le regard des historiens et du poète
Sous le discernement de la philosophie
Le mouvement de libération intérieure antérieur au christianisme
Le christianisme et l’expansion du libre arbitre
Passion égalitaire et liberté
Individualisme et autonomie
Autonomie et intérêt bien entendu
intérêt bien entendu et religion
FR
|
EN
Comprise de cette manière, la dignité est une façon de signifier le statut de la personne humaine, cette
idée structurante propose, via l’anthropologie philosophique grecque, une conception hiérarchique des
êtres naturels où l’être humain est envisagé comme somme et sommet du monde du vivant. Ce qui fera
dire au même Sophocle : « Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est pas de plus grandes que
l’homme.110 » Cette merveille si grande n’est cependant jamais considérée par l’anthropologie grecque
comme plus importante que le tout auquel elle appartient. Sa qualité d’être s’entend relativement à
l’ensemble des autres êtres vivants et de ce point de vue, dire que l’homme est une somme du vivant
signifie qu’il intègre toutes les facultés présentes chez le vivant avec cette plus value qu’est la forme
particulière d’intelligence nommée raison. Voilà pourquoi, nous parlons de sommet. Cette logique
108 Comme nous l'avons souligné dans l'introduction de notre thèse, Jean-Baptiste Vico a identifié les rites religieux entourant le
respect des cadavres comme un pivot structurant la condition humaine. Voir la note 2 à la page 1.
109 Un exemple éloquent est celui de la sépulture de Ben Laden. On comprendra facilement les réticences du gouvernement
américain de redonner au peuple Afghan la dépouille de l'homme, mais du coup, on notera l'importance de rendre compte de la
manière dont on a pris soin de disposer du corps en respectant les rites funéraires de la religion musulmane. Il apparaît que le
respect de la dignité de la dépouille est lié au respect de la dignité de la personne indépendamment de ses choix et de ses
actes. Même si l’on pouvait douter de la sincérité de ce respect de la part de ceux qui ont posé les gestes, même si on allait
jusqu’à remettre en doute le fait qu’il y ait réellement eu sépulture, le seul fait de s’assurer et de tout faire pour le laisser croire
indique l’importance dévolue à la dignité du corps. Nous suggérons ici un article du Figaro relatant l’histoire:
http://www.lefigaro.fr/international/2011/05/02/01003-20110502ARTFIG00500-interrogation-sur-l-inhumation-annoncee-de-ben-
laden.php
hiérarchique et ascensionnelle permet un éventail d’opinions offrant un spectre assez large pour marquer
la place de l’homme dans le monde. S’il est sommet, il se peut que les autres êtres soient très près de lui
allant même presqu’à parité. Ou bien encore, il est possible que l’éloignement soit très grand et que la
distance aux cimes apparaisse comme un lointain inatteignable. Mais entre ces perspectives aux écarts
très variables, le statut hiérarchique demeure. À aucun moment, on considérera l’animal non-humain
comme un parfait semblable de l’animal humain. Ceci pour dire que le statut hiérarchique est toujours
maintenu et reconnu comme un fondement de l’organisation légitime de la cité. L’homme est zoon politikon
et son aptitude à organiser et à intégrer la vie civile est la marque de sa supériorité sur les autres animaux.
Ainsi, les modèles d’autorité politique sont conçus en fonction de figures paternelles et pastorales. On
trouve un bel exemple de cela dans l’œuvre de Xénophon, plus particulièrement dans la Cyropédie 111 .
Vantant la magnanimité et la grandeur du Roi Cyrus dans l’exercice du pouvoir, Xénophon s’exprime ainsi :
Oui, souvent, mes amis, et en d’autres occasions, j’ai reconnu qu’un bon prince ne diffère
point d’un bon père. Les pères pourvoient à ce que leurs enfants ne manquent jamais de
biens ; de même Cyrus me semble nous donner des conseils à l’aide desquels nous devons
vivre toujours heureux. » (…) Quel autre a plus mérité, par ses bienfaits, de se voir préféré à
des frères ? à un père, à des enfants ? Quel autre que le roi de Perse peut aussi facilement
se venger de nations ennemies, séparées par un intervalle de plusieurs mois de marche ?
Quel autre, après sa mort, quel autre que Cyrus fut honoré du titre de père par les peuples
dont il avait détruit l’empire ? Or, ce titre est plutôt celui d’un bienfaiteur que d’un spoliateur.112
Dans la félicité comme dans l’adversité, le bon prince est un bienfaiteur. La représentation idéale de
souveraineté dans l’anthropologie grecque est fonction de la qualité de bienfaisance, qualité impliquant
l’inégalité foncière entre le bienfaiteur et ses bénéficiaires. Or, Xénophon suggère que la bienfaisance est
le propre de l’homme et c’est, d’une certaine façon, ce qui le distingue radicalement des autres espèces :
Qu’il ait poussé loin la magnificence de ses dons, étant très riche, cela n’a rien d’étonnant ;
mais que, roi, ses bons offices et ses soins lui aient acquis des amis, c’est ce qu’on ne saurait
trop admirer : on va même jusqu’à dire qu’il donna des signes non équivoques de honte, pour
avoir été vaincu en bons offices rendus à des amis. On raconte qu’il avait coutume de dire
111 Nous privilégions cette œuvre pour illustrer notre propos en raison de sa postérité et de son influence dans le champ de la
réflexion politique. Xénophon se livre à l’exercice de décrire, via la biographie (en bonne partie fictive) de Cyrus II, l’éducation du
dirigeant idéal. C’est l’occasion pour le disciple de Socrate de situer le rôle et la noblesse du dirigeant bienveillant. Qui plus est,
cette œuvre servira d’inspiration à certains penseurs politiques, dont Nicolas Machiavel.
que la conduite d’un bon roi ne diffère point, de celle d’un bon pasteur. Comme le pasteur ne
tire de profit de ses troupeaux qu’autant qu’il leur donne l’espèce de bonheur dont ils sont
susceptibles, de même le roi n’est bien servi par les villes et par les hommes qu’en les
rendant heureux. Il n’est pas étonnant que, avec de pareils sentiments, il ait eu l’ambition de
se distinguer parmi tous les hommes par sa bienfaisance.113
L’aptitude à la bienfaisance libre et volontaire est l’apanage de la magnanimité humaine, source véritable
de respect. Le pasteur est le modèle du pourvoyeur de bienfaits à l’égard et à la mesure de ce qui
convient aux espèces non-humaines, mais aussi aux semblables de notre espèce, dont certains ont la
charge114 . Dans chaque cas cependant, Xénophon suggère que le bienfait s’adapte à l’espèce et le
« genre de bonheur » varie selon les types de bénéficiaires115 . Cette distinction importante établit que dans
la relation animal humain à animal non-humain le seul bienfaiteur au sens strict est l’homme, car ses
bienfaits sont pourvus en connaissance de cause, librement et volontairement. S’il est vrai que les autres
animaux nous procurent beaucoup de bienfaits, c’est d’une autre manière, indirectement et
accidentellement, au sens logique du terme. Dire des animaux nous entourant qu’ils sont nos bienfaiteurs
est réel et avéré, mais le substantif ici employé l’est de manière analogue.
L’esprit grec, pose la bienfaisance humaine comme générateur de respect. Or, la reconnaissance de cela
dépend de deux facteurs : celui de la potentialité humaine à pourvoir la bienfaisance et celui de la
réalisation effective de cette potentialité. Ainsi, l’espèce humaine est seule apte au respect en tant que
dépositaire de cette puissance, cependant seulement certains individus de l’espèce sauront gré du fait
d’incarner la puissance en acte. Telle est la figure exemplaire de Cyrus, dont Xénophon vante les mérites.
114 La magnanimité désigne la grandeur d’âme. Aristote affirme : « Le nom même de la magnanimité indique assez qu'elle se
rapporte aux choses qui ont de la grandeur. Mais faisons voir d'abord quelles sont ces choses; car observer une habitude, ou
celui en qui elle se trouve, cela revient au même. Or, on regarde comme magnanime celui qui se croit digne de faire de grandes
choses, et qui l'est en effet ; car celui qui conçoit une pareille opinion sans fondement, est dépourvu de jugement; et certes, nul
homme vertueux ne saurait manquer de jugement. » Aristote, Ethique à Nicomaque, IV, III, 19. Seul l’être humain est apte à la
magnanimité et seulement certains d’entre eux peuvent l’exercer en acte.
115 C’est pourquoi, Xénophon distingue en bout de ligne l’art de gouverner comme un art devant s’adapter aux natures des êtres
gouvernables. Dans un premier temps, il reconnaît par exemple, dans l’extrait suivant, la difficulté appréhendée de gouverner les
hommes contre la facilité à mener les bêtes. Dans un second temps, en constatant l’aptitude de Cyrus à régner sur les nations, il
se rétracte en suggérant que la chose est relativement facile, si comme Cyrus, on s’y prend avec adresse : « Ces réflexions
nous conduisaient à conclure qu’il est facile à quiconque est né homme de gouverner toute espèce d’animaux, plutôt que des
hommes. Mais quand nous eûmes considéré que jadis Cyrus le Perse eut sous sa domination une immense quantité d’hommes
qui lui obéirent, une immense quantité de villes et une quantité immense de nations, nous fûmes obligé de changer d’avis et de
reconnaître que ce n’est point une œuvre impossible, ni même difficile, de gouverner les hommes, quand on s’y prend avec
adresse. » L’adresse à gouverner n’est pas mutatis mutandis avec les animaux non-humains. Xénophon, Cyropédie, Livre I, I ,3.
Chez Plutarque, nous rencontrons sensiblement le même point de vue. En ce qui a trait à la potentialité de
l’espèce, il affirme sa pertinence dans la reconnaissance de l’aptitude à produire la loi et d’être sujet de
droit. Seul l’être humain « applique naturellement la loi et réserve le droit à son semblable ». C’est ici une
autre façon d’affirmer le statut particulier de l’être humain en tant qu’être apte à l’engendrement de la cité
ou à la vie en communauté politique, dont l’organisation et le fonctionnement dépend de l’instauration et du
respect de la loi. On recourt encore ici au modèle d’autorité politique, il nous révèle un parangon de
bienfaisance en qualité de législateur prodiguant des droits. De plus, c’est sur cette base et cette base
seule que l’on justifie et endosse l’extension de la bienfaisance à toutes les autres espèces :
Pour moi, chasser et vendre comme des bêtes de somme, les serviteurs devenus vieux, dont
on a tiré tout le profit possible, c’est le fait d’un caractère trop dur et de quelqu’un qui ne
s’imagine pas d’autres liens entre les hommes que ceux de l’intérêt. Cependant, nous voyons
que le domaine de la bonté est plus vaste que celui de la justice : nous n’appliquons
naturellement la loi et le droit qu’aux hommes seuls, tandis que la bienfaisance et la libéralité
s’étendent jusqu’aux animaux privés de raison, en se dotant d’un cœur généreux comme
d’une source abondante. L’homme doué de bonté doit nourrir ses chevaux épuisés par l’âge
et soigner les chiots, mais aussi les chiens devenus vieux (…). Et de ce fait, nous ne devons
pas traiter les êtres vivants comme des chaussures ou des ustensiles, qu’on jette quand ils
sont abimés ou usés ou à force de servir, car il faut s’habituer à être doux et clément envers
eux, sinon pour une autre raison, du moins pour s’exercer à la pratique de la vertu
d’humanité.116
Cet extrait majeur des Vies parallèles, suggérant un principe d’extension du respect à l’endroit de tous les
animaux, débute par une remarque visant l’attitude du maître envers ses esclaves117 . Plutarque en profite
pour distinguer la bonté de la justice dans le but de justifier l’extension de la première en s’appuyant sur
l’autorité de la dernière. Même si la différence entre les hommes et les bêtes est ténue au point de
suggérer l’assimilation de l’esclave à la condition des animaux non-humains, l’exercice de la vertu
d’humanité est la marque de l’homme et le moteur du respect. Ni homme, ni bête ne peuvent être traités
116 Plutarque, Vies Parallèles (Caton L’Ancien), V, 1 à 6, Gallimard, Quarto, Paris, 2001, p. 639.
117 Sur le statut d’esclave voir Aristote, La politique, 1252a 30 ss. ; 1254a 17 ; sur la distinction entre servitude naturelle et
conventionnelle 1255a, 3-1255b, 15. On trouve un autre écho de cette distinction affirmée et renforcie par Sénèque dans une
des fameuses lettres à Lucilius : « Songe donc que cet être que tu appelles ton esclave est né d'une même semence que toi,
qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et meurt comme toi. Tu peux le voir libre, il peut te voir e
Une jeune amatrice suce en voiture en POV
Jennifer Luv se fait péter
Velma et Daphne dans une scène lesbienne très chaude